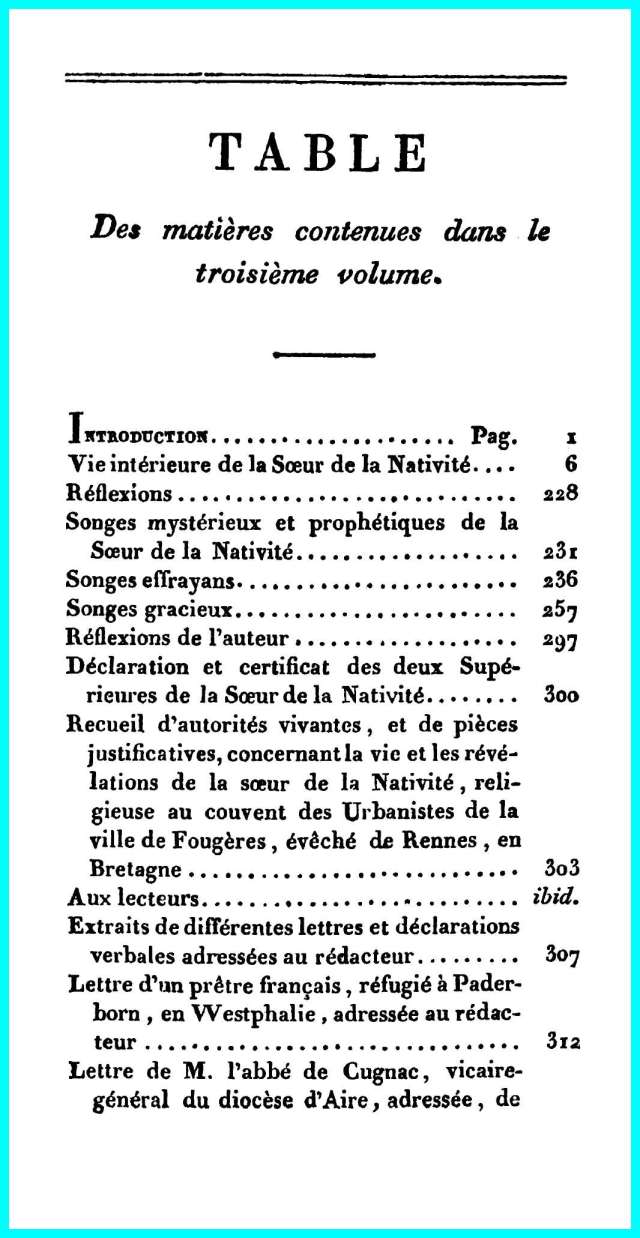Sœur de la Nativité – Jeanne Le Royer
Tome-3 : Page actuelle
(Mise-à-jour: 2019-06-12)
Téléchargement du texte en PDF, transcrit au clavier ou en pages numérisées:
– Tome 3 – Transcrit au clavier (PDF)
– Tome 3 – Numérisé (PDF) 2′ éd.
– Tome 3 – Numérisé (PDF) 3′ éd.
Pages de présentation & texte de chacun des Tomes:
– Accès au Tome-1 : Cliquez ici
– Accès au Tome-2 : Cliquez ici
– Accès au Tome-4 : Cliquez ici
– Access to the Book-1 : Click here
Les références:
La transcription du texte du Tome-3 est faite à partir de la 2′ et 3′ édition. La 2′ édition est publiée en 1819, soit il y a 200 ans !
Pour télécharger les documents au choix, du Tome-1 au Tome-4, soit en textes transcrits ou simplement numérisés, voir le lien suivant.
Téléchargement des 4 Tomes en PDF, Numérisé & Transcrit: Cliquez ici
______________________________________________________________________________________
VIE ET RÉVÉLATIONS
DE LA SŒUR DE LA NATIVITÉ,


(1731-1798)
Religieuse converse au couvent des Urbanistes de Fougères.
Écrites sous sa dictée par le Rédacteur de ses Révélations.
SECONDE ÉDITION,
Ornée du portrait de la Sœur, et augmentée d’un
volume qui contient tout ce qu’elle a fait écrire
peu de temps avant sa mort.
Confiteor tibi, Pater, Domine cœli et
terrae, quià abscondisti hœc à sapien-
tibus et prudentibus , et revelasti ea
parvulis. Math. 11, 25 ; Luc. 10, 31.
TOME TROISIÈME
PARIS,
BEAUCÉ, Libr. de S- A. R. Mgr duc d’Angoulême,
rue Guénégaud.
MDCCCXIX. (1819)
D’abord, ci-dessous, la table des matières en 2 pages :
__________________________
(1-4)
VIE INTÉRIEURE DE
LA SŒUR DE LA NATIVITÉ,
Pour servir de suite à ses Révélations, par le même Rédacteur.
____________
INTRODUCTION.
La confiance que la sœur de la Nativité m’avait donnée ne pouvait guères aller plus loin, comme on a dû le remarquer dans le compte que j’ai rendu de ses confidences et de ses récits. Cette confiance s’était accrue à proportion de l’intérêt que cette sainte fille me voyait prendre à tout ce qui concernait une conscience et des voies extraordinaires, dont elle ne m’avait rien caché de tout ce qui pouvait intéresser l’Église et l’État. J’avouerai même qu’il eût été très difficile pour moi de ne pas la prendre à cœur, sitôt que j’eus bien connu et la trempe de son caractère et la solidité de ses vertus, surtout les grandes faveurs dont le ciel l’avait comblée: mais je ne m’en tins pas là, et je crus bonnement que Dieu, qui, malgré mon indignité, et pour des raisons à lui connues, paraissait m’avoir appelé à la direction d’une si belle âme, voulait que j’eusse tiré parti de la disposition où il l’avait mise lui-même à mon égard, pour la montrer au public sous tous les rapports qui peuvent l’intéresser et l’instruire en l’édifiant.
De quelque manière que cette seconde entreprise m’ait été suggérée, j’en regardai l’exécution comme un devoir ou une nouvelle tâche qui m’était imposée, et dont peut-être on me demanderait compte un jour. D’ailleurs, des âmes de ce caractère sont si rares, leurs vertus sont si au-dessus du vulgaire, qu’on peut dire hardiment qu’il n’y a rien de petit en elles, et qu’il y a toujours à gagner dans tout ce qui peut les faire mieux connaître et apprécier. Dans cette persuasion, je lui fis part du dessein que j’avais conçu d’écrire sa vie intérieure, ou plutôt la conduite du ciel à son égard; ajoutant, pour prévenir les excuses de sa modestie, que je croyais suivre en cela la volonté de Dieu, qui, comme je l’espérais, ne manquerait pas d’en tirer sa gloire pour le salut des âmes et peut-être la conversion des pécheurs. C’était véritablement prendre la Sœur par son faible, et cependant elle demanda du temps pour y penser. Il fallut revenir à la charge, lui rappeler l’intérêt de la gloire de Dieu et du salut des âmes rachetées de son sang , et lui parler avec toute l’autorité que je pouvais avoir sur elle; lui enjoignant de m’obéir en cela, sous peine de désobéissance à Dieu qui m’envoyait, et à l’Église qui m’approuvait….
Vous me parlez, dit-elle enfin, de la conversion des pécheurs…. Hélas! mon Père, je devrais bien craindre plutôt de scandaliser les justes, si ma vie intérieure surtout leur était bien connue. Cependant, ajouta-t-elle, je vous obéirai, puisque vous l’ordonnez. Puisse le ciel en tirer parti, comme vous le dites ! du moins ce récit, vrai autant qu’il me sera possible, en me faisant connaître de vous, servira à faire triompher sa miséricorde à mon égard; on y verra combien j’ai eu besoin de ses grâces spéciales, par lesquelles il m’a prévenu de toutes les manières, et combien son infinie bonté a eu à faire pour triompher de mon mauvais cœur; combien j’ai opposé de résistance à son divin amour….. Par là, mon Père, en rendant gloire au Dieu des miséricordes, j’inspirerai peut-être de la confiance aux plus grands pécheurs. Eh bien, sous ce point de vue et dans cette espérance, nous entrerons, quand il vous plaira, dans le détail que vous exigez, et par là nous terminerons des entrevues qui nous ont coûté bien des inquiétudes et bien des soins à l’un et à l’autre.
Un pareil début, auquel je m’étais bien attendu, m’annonçait à quoi je devais encore m’attendre, et quelle tournure elle donnerait à toute l’histoire de sa vie intérieure. À l’exemple de tous les saints qui ont parlé
__________________________
(5-9)
d’eux-mêmes; nous la verrons bientôt ne se montrer que du côté le moins favorable, exagérer ses moindres défauts; et si elle est obligée de parler des grâces et des faveurs singulières qu’elle a reçues, comme des vertus qu’elle a acquises, ce ne sera, comme eux, que pour s’humilier davantage, en rapportant tout à celui de qui elle a tout reçu et qui doit lui demander compte de tout.
N’importe, ou plutôt c’en est une raison de plus, je tâcherai, ici comme ailleurs, de ne point m’écarter de ses idées, d’employer même jusqu’à ses termes autant que la délicatesse de la langue pourra me le permettre. J’ai trouvé du sérieux jusques dans ses songes, comme on l’a déjà vu : qu’on ne soit pas surpris si j’en rapporte encore quelques-uns, autant qu’ils pourront entrer dans les détails que je dois donner. Tout, dans une vie si extraordinaire, porte l’empreinte de la divinité; d’ailleurs, l’Écriture sainte nous donne tant d’exemples de songes prophétiques et significatifs, comme on l’a déjà prouvé, qu’il paraîtrait au moins un peu téméraire de rejeter tous ceux d’une âme comme celle dont il s’agit. Je la compare à une lampe suspendue au milieu du sanctuaire pour y éclairer nuit et jour, en se consumant devant l’agneau qui y reçoit nos adorations. Depuis longtemps elle y brûle, elle s’y consume du beau feu de son saint amour, et les hommes, toujours distraits et aveugles, ne se sont point encore aperçus de sa lumière. Son âge et ses infirmités m’annoncent qu’il sera bientôt temps de la tirer de dessous le boisseau. Je me suis appliqué à en recueillir tous les rayons avant qu’elle s’éteigne pour nous, et que nous en soyons privés pour toujours.
____________
VIE INTÉRIEURE
DE LA SŒUR DE LA NATIVITÉ.
Deux ou trois jours s’étaient écoulés, la Sœur m’aborde et commence ainsi le récit de sa vie intérieure:
« Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit; par Jésus et Marie, et au nom de l’adorable Trinité, je fais l’obéissance. »
Manière dont la Sœur entre en matière.
Vous exigez donc, mon Père, que je vous parle maintenant de moi-même!…. Attendez-vous bien que jamais vous n’avez eu connaissance d’une vie si extraordinaire, si inconcevable, ni peut-être si criminelle que celle dont je dois vous entretenir : dans quelque époque et sous quelque point de vue qu’on l’envisage, on y trouvera de quoi admirer et de quoi gémir. Plût à Dieu que la fin en soit aussi tranquille et aussi assurée que la durée l’a été peu ! car, mon Père, à considérer le cours de ma vie, ce n’a été, à le bien prendre, et vous n’y verrez qu’une suite non interrompue, qu’une alternative continuelle de ténèbres et de lumières, de joies et de consolations mêlées de beaucoup de sécheresses et d’aridités. Enfin, vous le dirai-je ? les faveurs dont il a plu à Dieu de me combler au-delà, de tout ce qu’on peut dire, ont été, ainsi que ma vie, traversées et comme détrempées d’amertumes, de travaux, de peines, d’agitations et de chagrins continuels : de manière, mon Père, qu’il est impossible de me définir, et je ne sais moi-même ce que je suis, ce que je deviendrai, ni si j’ai plus lieu de me rassurer que de craindre, ou de craindre plus que de me rassurer; je ne vois que le parti de m’abandonner au Dieu bon qui m’a tirée du néant, et qui ne veut la perte de personne. Mais il est temps que nous commencions.
Ce qui arrive à la mère de la Sœur pendant sa grossesse.
(1) On dirait, mon Père, qu’avant ma naissance Dieu et le démon étaient déjà en guerre à mon occasion. Pendant le temps que ma mère me porta, elle fut en butte à plus de dangers qu’elle n’en avait couru dans toute sa vie : des terreurs, des chutes, des accidents imprévus; elle ne pouvait faire deux pas qu’elle ne fût poursuivie par des bêtes furieuses ou épouvantée par des spectres. Un soir, entre autres, qu’elle était sortie à la porte, un animal inconnu sauta tout à coup presque sur elle, avec une figure menaçante dont elle eut une frayeur capable de lui donner la mort. Ces impressions dangereuses se communiquèrent à moi d’une manière qu’on ne peut bien expliquer, mais qui n’en est pas moins réelle, s’il faut s’en tenir à l’expérience; tellement que jusqu’à l’âge de deux ans le moindre bruit me jetait dans des tremblements et des convulsions qui annonçaient le mal caduque et faisaient tout craindre pour ma vie.
(1) La Sœur avait commencé par me dire son nom de baptême et de famille, ainsi que le temps et le lieu de sa naissance; mais je n’ai pas cru à propos de répéter ici ce que j’ai dit au commencement de sa vie extérieure, que j’ai fait précéder le volume de ses révélations. C’est ainsi que je tâcherai d’abréger tout ce qui aura déjà été touché, et de n’en répéter que le moins qu’il me sera possible.
Première faveur que la Sœur reçoit de la Ste-Vierge.
Mes pauvres parents n’eurent recours qu’à la puissance du ciel pour m’en préserver; ils me vouèrent à la Sainte Vierge, et promirent pour moi un voyage, que j’acquittai dans la suite, à Notre-Dame de Pont-Aubré, dans le Maine. Depuis le moment où ils m’eurent mise sous la puissante protection de cette ennemie de la puissance des ténèbres, non-seulement je n’eus plus
__________________________
(10-14)
aucune frayeur, mais jamais je n’ai été susceptible d’aucune crainte puérile et sans fondement. L’idée des spectres, des revenants, etc., qui en épouvante tant d’autres, ne me fait pas la moindre impression : j’irais seule la nuit comme le jour ; je veillerais seule avec les morts; je coucherais, s’il le fallait, parmi des cadavres, sans en être épouvantée; et cela surtout depuis l’âge de douze ans, où j’accomplis le vœu qu’on avait fait pour moi. « Je m’en informai dans le temps, et toutes les religieuses me rendirent le même témoignage, ajoutant que la sœur de la Nativité avait longtemps couché avec une tête de mort à côté de son oreiller. On a vu précédemment ce qui se passa, en veillant une de ses sœurs morte. »
Grâce singulière que lui fait J.-C. à l’âge de deux ans et demi. Vision d’un globe lumineux.
Cette première faveur de Marie ne fut à mon égard que le coup d’essai de la protection du ciel, qui fut suivi de bien d’autres grâces qui auraient dû miner absolument toutes les espérances de mon ennemi, s’il pouvait se décourager de quelque chose. J’étais encore toute petite, et j’avais à peine quatre ou cinq ans (elle m’a fait écrire depuis qu’elle n’avait alors que deux ans et demi, quelques jours de plus, suivant ce que J.-C. venait de lui faire connaître), lorsqu’il plut à Dieu de me favoriser d’une autre manière, mais si frappante, qu’elle n’est jamais sortie de ma mémoire et n’en sortira jamais. Ce trait, à mon avis, n’a pas peu influé sur tout le reste de ma vie, et je le regarde comme la source de toutes les grâces qui l’ont suivi. J’étais bien éloignée, surtout à cet âge, d’y pouvoir entrer pour quelque chose; je n’avais encore aucune connaissance ni de Dieu, ni de la religion, ni de moi-même, pas la moindre idée du bien et du mal; je m’amusais alors, comme les autres, à tout ce qui pouvait fixer la légèreté de mon imagination, sans soucis, sans inquiétudes, et sans presqu’aucune réflexion.
Voici donc, mon Père, le trait singulier qui m’arriva un jour de dimanche que je me trouvais dans une maison voisine de celle que mon père occupait, pendant que mes parents étaient à l’office divin. Je me rappelle, comme de l’heure présente, qu’entre autres personnes de différents sexes qui se trouvaient dans cette maison, il y avait deux ou trois jeunes hommes assis à la table, qui buvaient, chantaient et se divertissaient de leur mieux; j’avais les deux mains posées sur le bout de la table, et dans cette attitude je les regardais et les écoutais attentivement sans presque rien comprendre ni à leurs actions, ni à leur chant. L’un d’eux s’écria tout à coup: C’est bien dommage qu’il faille quitter la vie et mourir! que nous serions heureux si nous restions toujours ici, et que nous soyons éternellement comme nous sommes à présent! je n’en demanderais pas davantage, et je renoncerais à tout le reste… Mais la mort !… quand on y pense !…. etc.
Ces paroles, qui furent applaudies et répétées par les autres, me frappèrent. Que veulent-ils dire par là, me disais-je à moi-même? car je n’avais encore aucune idée ni d’une autre vie, ni de la nécessité de mourir. Pendant que je réfléchissais suivant ma petite portée, le ciel se chargea de m’expliquer le mystère, et c’est ici la première vision dont il m’ait favorisée. Un globe lumineux de figure ovale, et à peu près de la hauteur d’un homme, me parut descendre du ciel et s’arrêter sous le plancher de l’appartement; son feu avait toutes les nuances de l’arc-en-ciel, mais ses couleurs étaient beaucoup plus vives. Dans ce globe j’entrevoyais, sans bien distinguer, comme la figure d’un homme debout, qui se fit entendre à moi par ces paroles prononcées très distinctement, et que j’ai bien retenues: « Vois-tu, mon enfant, ces insensés? entends-tu ce qu’ils disent dans leur extravagance? Je suis le Dieu du ciel et de la terre; c’est moi qui ai tout créé, qui les ai créés eux-mêmes par ma puissance. Je n’ai tiré l’homme du néant que pour me connaître, m’aimer et me posséder éternellement. Eh bien, mon enfant, voudrais-tu aussi, comme eux, renoncer à une si haute destination, pour partager éternellement ici-bas le sort et la demeure du quadrupède et du reptile? voudrais tu changer le bonheur du ciel avec les misères de la terre? n’as-tu pas plutôt envie d’être à moi, de me posséder un jour, et de jouir à jamais du bonheur que je t’ai acquis et préparé au prix de tout mon sang? »
À ces mots, mon Père, à ces tendres invitations, mon esprit fut rempli de la connaissance de son auteur. Découvrant en lui des perfections infinies et inexprimables, voyant en lui mon souverain bien, je sentis mon âme saisie, pénétrée de sa présence, et mon cœur tout embrasé du feu de son amour, ainsi que du désir de le posséder sans fin. Dès ce moment, le plus heureux de ma vie, je lui fis l’hommage de mon être et le sacrifice de toute ma personne. Je désirais ardemment ou de mourir sur l’heure pour le voir et le posséder plus tôt, ou de ne vivre que pour le servir et l’aimer. Oui, mon Dieu, lui disais-je, Dieu de mon cœur et de toute mon âme, vous savez, vous
__________________________
(15-19)
voyez avec quelle ardeur je désire d’être à vous; car aussi bien je sens que mon cœur, qui est votre ouvrage, n’est fait que pour vous, et qu’il ne peut jamais trouver de repos qu’en vous ! Que le monde est vil et méprisable, en comparaison de vos beautés et de vos ineffables perfections ! J’y renonce dès ce moment; j’y renonce pour toujours, pour ne penser qu’à vous, ô mon Dieu! qui êtes mon principe et ma fin.
Incontinent la vision disparut, et me laissa dans des sentiments et des réflexions que je n’eus pas même la tentation de manifester à personne : Dieu avait mis en moi, sur ce point, une discrétion dont les enfants de cet âge ne sont pas capables, et qui m’a accompagnée dans plus d’une rencontre où j’ai célé (x), sans aucun effort, à mes propres parents, ce que naturellement j’aurais dû m’empresser de leur raconter. Ils n’en eurent pas la moindre idée; et cependant, toutes les fois qu’ils me parlaient de Dieu pour m’apprendre mes prières ou mon catéchisme, toutes les fois qu’ils me parlaient de J.-C. ou de la sainte Trinité, je me rappelais toujours cette première vision, et je disais en moi-même : Il faut assurément que ce soit ce même bon Dieu là que j’ai vu, et qui m’a parlé une fois dans ce beau globe, et qui était si lumineux et si brillant. Ah ! que j’aurais de plaisir à le voir et à l’entendre encore! que je désirerais bien de le connaître toujours davantage! mais surtout quel bonheur, si je pouvais un jour le posséder ! Ainsi je parlais intérieurement; mais je ne le disais jamais qu’en moi-même; mes parents n’y auraient rien compris, et je n’avais pas la moindre envie de leur en parler.
(x) célé (???)
Apparition des charbons ardents, figure de l’Église des derniers temps.
Ce ne fut pas la seule fois que Dieu me favorisa de cette manière à un âge si tendre. J’avais encore, je crois, toute mon innocence baptismale, lorsque j’eus cette autre apparition dont je vous ai parlé ailleurs, et qui figurait, par des charbons ardents entourés d’un cercle de lumière, l’état de l’Église dans ses derniers temps, suivant l’explication que j’en ai reçue depuis, et dont je vous ai rendu compte en parlant des persécutions de l’Église. Peut-être, mon Père, et vraisemblablement Dieu aurait continué de me donner des marques sensibles d’une prédilection gratuite, si de mon côté j’avais continué de lui être fidèle, en conservant toujours la grâce de mon baptême: Mais, hélas ! faut-il qu’insensiblement le péché soit venu interrompre un si beau commerce, une si heureuse correspondance avec mon Dieu, mon créateur et mon souverain bien!
Négligences et infidélités de la Sœur; aveu qu’elle fait des fautes de son enfance.
Créature infortunée, j’abusai de ses bontés! Aussi le ciel retira ses dons à mesure que la malice s’empara de mon esprit et corrompit ma volonté! tant il est vrai que la vue de Dieu n’est due qu’à la pureté du cœur, ses tendresses qu’à l’innocence, et ses familiarités qu’à la fidélité aux grâces dont sa bonté nous prévient! Loin de faire, comme il l’exigeait de moi, un saint et digne usage de ma raison naissante, je négligeai de penser à lui, de l’adorer, de l’aimer, de le prier, de tourner vers lui mes premières pensées par la méditation de sa loi et de ses perfections divines, et de lui consacrer les premiers mouvements de mon cœur. Coupable et fatale négligence !… Les premières infidélités, qu’on regardera peut-être comme des minuties, des bagatelles dont on ne devrait seulement pas parler, je l’ai su depuis, ces prétendues minuties étaient réellement de vraies infidélités, qui en ont attiré bien d’autres en refroidissant d’abord mon cœur à l’égard de Dieu, et ensuite le cœur de Dieu à mon égard. Fatale origine! triste enchaînement!
Je sentais imperceptiblement un certain orgueil prendre la place de la candeur et de la simplicité; bientôt la méchanceté commença à s’établir sur les ruines de mon innocence aussi bien que de mon bonheur. Je devins en peu de temps entêtée, rebelle, désobéissante à la voix de ma mère, qui se voyait quelquefois forcée de me punir contre son cœur : je prenais si mal ses corrections, que, loin d’en profiter, je n’en étais que plus méchante; je nourrissais des aversions contre elle, et des ressentiments contre mes frères et sœurs quand ils m’avaient fait gronder. Je mentais pour m’excuser, je disais : En vérité, en conscience, cela est vrai, comme Dieu me voit, etc. Quand on voulait me contrarier et surtout me punir, je noircissais de colère; ce qui désolait au dernier point ma pauvre mère, qui ne savait comment s’y prendre pour me corriger de ce terrible défaut. Je continuai d’y être sujette jusqu’à un événement que Dieu, qui sait tirer le bien du mal quand il veut, permit sans doute par bonté pour moi. Il arriva qu’un jour je vis un homme transporté de colère, comme je l’avais été moi-même tant de fois; son visage en était défiguré à faire peur; et en effet j’en eus tant d’horreur, que dès ce moment je résolus de ne jamais me livrer à cette passion furieuse et si indigne d’une âme qui doit représenter partout la douceur et l’image de J.-C., son modèle.
Ses remords; ses craintes et sa confiance.
Malgré tant d’inclination au mal, j’éprouvais souvent des troubles intérieurs, des agitations involontaires, qui étaient sans doute des effets de la
__________________________
(20-24)
grâce que J.-C. me ménageait : mille retours sur moi-même, mille bons mouvements me rappelaient sans cesse vers Dieu. Je me sentais pénétrée tantôt de la crainte de lui déplaire et de ne pas l’aimer comme je lui avais promis, tantôt de celle d’en être un jour séparée pour l’éternité; j’appréhendais au dernier point d’être surprise par la mort en mauvais état, et cette pensée de la mort et de ses suites inévitables, cette crainte salutaire des jugements de Dieu fut le premier moyen dont ce Dieu de bonté, qui a tant et si longtemps combattu contre ma résistance, s’est servi pour en triompher. Combien d’autres pécheurs ont éprouvé la force de cette arme victorieuse entre ses mains!
Dans cet état de disgrâce, tout m’épouvantait : un bruit, un orage, un coup de tonnerre, un éclair, me faisaient frémir. Je tremblais alors que le jugement général n’allât commencer sans que j’eusse le temps de m’y disposer; je courais quelquefois me cacher dans quelque coin retiré, pour éviter d’y être citée; j’étais transie de peur de m’y voir condamnée, et ne pouvais, sans frémir, songer au sort d’une âme qui aura le malheur d’avoir perdu son Dieu pour jamais. Quel bonheur peut goûter une créature dont la conscience est ainsi troublée? Mais le malheur est bien plus grand, l’état est bien plus déplorable, quand on vit dans l’état et l’habitude du crime sans éprouver ni trouble ni remords : c’est ce qu’il y a de plus à craindre pour un pécheur.
Une seule pensée me rassurait un peu : je me disais à moi-même que le Dieu tout-puissant qui m’avait apparu et parlé dans le globe, était trop bon en lui-même et paraissait m’aimer trop pour vouloir me perdre à tout jamais. Quand je serai devant lui, à son jugement, disais-je, je le prierai si bien qu’il se laissera fléchir et sera comme forcé de me pardonner. Je vous dirai même, mon Père, que cette espérance a toujours servi à me soutenir contre ce que la frayeur aurait pu avoir d’excessif; oui, c’est cette espérance jointe à la crainte qui me fait regarder cette première apparition comme la grâce de salut la plus précieuse pour moi, celle qui a le plus influé sur le reste de ma vie intérieure, en devenant comme le principe de toutes les autres faveurs du ciel.
Son attrait particulier dès l’enfance pour la dévotion au Saint-Sacrement.
Il faut vous dire, en passant, mon Père, que Dieu ma inspiré de bonne heure et pendant toute ma vie un attrait tout particulier pour la dévotion au Très-Saint-Sacrement de l’Autel; dès l’enfance j’en ai éprouvé des impulsions extraordinaires, jusque-là que je ne pouvais passer devant un tabernacle où résidait la présence réelle du corps de J.-C., sans me sentir intérieurement et comme forcée de m’arrêter et de me mettre à genoux pour adorer ce profond mystère. Plus d’une fois dans l’église je me suis exposée à la risée des enfants, dont l’exemple m’avait portée à des irrévérences en attendant le prêtre qui devait nous catéchiser; ils avaient beau rire et se moquer de moi, il me fallait devant eux et sur-le-champ expier la faute qu’ils m’avaient fait commettre, par des actes extérieurs qui en faisaient amende honorable à J.-C.
Quand il arrivait que ma conscience m’eût reproché quelque chose d’un peu considérable, alors je me trouvais arrêtée dans le saint temple; une force invincible semblait m’interdire le sanctuaire et me défendre d’approcher de l’autel. Hélas! mon Père, toutes ces grâces signalées accordées à si peu de personnes, les attentions si bien marquées d’une providence toute particulière, ne sont pas des mérites ; elles ne servent qu’à rendre plus criminels et plus inexcusables et mon ingratitude envers l’auteur de tant de faveurs, et les péchés sans nombre dont je me suis rendue coupable envers la présence réelle de cet aimable Sauveur au très Saint-Sacrement de l’autel. Puisse l’aveu que j’en dois à la face de la terre réparer sa gloire offensée, en effaçant l’outrage qu’il en a reçu ! puissent les Anges et les Saints lui en faire amende honorable, et l’en dédommager par la ferveur de leur amour pendant toute l’éternité!
En voilà déjà beaucoup, comme vous voyez, mon Père, de ma misérable vie intérieure; voilà déjà bien des grâces extraordinaires du côté de Dieu, sans presque aucune correspondance du mien. Voilà par conséquent déjà bien des infidélités et bien des ingratitudes, voilà bien des péchés commis, dont il me faudra bientôt rendre compte à mon juge. Mais nous ne sommes pas encore au bout de ces infidélités et de ces crimes: hélas! pendant bien du temps encore ils ne feront qu’aller en augmentant. Puisque vous êtes curieux d’en entendre tout le détail, demain, si vous le voulez, ou même ce soir, nous en reprendrons la continuation; aussi bien mon devoir m’appelle ailleurs en ce moment. Adieu, mon Père, veuillez m’excuser et prier pour moi.
Défauts de ses confessions et de sa première communion. Suites funestes pour son âme.
« Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par Jésus et Marie,
__________________________
(25-29)
et au nom de l’adorable Trinité, je fais l’obéissance. »
Mon Père, ma mère me faisait mon examen de conscience et me conduisait à confesse, mais la crainte que j’avais d’être grondée de mon confesseur me lui faisait cacher la moitié de mes fautes, surtout les désobéissances à ma mère. On me fit communier à neuf ans et demi. C’était beaucoup trop tôt à mon avis, et j’ai eu lieu de m’en repentir. Comme je ne craignais rien tant que d’être obligée, suivant un usage assez général, de faire des excuses et même de demander pardon à ma mère avant de communier, j’allai un mois auparavant faire l’aveu de tout ce que la conscience me reprochait à son égard; mais en cela j’allais au-devant de ce que je voulais éviter: Dieu permit que pour m’éprouver mon confesseur m’ordonnât de lui demander pardon et de changer de conduite envers elle.
Qu’on est aveugle et malheureux surtout à cet âge! Je ne pus jamais me résoudre à une satisfaction si juste pourtant et si nécessaire ; et pour surcroît de malheur, la crainte d’un refus, trop mérité me fît cacher tout cela lorsque je reçus l’absolution. Je communiai donc dans cet état contre les remords de ma conscience, qui, dès ce moment, commença à me tourmenter. Ciel ! que ce souvenir est amer ! aurai-je bien assez de larmes, et ma vie pourra-t-elle suffire à déplorer une pareille faute et toutes celles qui en furent les funestes effets?
Dès ce moment, mon Père, plus de faveurs du ciel, plus de consolations intérieures, ni paix, ni contentement! Tout mon bonheur s’était évanoui par l’action qui devait y mettre le comble et contribuer davantage à le rendre éternellement durable. Qu’on est à plaindre quand on trouve la mort dans la source de la vie, et que ce qui devait nous sanctifier ne sert qu’à nous rendre plus coupables que nous n’étions auparavant ! Ce malheureux état dura plus de cinq mortelles années, pendant lesquelles l’usage, le respect humain et la confrérie du Rosaire, où j’étais enrôlée et dont j’abusais, me firent commettre bien des sacrilèges dont je frémis encore, et dont j’ai bien lieu de frémir.
Loin de se ralentir cependant, mes passions, comme vous devez bien le penser, ne faisaient que prendre de nouvelles forces et s’augmenter de jour en jour. Le démon avait bien lieu de s’applaudir et de triompher. Peut-être que mon cœur eût enfin tombé dans l’endurcissement, si une grâce spéciale ne m’eût préservée de ce profond abîme par les remords accablants que j’éprouvais malgré moi, et qui ne me donnaient ni paix ni trêve. Il semblait qu’à chaque pas j’entendais intérieurement une voix qui me disait d’un ton sévère : Qu’as-tu fait, malheureuse, et que veux-tu devenir ? tu n’as obéi ni à J.-C., ni à la mère; tu as trompé ton confesseur; tes confessions sont nulles, tes communions sont mauvaises; tu n’as point l’amour de J. C : après tant d’attentions et de bienfaits de sa part, tu vis dans la disgrâce de ton Dieu; et si tu avais le malheur de mourir en cet état, où irais-tu, infortunée ! Ah! l’enfer serait ton partage pour l’éternité. Mais était-ce là ce que tu avais promis à ton Dieu ? était-ce là ce qu’il avait droit d’attendre après tant de bienfaits de sa part?
Jour et nuit ces reproches accablants retentissaient au fond de mon âme. J’en étais si troublée, que, malgré mon orgueil, je me jetai un jour tout à coup à genoux aux pieds de ma mère, dans l’intention de me punir de ne l’avoir pas fait plutôt. Ma mère fut si surprise de cette démarche de ma part, que, malgré l’émotion où je l’avais mise par mes résistances, elle demeura toute déconcertée de me voir ainsi devant elle et ne savait à quoi l’attribuer…
Elle se convertit et fait une confession générale à l’occasion d’un jubilé ou indulgence plénière. Fruits qu’elle en retire. Humble aveu de ses misères.
Cette première victoire sur moi-même commença à me tranquilliser un peu; mais tout n’était pas fait, sur ces entrefaites arrive le grand jubile ou pardon général de l’Église : ce fut une de mes amies, qui était venue nous voir, qui nous annonça qu’on l’avait publié à la paroisse. Bonne nouvelle, m’écriai-je ! Ah ! que me voilà bien! je vais du coup faire une confession générale et me convertir tout à fait et tout de bon. À cette exclamation de ma part, mon père éclata de rire. Nous y voilà pourtant, s’écria-t-il, et nous allons voir de belles choses ! notre fille Jeannette va se convertir et faire une confession générale. Notre-Dame, ce ne sera pas pour peu, et les prêtres n’ont qu’à s’étonner; il y aura de grandes difficultés par là.
Mon père m’aimait singulièrement, et la bonne idée qu’il avait de moi ne lui permettait pas d’imaginer que j’eusse eu besoin de conversion ni de confession générale. Hélas ! je ne sentais que trop toute la réalité de ce besoin. Oui, mon père, lui répondis-je, je veux me convertir avec la grâce de Dieu, et j’espère qu’après cela je serai de beaucoup meilleure que je n’ai été jusqu’ici. Nous verrons ce qu’il en sera, reprirent mes parents…
Sitôt que le jubilé fut ouvert, je n’eus rien de plus à cœur ni de plus pressé que d’aller me jeter aux pieds de feu M. Maillard, alors recteur de notre paroisse (la chapelle Janson).
__________________________
(30-34)
Mon Père, lui dis-je, en arrivant, je vous demande en grâce de me faire faire une confession de toute ma vie, car je suis très mécontente de toutes celles que j’ai faites jusqu’ici… Il m’écouta avec bien de l’attention et m’aida beaucoup. Quand il me demanda si c’était par la crainte d’être battue par ma mère que j’avais refusé d’obéir à mon confesseur, je lui donnai, quoique faiblement, une réponse affirmative qui n’était point encore selon l’exacte vérité. C’était encore là un petit déguisement dont je me suis encore repentie, quoiqu’il ne fût pas, à beaucoup près, aussi essentiel que la première faute que j’avais faite.
Mon jubilé avait commencé de me rendre, à moi-même : j’avais alors environ quinze ou seize ans (1).
(1) Ce jubilé dont parle la Sœur, et qu’elle fît à l’âge de quinze ou seize ans, dut donc avoir lieu en 1746 ou 1747; car elle était née au mois de janvier 1731. On connaît le jubilé pour l’élection de Benoît XIV en 1740, qui correspond avec la première communion de la Sœur à neuf ans et demi, et le grand jubilé séculaire en 1751, dont la Sœur parlera bientôt, et qu’elle fit à l’âge de vingt ans. On ne connaît peint celui dont elle parle ici. Il faut donc dire que cette bonne fille dans son ignorance a confondu un grand jubilé avec un petit jubilé accordé au diocèse de Rennes, à quel qu’occasion que nous ignorons, ou peut-être plus vraisemblablement encore avec cette indulgence plénière et solennelle qu’on gagne en forme de jubilé à la fin d’une mission , et à laquelle les gens de la campagne sont assez accoutumés de donner le nom de jubilé. Au reste, cette erreur, ou plutôt ce défaut d’expression juste de la part de la Sœur, ne fait rien au fond des choses qu’elle nous raconte avec tant de naïveté et de simplicité.
Dès lors Dieu parut se rapprocher de moi, à mesure et à proportion que je m’approchais de lui, ou plutôt, ô mon Dieu! c’était vous qui aviez fait la première démarche et qui, dans l’excès de votre amour, m’aviez recherchée de toutes les manières; qui aviez mis tout en œuvre pour me regagner ! Mais hélas! ô Dieu de bonté! le temps de ma parfaite conversion n’était pas encore venu, et vous avez été assez bon pour l’attendre patiemment, et pour supporter jusque là des infidélités dont je rougis maintenant, et une conduite qui dut vous être insupportable. Que n’a-t-il pas dû en couter à votre amour pendant ce long et criminel délai!
Tout ce que je vous dis ici, mon Père, dit la Sœur, aussi bien que tout ce que je dois vous dire encore, ne servira pas peu à me faire connaître de vous; ce sera déjà une grande avance pour la confession générale que j’ai dessein de vous faire, si Dieu m’en donne le temps et les moyens. En attendant, je me sens portée, en vous obéissant, à réparer ma conduite passée, autant qu’il sera en mon pouvoir. Qu’on apprenne, par mon propre aveu, combien la grâce de Dieu a eu à faire en moi, de quel abîme sa miséricorde m’a retirée, et qu’on sache combien je lui suis redevable à tous égards. Ah! sans doute, les âmes fidèles verront avec étonnement et admiration, d’un côté, tant d’infidélités, de révoltes, d’ingratitudes et de misères; de l’autre, tant de bonté, de patience, de recherche et d’amabilité. Puisse ce Dieu d’amour avoir oublié ce que je vais vous dire, et ne m’en punir jamais! puisse-t-il, au contraire, en retirer sa gloire, et le prochain son édification! Placée entre la présomption et la défiance, que mon récit retienne au moins le téméraire qui s’expose, et empêche de se désespérer celui qui a eu le malheur de tomber! C’est le fruit le plus désirable qu’on en puisse espérer….
Pendant deux ans entiers j’avais goûté le fruit de ma confession générale; la paix, la douce tranquillité de ma conscience, m’avaient permis des retours amoureux vers Dieu et des réflexions sérieuses sur moi-même. Je prenais beaucoup de goût au chant des cantiques spirituels et à la lecture des livres de piété; car j’avais appris à lire, comme on le fait à la campagne, c’est-à-dire, assez pour ces sortes de lectures. J’aimais la compagnie des filles vertueuses et les conversations sur la spiritualité…. dispositions qui semblaient annoncer tout autre chose que ce qui arriva. J’étais bien plus docile envers ma mère, à qui pourtant je résistai encore une fois, mais dans une circonstance qui, je crois, rendait ma faute, s’il y en avait, bien plus excusable que par le passé. Voici quelle fut cette circonstance, afin que vous en jugiez:
Comme ma sœur cadette, j’avais eu bien des fois la faiblesse d’aider notre mère dans certaines pratiques superstitieuses qui sont si ordinaires parmi les gens de la campagne. Il y avait même en cela quelque chose qui tenait du maléfice, quoique ce ne fût pas dans l’intention de ma mère. Un jour, il me tomba vivement dans l’esprit qu’il y avait de l’offense de Dieu dans cette pratique. Ma conscience aussitôt se révolta, et je refusai de m’y prêter. Je dis nettement à ma mère que je ne lui obéirais pas, parce que j’y voyais du péché ; ma sœur suivait mon exemple. Je m’étais attendue à essuyer au moins quelques paroles de vivacité de la part de ma mère. Point du tout, elle demeura toute pensive, et se contenta de me dire assez doucement : Eh bien, ma fille, j’en parlerai à mon directeur, et s’il y a du péché en cela, nous ne le ferons plus. Elle m’avoua depuis qu’elle s’en était confessée et qu’elle en avait fait pénitence. Ainsi, mon Père, le motif et l’événement m’ont toujours consolé sur cette dernière désobéissance à ma mère.
__________________________
(35-39)
Mort de son père; écarts de sa jeunesse.
Vers ce temps-là arriva la mort de mon pauvre père, qui me causa une peine très sensible et me fit verser bien des larmes; car je l’aimais bien sincèrement. J’en pris occasion de rentrer davantage en moi-même et de penser de mettre en sûreté mon salut pour l’avenir. Ainsi, mon Père, ces deux années depuis mon retour à Dieu,sans être marquées par aucune faveur extraordinaire, s’étaient assez bien passées et donnaient pour la suite quelque espérance de mieux encore; du moins, il n’y avait aucune apparence que ce temps dût être sitôt suivi d’une conduite qui me fît tout à fait oublier mon Dieu et mes premières dispositions à son égard.
Je touchais presque à ma vingtième année, temps critique pour la vertu, pour peu qu’elle soit exposée; saison périlleuse où les passions se font sentir avec force; et Dieu sait comme j’en fus bientôt assiégée. J’étais jeune, robuste et en âge de travailler. Comme il m’était impossible de subsister sans ce secours, il me fallut me trouver dans les travaux des campagnes avec des jeunes gens des deux sexes, très libres en actions et surtout en paroles. Avec des passions aussi vives que les miennes, à quoi une jeune fille de cet âge n’est-elle pas exposée dans ces sortes de travaux et d’amusements, pour peu surtout que le démon d’impureté s’en mêle! et il ne manque jamais d’être de, la partie. O que les conversations diaboliques sont dangereuses! Que les jeux et les ris qu’elles occasionnent sont criminels, et que ceux qui y contribuent se rendent coupables sans presque s’en apercevoir!
J’entendais continuellement répéter à mes oreilles ces paroles sales et à double sens, ces mots grossiers ou équivoques qui faisaient sur mon imagination les impressions les plus funestes d’où il arrivait que tout me devenait dangereux, jusqu’aux objets les plus indifférents. Sans cesse mes oreilles étaient choquées et salies par des discours licencieux en tout genre. Tantôt les mots injurieux, tantôt les médisances, tantôt les calomnies ou les faux rapports, et presque toujours l’impureté animaient les conversations de ces jeunes libertins. Jugez comme le démon s’en servait contre moi ! D’abord, je voulus tenir ferme; mais ma fermeté ne tint pas longtemps contre le torrent du mauvais exemple et surtout contre un certain désir de plaire et d’être bien venue, un respect humain qui me faisait craindre comme un grand malheur d’être vue d’un mauvais œil, d’être traitée de bigote, de scrupuleuse, d’hypocrite ou de fausse dévote.
Ainsi, l’orgueil et le respect humain furent les deux armes dont le démon fit usage pour ruiner presque de fond en comble cette réputation de modestie dont je m’étais piquée jusque-là. II est certain que naturellement on n’aime point à se voir rejeté et méprisé de ceux avec qui l’on vit et on a à vivre. Peu à peu mes oreilles s’accoutumaient à entendre les paroles scandaleuses et effrontées qui d’abord m’avaient fait rougir. Ma bouche se faisait même à les répéter. Sensiblement, je devins railleuse, jalouse, impertinente, quoique je ne le fusse encore qu’avec répugnance et une certaine modération. Les passions avaient tellement aveuglé mon entendement, que je ne distinguais plus guère qu’à peine les premières notions de la foi, de la raison et du bon sens. Je croyais, par exemple, qu’il n’y avait aucun mal à médire du prochain, pourvu qu’où ne dit que la vérité. Ainsi, je ne craignais que la calomnie, et j’ôtais la médisance du nombre des péchés…. Cependant on trouva ma vertu plus aimable, parce qu’elle était moins farouche, c’est-à-dire moins éloignée du vice. Ainsi, suivant l’usage trop ordinaire, on me croyait plus vertueuse à proportion que je l’étais moins.
Ses regrets. Vive peinture des dangers auxquels est exposée la jeunesse ignorante, surtout par rapport à la pureté.
Juste ciel ! dans quel excès ne pouvais-je pas donner, si la grâce m’eût tout à fait abandonnée! et dans quel horrible état ne devait pas être devant Dieu une créature assez malheureuse, une conscience assez aveuglée pour s’en tenir à la seule exemption de l’extérieur du crime, sans se mettre en peine de l’intérieur (je veux dire de la pensée, peut-être de la volonté), qui en fait toute l’énormité devant les yeux si purs de l’Éternel !…. Le croiriez-vous, mon Père, et ceux surtout qui, dans le monde, suivent encore un pareil plan de conduite, ne vont-ils pas prendre tout ceci pour les exagérations d’une conscience qui s’alarme mal-à-propos et sans qu’il y ait le moindre danger! Ah! je les en conjure, qu’ils abjurent un moment une maxime si damnable, pour considérer avec moi ce qu’exigent d’une âme chrétienne et son propre caractère et tous les bienfaits dont elle est redevable à l’amour de son Dieu, et j’ose croire qu’ils ne pourront s’empêcher de convenir que j’ai vécu, comme ils le font peut-être eux-mêmes, dans un si fatal aveuglement, qu’il faudrait des larmes de sang pour le pleurer (1).
(1) Quelque dangereux et quelque injurieux pour Dieu que fût en lui-même cet état que la Sœur se reproche, et dont elle s’accuse ici avec tant de repentir, si l’on y fait bien attention, on verra que la grâce et la crainte du Seigneur l’ont toujours retenue dans de certaines bornes; de sorte qu’elle n’a jamais donné, je ne dis pas dans aucun excès criant, mais dans aucune faute ou action criminelle proprement dite. Elle doute elle-même, si elle a jamais eu la volonté d’offenser Dieu; nous pouvons bien en douter comme elle. Ce qu’il y a de sûr, c’est que cet aveuglement fatal, ces erreurs si coupables, ces fautes, ces ingratitudes, ces crimes qu’elle déplore avec tant d’amertume, passeraient presque pour des vertus aux yeux de tant de personnes du monde qui vivent tranquilles et sans aucun remords dans des habitudes infiniment plus criminelles. D’où vient cette différence ? C’est que l’amour et la crainte du Seigneur voient, par le flambeau de la foi, des crimes énormes, des ingratitudes révoltantes, où l’esprit du monde ne découvre que des bagatelles et des légèretés. Lequel des deux est dans l’erreur?
__________________________
(40-44)
Oui, mon Père, je le répète, mon fatal aveuglement est allé jusqu’à compter pour rien les péchés intérieurs. Je croyais bien, par exemple, qu’il y eût eu du mal à voler, à se venger…. je croyais bien qu’il y eût eu du péché à s’enivrer ou commettre l’impureté en action quelconque; mais je ne croyais pas que c’eût été un mal de s’en entretenir volontairement en soi-même, pourvu qu’on s’en fût tenu là, comme je faisais, et qu’on n’eût rien exécuté au-dehors, etc.…
À quoi, je le demande encore, n’est pas exposée tous les jours une pauvre fille ignorante, qui n’a d’autre règle de conduite que des principes aussi faux et aussi damnables ? Qu’opposera t-elle aux dangers qu’offre le monde à chaque pas? Car combien de pièges tendus à son innocence ! Combien de combats à soutenir! De combien de rencontres le démon de l’impureté ne sait-il pas profiter pour attaquer sa frêle vertu !…
Les impudiques, jeunes et vieux, l’attaqueront de toutes les manières, et s’y prendront de toutes les façons pour vaincre sa constance et triompher de sa pudeur. Ils épieront ses démarches et ses paroles; ils étudieront ses inclinations; ils feindront de prendre son parti, d’entrer dans toutes ses vues, de favoriser ses projets, et cela uniquement pour mieux s’insinuer dans son amitié, en la prenant par son faible. Si elle a de la vertu, ils en emprunteront le masque et tâcheront d’en jouer le rôle; si elle n’en marque pas, ils s’y montreront indifférents et diront qu’il faut que chacun soit libre sur cet article et qu’on ne doit gêner personne. Si elle témoigne un certain dégoût, une certaine aversion pour la piété, ils ne manqueront pas d’applaudir à une disposition qui leur est la plus favorable. Ils affecteront aussitôt une force d’esprit, une incrédulité que peut-être ils n’auront point au fond de l’âme, et paraîtront impies déclarés pour en venir à leurs fins.
Oui, mon Père, et qu’on n’en doute pas un moment, il n’est point de personnages si opposés et si contradictoires qu’un impudique expérimenté ne tente pour réussir : s’il s’aperçoit surtout, comme je l’ai dit, que la personne ait de la disposition à devenir incrédule, il ne manquera pas de lui glisser des doutes, en attaquant devant elle les vérités fondamentales de la foi, les dogmes dont la croyance est absolument nécessaire au salut : persuadé qu’il n’a point de moyen plus efficace que d’écarter et d’anéantir les terreurs salutaires de la religion, il la raillera beaucoup sur la crainte de l’enfer ou des jugements de Dieu; il deviendra avec elle sérieux ou enjoué, imprudent ou hypocrite, suivant qu’il le jugera plus expédient à ses desseins, et c’est ce qu’on doit attendre de tous les hommes de ce commerce, qui sont, hélas! bien plus nombreux qu’on ne se l’imagine à l’âge de l’inexpérience et de l’aveuglement.
Oui, ces impudents abuseront tout à la fois, pour la séduire, de sa facilité, de son imprudence, de son ignorance, de sa bonne foi, de sa passion, de sa pauvreté même, en mettant le salut de son âme, ainsi que leur brutalité, à prix d’argent. Combien d’exemples n’en pourrait-on pas trouver, et n’en ai-je pas en moi-même! et quoique, à beaucoup près, on n’en ait, grâces à Dieu, jamais été si loin à mon égard, j’en citerai un seul trait, qui prouve à-peu-près tout ce que je viens de dire. C’est le danger le plus évident où mon honneur se soit jamais trouvé exposé. J’invite les jeunes personnes encore sans expérience à en faire leur profit; elles y verront combien elles ont besoin d’être sur leurs gardes, si elles veulent conserver le précieux trésor de leur innocence, et qu’en général elles ne doivent se fier, sur ce point délicat, qu’à bien peu de personnes, je dirai presque à aucune. Mais, mon Père, comme il est tard aujourd’hui, et que j’ai parlé suffisamment, nous en remettrons le récit à la prochaine séance, si vous le voulez bien. Permettez que je vous quitte.
Sa vertu est attaquée. Force avec laquelle elle s’enfuit et échappe au danger.
« Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par Jésus, etc. »
Il y avait dans notre village un certain veuf, âgé de plus de cinquante ans qui jouissait de la meilleure réputation de sagesse et de probité; on l’eût volontiers regardé comme le plus homme de bien et le meilleur chrétien de toute la paroisse. Depuis un certain temps il avait fréquenté la maison de mon père, et c’était presque toujours quand j’y étais; car si j’étais absente,
__________________________
(45-49)
il s’y arrêtent rarement. Son attention ne me déplaisait pas. J’étais alors âgée de dix-huit ou dix-neuf ans, et d’un caractère très enjoué. On sent bien que je ne devais pas haïr la compagnie honnête. Sans être évaporé, cet homme était encore plus gai que moi; il m’amusait par ses bons mots et par des historiettes qu’il savait raconter avec un certain sel qui ne laissait pas que d’y mettre du piquant, sans jamais sortir des bornes de la décence. Car, mon Père, surtout dans ce temps-là, la moindre liberté en paroles m’eût révoltée; et s’il faut dire le pour et le contre, je dois à la vérité l’aveu que, jamais de ma vie, je n’ai souffert de personne la moindre action tant soit peu répréhensible, la moindre liberté tant soit peu indécente. Oui, je puis dire que la moindre familiarité indiscrète eût bientôt fait congédier un jeune homme, quelque chose qu’il m’en eût dû coûter (1).
(1) Cet aveu sincère de la Sœur suffit, à mon avis, pour montrer sur quel pied on doit prendre tout le mal qu’elle nous a déjà dit d’elle-même, et ce qu’elle nous en doit dire encore.
Ce veuf me témoignait une amitié de pure bienveillance dont on ne pensait aucunement à lui savoir mauvais gré à la maison. Nous étions tous charmés de sa compagnie. Qui aurait dit, mon Père, que cet homme de probité, qui usait de tant de réserve, qui mettait tant d’honnêteté dans ses procédés, portait pourtant un cœur corrompu; qu’il avait au fond de l’âme un dessein pervers, dont je n’avais pas la moindre idée, que mes parents se fussent reproché de soupçonner, et peut-être, hélas! qu’il n’apercevait pas lui-même? Car qui peut comprendre sur ce point l’aveuglement et la misère de l’homme, et combien il lui est facile et ordinaire de se faire illusion?… Combien de fois la seule imprudence n’a-t-elle pas excité un feu qu’on ne connaissait pas, ou rallumé celui qu’on croyait éteint; occasionné, enfin, des incendies, où il ne paraissait pas qu’il y eût eu lieu de rien craindre! Il est bien difficile de se connaître soi-même, et presque toujours on se juge moins coupable qu’on ne l’est en effet.
Un jour il profita d’un moment d’absence de ma mère, pour me dire à l’oreille certaines paroles dont je ne compris pas du tout le sens, et auxquelles il joignit certains gestes que je comprenais encore moins, tant j’étais éloignée d’aucun mauvais soupçon contre lui. Je riais cependant, parce que j’étais en train de rire, et que je prenais tout sur ce pied là. C’était un tort que j’eus; mais la faute était bien matérielle de ma part. C’était simplicité ou bêtise, comme on voudra; mais l’hypocrite ne tarda pas à me prouver qu’il avait pris la chose sur un autre pied, et qu’il avait jugé tout simplement de moi par lui-même. Depuis ce temps il n’épiait que l’occasion de me trouver seule; elle se présenta. Ma mère m’avait, un matin, envoyée garder notre bétail dans un pré situé près la maison de notre veuf. Il vint m’y trouver, et me demanda de mes nouvelles, en m’abordant d’un air jovial. Il s’assît sans façon tout à côté de l’endroit où j’étais assise. Je lui remarquai seulement un air et des paroles beaucoup plus libres qu’à l’ordinaire. Il voulut encore me faire agacer; mais ses badinages, joints à certains mots de cajolerie, me donnèrent des soupçons et me firent suspecter ses intentions. Il voulut me donner de l’argent; il m’offrit des présents; je refusai tout, disant qu’il ne me devait rien; que je n’avais pas besoin de ses présents, et que je ne savais pourquoi il me les offrait.
Pendant que j’évitais son approche, et que je repoussais ses jeux de main, je crus entendre quelqu’un me dire fortement : Sors d’ici, ou bien je t’abandonne; fuis, fuis, le temps presse et le péril est grand pour ton innocence… Cette voix, qui retentit du fond de mon âme, en m’ouvrant tout à fait les yeux sur le danger, me donna, pour l’éviter, une vitesse et une force incroyables de corps, à laquelle, je pense, trois ou quatre hommes n’auraient pas résisté. D’un seul effort j’échappe comme un éclair des mains de ce malheureux dont l’intention n’était plus équivoque, puisqu’il la déclarait nettement (1).
(1) Quelques examinateurs des cahiers m’avoient dit qu’ils avaient trouvé cette aventure un peu trop circonstanciée, aussi bien que quelques autres récits des révélations touchant le sixième précepte, les dangers du mariage, etc. Je rends justice à la pureté de leurs intentions, et je suis très éloigné de mépriser leurs avis; mais ils me permettront de leur dire que je n’ai pas été le seul à penser différemment sur tous ces points. J’ai cru même que Dieu n’avait permis, peut-être même dicté ces détails de la Sœur, que pour le bien spirituel de tant de personnes qui se trouvent dans ces différentes positions, et qui pourront y trouver des règles, des avertissements salutaires, et un modèle de conduite. Faut-il donc attendre, pour être en garde, qu’on ait commis le mal par expérience? et que peut-on risquer à découvrir d’avance la marche ordinaire et les pièges du démon d’impureté, qui ne triomphe jamais mieux que lorsqu’il trouve l’inexpérience jointe à la simplicité? Alléguera-t-on la crainte de les scandaliser, en les instruisant? C’est encore là précisément un piège de cet esprit impur, que cette ignorance favorise plus qu’on ne pense. Au reste, sur ce pied là combien d’endroits des Pères de l’Église, des meilleurs écrivains, et même des saintes Écritures, ne faudrait-il pas retrancher ? La tentation du chaste Joseph, l’attaque que la chaste Suzanne souffrit de la part des deux infâmes vieillards, etc. L’Esprit Saint en a pensé autrement ici, comme là, on peut le suivre.
C’est ainsi, mon Père, que mon imprudence exposa, comme je l’ai dit, mon honneur au plus grand danger où je me sois jamais trouvée, et dont je ne suis sortie, comme vous le voyez, que par un secours particulier, une faveur extraordinaire du ciel. Eh ! combien de jeunes personnes n’y ont-elles fait naufrage
__________________________
(50-54)
que par cette imprudence même, qui ne prévoit point assez le danger, qui ne se défie de rien ? Combien qui ne se sont perdus sans retour que pour avoir traité de bagatelles certaines démarches très imprudentes, certains jeux, certains badinages prétendus innocents, et qui les ont insensiblement conduites du badinage aux privautés, des privautés à la licence, de la licence au crime, du crime à l’habitude, de l’habitude à l’endurcissement, enfin de l’endurcissement à l’abandon de Dieu, qui conduit au dernier des malheurs!
Il est donc bien important, mon Père, d’interdire toute entrée à un ennemi aussi rusé, de ne rien lui accorder de tout ce qu’on peut lui refuser. Avec lui, qu’on me croie, il n’y a ni à délibérer, ni à capituler, parce qu’il ne sait point garder de mesure. Si vous lui accordez un pied de terrain, il en prendra deux, trois, quatre, etc. Enfin, si vous ne le perdez bien vite, tôt ou tard il vous perdra… Que fera donc une pauvre fille sans la défiance, qui est ici, plus que nulle part, la mère de sûreté? Obligée de vivre avec des ennemis jurés de son innocence, que deviendra-t-elle encore une fois, si elle n’est continuellement attentive sur chacune de ses démarches; si elle ne joint sans cesse la prudence du serpent à la simplicité de la colombe? Enfin, le dirai-je sans détour, que de secours ne faut-il pas ! Que de grâces ne lui sont pas nécessaires pour être chaste, au milieu de Sodome; je veux dire au milieu d’un monde corrompu, où tout respire la volupté et fait avaler le poison; surtout en certains états, où les dangers sont encore ce qu’il y a de plus grand !….
Heureusement échappée, et comme par miracle, du plus grand danger de ma vie, je ne craignais plus mon ennemi, soit qu’il eût fallu courir l’attaquer, ou me défendre. J’étais dans une colère où je ne me connaissais plus: voyant que, tout déconcerté, il restait dans le même endroit, sans oser me suivre, je m’arrêtai à quinze ou vingt pas pour l’accabler d’injures et lui dire tout ce qui me vint à la bouche dans le moment de ma fureur. Jamais je n’en ai tant dit à personne; et s’il avait tenté d’user de violence, je crois que j’aurais eu le courage de l’assommer, tant j’étais outrée contre lui. Je lui promis bien de ne jamais me fier à lui sur rien au monde, et je lui ai tenu parole. Que pensez-vous, mon Père, de ma colère et de mes compliments?
Voyant que la Sœur attendait une réponse avant de continuer, je lui hasardai à-peu-près celle-ci : Je pense, ma fille, que dans ce moment votre colère devenait pour vous un devoir indispensable, pour les raisons que vous venez de m’expliquer.
Quant aux injures que vous eussiez pu absolument lui épargner, puisque votre conduite en disait assez, je les regarde comme une forte admonition, une bonne correction, qu’il avait trop méritée et dont il ne tenait qu’à lui de profiter. C’était une petite justice que vous lui rendiez fort à propos, et qui pouvait bien le faire rentrer en lui-même, en lui exprimant d’une manière plus énergique toute l’horreur que vous aviez de son mauvais dessein ; je crois que vous pouvez ne pas vous la reprocher. On doit quelquefois cette espèce d’aumône au prochain, surtout quand il en a un besoin aussi pressant qu’il paraît que celui-ci l’avait. Ainsi, c’est alors un devoir, plutôt qu’un acte de surérogation. Que de libertins eussent été corrigés, s’ils n’avaient jamais eu que de pareilles réceptions ! Mais malheureusement il s’en trouve de plus indulgentes, et qui ont la conscience trop délicate pour se mettre en colère en pareils cas. Cela ne les empêche pas de s’y mettre en bien d’autres rencontres, où il ne faudrait que de la patience; mais dans celle-ci la colère leur semble un trop gros péché.
Revenons à ce qui me regarde, interrompit la Sœur; car, mon Père, j’ai trop de fautes à me reprocher pour m’arrêter à celles dont les autres peuvent aussi se rendre coupables, et je ne dois penser qu’à faire le procès à moi-même. Hélas ! mon Père, il s’en faut encore beaucoup que ma vie libertine soit finie. Reprenons-en donc l’histoire déplorable au point où nous étions avant la digression qui vient de nous occuper.
Défauts que la Sœur se reproche : vanité, dissipation, etc.
Il n’y avait plus en moi de combats qu’entre les différentes passions. J’étais jalouse des richesses et des habits des autres filles, et quelquefois même un peu de la bonne idée qu’on avait d’elles. Je n’évitais guère la compagnie des hommes que par la crainte du déshonneur, c’est-à-dire qu’on en eût mal parlé comme on faisait de quelques autres, et que je n’eusse ainsi perdu la bonne réputation dont j’aimais surtout à me piquer. Quoique j’aimasse la danse, je dansais rarement, parce que je le
__________________________
(55-59)
faisais mal, et de manière à ne point satisfaire ma petite gloriole, ou plutôt ma sotte vanité.
Ainsi c’étaient toujours l’orgueil et l’amour-propre qui dirigeaient toutes mes démarches, et je ne combattais un vice que par un autre, comme le font tous ceux qui ne prennent point la foi pour leur flambeau, ni l’Évangile pour leur règle. J’étais quelquefois dissipée au dernier point. Je lisais de mauvais livres, c’est-à-dire des livres d’amusement, qui avaient été plutôt contraires que favorables à la religion et aux mœurs. J’en ai même une fois prêté à une de mes compagnes; pour quoi je fus bien reprise de mon confesseur. Je ne faisais presque plus de cas d’aucune règle. Ciel adorable! qui aurait dit, mon Père, en voyant tout ce qui se passait en moi, dans ces temps malheureux, que j’étais faite pour être religieuse; que c’était la place que Dieu m’avait marquée, et qu’un cœur comme était le mien, aussi éloigné de sa crainte et de son amour, devait pourtant faire profession d’être à lui pour toujours?… Que vous êtes bon, que vous êtes aimable, ô Dieu des vertus! puissé-je éternellement chanter vos miséricordes infinies, quand vous aurez mis le comble à vos bienfaits, en couronnant vos propres dons! Mais poursuivons.
On pense à la marier. Ses répugnances.
Vous savez, mon Père, que les pauvres filles de la campagne, pourvu qu’elles aient de la force et qu’elles sachent bien travailler, trouvent plus vite à se marier que celles qui sont plus riches, parce qu’il se trouve un plus grand nombre de partis accommodés à leur fortune. Il n’est donc pas surprenant qu’il s’en soit présenté à moi, et même quelques-uns pour lesquels je n’étais point indifférente. Un jeune homme, entre autres, très sage, me convenait davantage et me plaisait beaucoup, sans avoir jamais eu avec lui de conversations bien particulières sur l’article. Je sentais que je l’aimais plus que les autres. On avait fait pour lui, même avant la mort de mon Père, différentes démarches auprès de mes parents. Il y eut des demandes, des sollicitations, des promesses; mais ce qu’il est bon de noter, toutefois qu’il s’agissait d’en venir à quelque vrai accord de fiançailles , il se trouvait toujours de part ou d’autre quelque obslacle imprévu, toujours quelque contre-temps qui rompait la partie et déconcertait tous les projets.
Je dois aussi vous avouer, mon Père, que malgré tout ce que j’ai ressenti de misères humaines, toutes les fois qu’il s’agissait de me parler sérieusement de mariage, j’éprouvais en moi-même un combat terrible, ou plutôt je ne sais quoi dont je ne pouvais me rendre raison, et que personne ne pouvait comprendre, quoique tout le monde s’en aperçut. C’était une certaine répugnance, comme invincible, qui me saisissait tout-à coup, et qui allait jusqu’à m’ôter la respiration et la parole, me faire changer de couleur, et me rendre malade de crainte et d’appréhension.
Je me trouvais donc soulagée en voyant tout manquer, et par une bizarrerie bien singulière je devenais jalouse, jusqu’à perdre la paix, des personnes vers lesquelles les jeunes gens se tournaient à mon refus. Enfin, j’étais déjà pour moi-même une énigme d’autant plus inexplicable, que Dieu ne m’avait point encore fait connaitre les effets de ce combat continuel de la nature et de la grâce, qui fait qu’il se trouve comme deux hommes opposés dans la même personne, surtout quand l’ange de Satan se joint à la nature et s’en sert pour nous souffleter.
Mais, mon Père, indépendamment des lumières que Dieu m’a données depuis sur tout cela, je serai toujours, comme j’ai toujours été, une vraie énigme pour moi et pour bien d’autres.
Je ne vous comprends pas, ma sœur, me disait un jour un de mes confesseurs, vous m’avez parlé de Dieu comme un ange, et vous me parlez de vous-même comme d’un démon; je ne comprends rien à tout cela…. Ah ! c’est que la matière était bien différente, et que de part et d’autre je tâchais de suivre la vérité qui m’était montrée; voilà tout le mystère qu’il ne comprenait pas. Mais reprenons encore le fil de ma triste histoire; car, hélas! mon Père, le temps de ma conversion n’est pas encore arrivé, si toutefois je puis dire qu’il soit jamais venu parfaitement, et si je n’ai pas à craindre qu’il n’arrive jamais, tel du moins que je l’ai toujours désiré.
Fausses idées que la Sœur se formait dans le trouble des passions. Les passions, seul obstacle à la foi.
Dans ce triste état, j’avais l’idée la plus fausse des choses les plus claires et les plus évidentes. J’aurais, pour ainsi dire, méconnu les premiers principes de la loi naturelle, tant mes passions avaient mis le trouble dans toutes les facultés de mon âme; oui, je le dis à ma honte et à mon repentir, mon aveuglement était tel, qu’à l’âge de dix-neuf ans j’avais beaucoup moins de lumières pour discerner le bien et le mal, beaucoup moins de connaissance dans les choses de Dieu et du salut, que j’en avais eu à l’âge de sept ou huit ans. Faut-il s’étonner, après cela, des écarts inconcevables, en fait de croyance, de tant d’hommes distingués par leurs lumières sur tout autre point, quand une fois ils se sont laissés dominer par leurs passions? Monsieur un tel, dit-on, ne croit point, il n’a point de religion, et pourtant il a des connaissances : c’est un bel-esprit, c’est un génie.
__________________________
(60-64)
Tant qu’il vous plaira; mais qu’en voulez-vous conclure ? Quelle induction favorable pouvez- vous tirer de son incrédulité contre les mœurs ou la religion qu’il rejette? Il faudrait, pour en juger sainement, que son esprit fût libre de ce côté-là et pût apercevoir les choses dans leur vrai point de vue. Mais non, la passion chez lui obscurcit l’entendement et les lumières de la raison; elle éteint le bon sens, émousse toutes les facultés naturelles, abrutit l’homme, et en fait, comme dit l’Écriture, une espèce d’animal qui ne comprend rien aux choses de Dieu ni du salut. Ne pouvant s’élever au-dessus de la portée des sens, il n’aime et ne comprend que ce qui y a rapport. Les objets de la foi lui sont étrangers : ce sont pour lui des énigmes où il ne croit voir que des contradictions avec la raison. D’où il arrive assez souvent que les plus beaux esprits sont peuple en fait de croyance, mais encore beaucoup plus enfants, disons mieux, beaucoup plus ignorants que les ignorants eux-mêmes, puisque cette ignorance leur est commune avec les premiers. Ils opposent encore toute la répugnance de leurs passions à admettre ce qui les réprime et ce que la raison ne saurait comprendre. Oui, mon Père, et soyez-en bien sûr, ôtez les passions du cœur humain, vous en ôtez tous les obstacles à la foi, vous le rendez chrétien; ôtez les passions, vous ôtez les incrédules, parce que les passions sont la seule source de leur incrédulité. C’est de quoi j’ai fait une triste expérience (1).
(1) C’est aussi la pensée d’un de nos poètes dans cette belle gradation, où il nous dit: … Que tout libertinage marche avec ordre, et son vrai personnage
est de glisser, par degrés son poison des sens au cœur, du cœur à la raison.
( J.-B. Rouss., épit. à M. Racine).
Je pensais donc, mon Père, et peut-on le déplorer assez ! je pensais que c’était aimer Dieu suffisamment que de ne le pas haïr; qu’on a la foi sans être obligé de croire tous les points de croyance que l’Église propose à ses enfants; qu’on peut se sauver avec la foi générale et spéculative, sans se mettre en peine de la réduire en pratique; que les bonnes œuvres, par conséquent, ne sont point nécessaires au salut; qu’il suffît d’adorer Dieu dans son cœur, sans s’assujétir à aucune pratique de religion; que les vœux du baptême n’obligent point à renoncer aux maximes du monde; que les pauvres et ceux qui souffrent sont malheureux, et qu’il n’y a que les riches qui soient heureux et dignes d’envie; qu’on peut rendre au prochain aversion pour aversion, indifférence pour indifférence, etc.
Ou plutôt, à parler plus exactement, je ne pensais point à tout cela, et je vivais en conséquence, sans y faire presque la moindre attention. Ainsi, je me faisais dans la pratique une espèce d’évangile monstrueux, que je substituais à l’Évangile de J.-C. C’était bien l’Évangile du monde et des passions, aussi favorable à la nature qu’il est contraire à la vraie foi. Voilà pourtant quelle a été ma règle pendant tout ce temps infortuné. J’ignorais absolument quel est l’état d’une âme qui a eu le malheur de consentir au péché. Je n’avais nulle idée de l’offense de Dieu, ni de ses suites par rapport à nous. Je faisais consister l’orgueil dans les richesses et la grandeur, ne pouvant comprendre que les pauvres gens puissent être orgueilleux, quoique j’en fusse un exemple et une preuve très visible à tout autre qu’à moi-même; car, mon Père, je pense qu’il n’y avait que moi seul à ne pas m’apercevoir de ce fond d’orgueil dont j’étais comme pétrie. Je m’imaginais aussi qu’il n’y avait que les riches qui pussent s’attacher de cœur aux biens de la terre, à aimer le monde et la vanité. Que d’illusions ! que d’erreurs !….
Malgré ses égarements, elle remplissait ses devoirs de religion, aimait la parole de Dieu, et fréquentait les sacrements dans les grandes solennités.
Cet aveuglement étrange de mon esprit, cette espèce d’endurcissement volontaire de mon cœur, je les attribue surtout à mon orgueil que Dieu voulait punir, à l’abus des grâces, et aux profanations que ce malheureux orgueil me faisait commettre : car, mon Père, au milieu de mes égarements, je conservais toujours un certain fonds de religion, qui se réveillait surtout aux grandes solennités. J’aimais les cérémonies de l’Église, et sur toutes choses la parole de Dieu. Mais, hélas! l’inconstance de ma volonté rendait en moi ce goût stérile, pour ne pas dire, dangereux. Mon âme, livrée continuellement à la dissipation, à la frivolité, à la bagatelle, ressemblait à ce champ pierreux et de plus ouvert aux incursions de mes ennemis, dans lequel cette divine semence ne pouvait germer, ni jeter de profondes racines. Elle y était donc foulée et écrasée sous les pieds des passants, enlevée par mon orgueil, étouffée par mes inclinations, corrompue et desséchée par le feu de mes passions. Quel état!…
Je l’entendais volontiers, cette divine parole, elle me touchait pour le moment; mais le moment d’après je n’y pensais plus. Ainsi, au lieu de me justifier, elle me rendait plus coupable; au lieu de me convertir, elle m’endurcissait de plus en plus; au lieu
__________________________
(65-69)
d’opérer mon salut, elle devenait la source de ma condamnation. Qu’on est à plaindre, encore un coup, quand on fait un pareil usage des faveurs que le ciel nous accorde! Sur quelle ressource peut-on compter, quand les dernières ressources se tournent contre nous par l’abus que nous en faisons? O le pitoyable état! ô la désespérante situation!
C’est pourtant, mon Père, et l’état et la situation où j’ai passé pendant plus d’une année, gardant toujours l’extérieur et la réputation de fille vertueuse, dont j’étais fort flattée : mettant toute ma perfection dans les dehors de la piété, j’étais jalouse de ne pas manquer à une seule communion de bonnes fêtes ou de confrérie, et je me mettais très peu en peine de m’y bien préparer et d’en retirer du fruit. Prenant aveuglément le fantôme pour la réalité, je me flattais intérieurement d’être dévote et vertueuse, tandis qu’au fond je n’étais guère qu’une hypocrite et un sépulcre blanchi. Je passais ainsi pour vivante aux yeux des hommes, tandis que j’étais morte aux yeux de Dieu. Telle était ma situation, mon Père, lorsque la Providence, qui n’a jamais cessé de veiller sur moi, permit que je fusse frappée d’un trait dont probablement vous n’avez jamais entendu parler, et dont vous n’avez lu ni vu d’exemple en aucun endroit. Mais comme il est temps de finir aujourd’hui, nous en remettrons, s’il vous plaît, le récit, et nous commencerons par-là la séance de demain (1).
(1) Je ne sais ce qu’on en pensera, mais il me semble que les différents portraits que la Sœur vient de nous donner, ressemblent à plus de personnes qu’on ne se l’imagine, et que par conséquent un très grand nombre peuvent s’y reconnaître et en faire leur profit. De quelque part que viennent ces détails, ils ne paraissent ni sans dessein, ni sans utilité.
Trait singulier d’un enfant de trois ans. Effet qu’il produit sur la Sœur.
« Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par Jésus, Marie, etc. »
Un jour de dimanche que ma mère m’avait, pendant qu’elle était à la messe paroissiale, confié le soin de mes petits frères et sœurs, j’allai avec eux chercher la compagnie d’une de mes amies, qui était la fille d’un employé aux douanes, dont la maison était proche de la nôtre. Elle était aussi chargée de veiller sur sa petite famille dans l’absence de ses parents. Nous mîmes tous les enfants ensemble pour s’amuser, et, assises l’une à côté de l’autre, nous voilà de chanter un cantique sur l’amour de Dieu. La petite sœur de ma compagne, âgée de trois ans, avait quitté ceux de son âge pour venir nous écouter de plus près; elle tenait sa main sur mon épaule, et prêtait l’oreille à notre chant avec une attention surprenante pour son âge, et un air d’une joie, d’une satisfaction et d’un intérêt qui nous animait beaucoup, parce qu’il était impossible de ne le pas remarquer; son attitude même, tout annonçait en elle le plus grand contentement.
Le cantique qui lui donnait tant de plaisir, finissait à-peu-près par ces paroles : Et si pour lui nous brûlons en ces lieux, de quels feux donc brûlerons-nous aux cieux ? ou bien par ces autres vers, car je ne me les rappelle pas exactement : Si maintenant nous brûlons de ces feux, de quels feux donc brûlerons-nous aux cieux? C’est toujours la même pensée pour le fond.
Chose inouïe et tout à fait étonnante, mon Père ! à peine ces derniers mots du dernier couplet furent-ils chantés, que, sous nos yeux, l’enfant attentive fut élevée de terre par trois reprises à la hauteur de trois ou quatre pieds, sans faire aucun effort pour sauter, mais se tenant le corps droit, ayant les bras étendus, le visage enflammé et les yeux élevés vers le ciel. Dans cette attitude, comme pour répondre à la fin de notre dernier couplet, elle prononça très distinctement et avec beaucoup de force ces paroles qui firent sur moi la plus vive impression, et qu’elle répéta à chaque reprise qu’elle fut enlevée: Du feu de l’amour! du feu de l’amour! du feu de l’amour! À chaque répétition de ces paroles elle était donc enlevée et retombait doucement autant de fois sans se faire aucun mal : cela se fît successivement et durant un bon instant, après lequel la petite, rendue à elle-même, courut s’amuser et jouer avec les autres, sans qu’il y parût davantage. Il est très probable qu’elle n’en garda aucun souvenir.
Pour ma compagne et moi, nous fûmes si frappées, si interdites, et pour ainsi dire si étourdies de ce que nous venions de voir, que nous restâmes sans parole et que nous nous séparâmes sans faire la moindre réflexion, sans nous dire un seul mot. Ah! mon Père, que de retours cet événement singulier me fit faire sur moi-même, en me rappelant ce que j’avais été autrefois ! Voilà, me disais-je, comme Dieu se manifeste aux cœurs purs, tandis que les autres sont privés de ses faveurs! Je l’ai vue, cette âme innocente et si agréable à ses yeux, s’enflammer par des paroles qui ne faisaient pas la moindre impression sur moi, qui ne touchaient point la dureté, l’insensibilité de mon cœur. 0 qui me rendra ma première innocence! qui me redonnera cet heureux temps où je sentais aussi la présence de mon Dieu, où son amour se faisait sentir à moi où je jouissais de ses plus
__________________________
(70-74)
intimes familiarités ! Temps précieux, tu n’es plus !…. Jours fortunés, qu’êtes-vous devenus? que suis-je devenue moi-même? O source de larmes amères! ô sujet intarissable de repentirs cuisants et peut-être éternels ! c’est par ma faute que j’ai tout perdu ! Par une juste substitution Dieu retire ses grâces à ceux qui en abusent, pour les donner à d’autres qui n’y mettent aucun obstacle….
Souvent, il est vrai, je me livrais à ces réflexions salutaires; mais elles n’étaient encore que des dispositions un peu moins éloignées à mon entière conversion, qui n’arriva que quelque temps après. Il fallait quelque chose de plus pour détruire le règne du démon et fixer le triomphe de la grâce dans un cœur presqu’abruti par le péché: c’est à quoi la miséricorde divine travaillait depuis longtemps, sans se rebuter jamais de mes résistances, et depuis longtemps aussi l’ouvrage avançait comme à mon insu, et pour ainsi dire malgré moi. Il arriva enfin cet heureux moment où Dieu parla en maître et déclara nettement cette volonté à laquelle rien ne résiste; cette volonté qui, sans gêner le libre arbitre de l’homme, se sert des obstacles mêmes pour venir à bout de ses grands desseins. Elle seule opéra en moi ce changement essentiel, auquel une grâce prévenante m’avait disposée depuis si longtemps.
Nouvelle conversion de la Sœur à l’occasion du grand jubilé de 1751. Elle se donne toute à Dieu. Mort de sa mère.
Ce fut encore, mon Père, l’année d’un grand jubilé ou d’une indulgence générale plénière, qui mit la dernière main à l’œuvre de ma conversion commencée à pareille époque, en répandant cette surabondance de grâces où le péché avait abondé. Je sentais mon besoin plus que jamais, et j’étais trop bourrelée par ma pauvre conscience pour ne pas saisir encore cette nouvelle occasion de revenir à Dieu: je me résolus donc encore de me préparer avec tout le soin possible à gagner l’indulgence plénière du jubilé. Eh! quelle grâce n’était-ce pas déjà que cette disposition ! Pendant tout le temps que durèrent nos stations je me confessai chaque jour, et ce fut trois jours avant que de finir ma revue, que le ciel, pour triompher enfin de ma résistance, me frappa du coup salutaire qui me terrassa, comme Saint-Paul, sur le chemin de Damas. Il versa sur moi, à cette heureuse époque, une grâce si forte et si abondante, qu’elle triompha de tout. À l’instant tout obstacle fut renversé, toute difficulté disparut ; il fallut céder au vainqueur qui ne pouvait plus souffrir qu’on lui disputât la victoire. Moment fortuné, que ne venais-tu plus tôt!
J’étais alors âgée d’environ vingt ans et demi, et cet heureux coup du ciel arriva un jour pendant que j’étais occupée, avec ma mère et mes sœurs, à cueillir du chanvre dans un friche ou verger, tout voisin de notre maison et joignant notre aire à battre le grain. Ce fut là, mon Père, que je me sentis tout à coup pénétrée et comme inondée d’une lumière vive et douce qui éclaira mon esprit et changea mon cœur. Elle fixa enfin mon inconstance en m’apprenant ce que voulait de moi le Dieu qui m’allait pardonner tout le passé et me rendre enfin toutes ses bonnes grâces.
Sans balancer un moment, je lui promis d’être désormais à lui pour toujours et de ne plus jamais partager mon cœur. Je rougissais de ma conduite passée, et je conçus tant d’horreur pour toute espèce de péché, que, sans oser penser encore à me faire religieuse (hélas ! je n’en voyais aucun moyen), je renonçai sur-le-champ au monde et à tous les dangers qu’il fournit. Je promis à Dieu de m’en séparer autant qu’il me serait possible; et pour cela, je me proposai de rester avec ma mère, pour la servir et l’assister de mon travail jusqu’à la fin de ses jours ou des miens; ce qui n’alla pas loin. Le ciel, qui n’a jamais permis que j’aie vécu sans affliction, m’avait réservé la plus sensible pour cette circonstance : ma pauvre mère mourut précisément dans le temps qu’elle pouvait espérer d’être plus heureuse, et où je me proposais de la consoler et de la dédommager de tous les chagrins et de toutes les peines que je lui avais occasionnés. Espérons que le bon Dieu aura bien voulu se charger de l’en consoler et de l’en dédommager par lui-même, et qu’elle n’y aura rien perdu.
Elle s’impose des jeûnes et d’autres mortifications, et fait vœu de chasteté perpétuelle.
Pour satisfaire à la justice divine et prévenir les révoltes de la chair, je promis de jeûner tous les vendredis et mercredis, et de pratiquer encore d’autres mortifications chaque semaine; mais, afin de mieux triompher du démon de l’impureté, je me proposai de faire le vœu d’une chasteté perpétuelle, et je voulus le prononcer devant l’image de Notre-Dame-des-Marais (1) le jour de l’Assomption, qui était précisément celui où je me proposai de communier pour gagner mes indulgences du jubilé.
(1) C’est une image de la Sainte-Vierge, placée dans une chapelle, à l’entrée latérale de l’église de Saint-Sulpice de Fougères. Elle est fort célèbre dans le pays par les vœux et les pèlerinages qu’on y fait, les consolations et faveurs qu’on y reçoit.
Je m’y rendis à cette intention, et le même jour j’entendis deux messes à Saint-Léonard et une à Saint-Sulpice, qui me parurent bien courtes, je vous en assure. Il m’est impossible de vous exprimer combien, pendant ces messes
__________________________
(75-79)
et ma communion, Dieu me fit goûter de douceurs; combien il me donna de consolations intérieures sur mon état actuel et passé; combien il m’éclaira sur les mystères de la religion, et surtout la présence réelle de J.-C. au Saint-Sacrement de l’autel! etc., etc.
Bonheur qu’elle goûte dans le service de Dieu.
Enfin, mon Père, je recommençai à respirer et à vivre, et je sentais qu’il n’est point, qu’il ne peut être de vrai bonheur, sans la paix intérieure de l’âme, et que cette paix de l’âme, si désirable, ne se peut jamais trouver que dans une conscience exempte de reproches, dans le sentiment intime d’un cœur qui éprouvé qu’il est tout à son Dieu, et que son Dieu est tout à lui; un cœur enfin qui ne brûle plus que des flammes de son amour… Absorbée dans ce Dieu bon et miséricordieux au-dessus de tout ce qu’on peut dire et imaginer, je sentais sa divine présence, et j’étais tout inondée des délices ineffables que cette divine présence me communiquait. Ô bonheur !…. mon Dieu était rentré dans tous ses droits. J’étais heureuse, parce que j’étais toute à lui, et qu’il était tout à moi… Quand la mort de ma mère ne serait pas venue troubler un état aussi désirable, je pense, mon Père, qu’il ne pouvait durer longtemps, parce qu’il n’est pas dû aux malheureux mortels, dont le sort est de gémir dans cette vallée de larmes; il ne peut être que la récompense et l’apanage de ceux qui l’ont mérité à force de travaux, de combats et de victoires; et quand il a plu à Dieu de m’en favoriser, je l’ai toujours regardé et reçu de sa part comme une vraie indulgence pour ma faiblesse, ou, si vous aimez mieux, comme un encouragement à mieux souffrir les croix et les tribulations qui ont assiégé tous les instants de ma pauvre existence, et que sa bonté me réservait encore pour l’avenir.
Ayant renoncé à tout établissement, mais d’un autre côté n’ayant pas de quoi vivre sans être obligée de servir, et par conséquent de rentrer dans les dangers dont j’avais fait vœu de m’éloigner, on doit bien penser quel coup me porta la mort de ma mère. Quand je ne l’aurais envisagée que sous ce rapport, il y avait, comme on dit, de quoi perdre la tête, si Dieu n’eût eu la bonté de modérer ma peine de la manière que je l’ai dit.
Sa triste situation après la mort de sa mère; elle a recours à la sainte Vierge.
Ne sachant presque quel parti prendre, je me retirai d’abord avec ma sœur cadette chez une tante très âgée, qui nous manqua bientôt à l’une et à l’autre. Après donc que la mort nous l’eut enlevée, j’eus recours à celle de toutes les créatures en qui j’avais le plus de confiance : je me rendis à Saint-Sulpice, et, prosternée devant la sainte image de Notre-Dame-des-Marais, je lui dis : « Vierge sainte, ma bonne et respectable mère, car je n’en ai plus d’autre que vous, je vous en conjure, ne m’abandonnez pas quand tout m’abandonne ; je vous ai fait dépositaire de mes vœux. Oui, Vierge incomparable, c’est entre vos mains et sous vos auspices que je me suis consacrée à votre divin Fils; obtenez-moi donc, de grâce, les moyens d’être fidèle à mes résolutions. Chargez-vous de cette affaire, et je serai contente; jamais je n’en désespérerai, pourvu que j’aie seulement lieu de croire qu’elle est entre vos mains. » J’ajouterai seulement que j’en reçus dès l’heure même une certaine consolation qui me parut comme un gage de la protection de Marie, une assurance qu’elle avait écouté favorablement ma prière, et que je pouvais tout en espérer; ce qui me tranquillisa beaucoup.
Mes deux sœurs et moi, nous étions convenues de nous trouver à la retraite spirituelle de la Pentecôte, qui devait se faire au faubourg Roger de Fougères. Nous y allâmes : c’était là, si je puis le dire, où la sainte Vierge m’attendait, pour me faire encore mieux entrevoir l’effet de ma prière et les grands desseins que Dieu avait sur moi.
Son attrait pour la vie religieuse. Songe qu’elle avait eu très souvent à ce sujet.
Me voir associée pour la vie à quelque communauté religieuse, pour y vivre éloignée du monde en qualité de servante, était depuis longtemps l’objet de mes désirs; mais le peu d’apparence que je voyais d’y pouvoir réussir, ne m’avait encore permis de m’en ouvrir à personne; cependant je m’y trouvais continuellement portée par un goût particulier et une inclination naturelle que réveillait sans cesse un certain songe que je vais vous raconter, et qui m’était arrivé déjà plus de cent fois, à commencer dès l’âge le plus tendre; le voici, vous allez en juger:
Très souvent, mon Père, quand j’étais endormie, je m’imaginais être environnée et assaillie par des bêtes féroces, qui cherchaient à me dévorer ou à me faire tomber dans quelque précipice; des ennemis acharnés, qui en voulaient moins à ma vie qu’à mon innocence et à mon salut. Il ne me restait qu’une ressource contre leurs poursuites importunes et leurs pièges multipliés, c’était d’implorer le secours du ciel quand il n’y avait plus aucun autre moyen d’échapper. Je le faisais tout éplorée, et alors, mon Père, je me sentais élevée, comme avec deux ailes, à une hauteur où mes ennemis ne pouvaient atteindre; et, échappée à leur fureur, je planais dans les airs comme une colombe; j’étais portée par un bras
__________________________
(80-84)
invisible. Quelquefois le trajet était assez long; mais ce qu’il y a de bien particulier, c’est que le terme de ma course, ou plutôt de mon vol, était toujours de tomber doucement dans une communauté de filles, et l’endroit où je mettais d’abord le pied en tombant était toujours leur église, où je me prosternais devant le Très-Saint-Sacrement, qui m’était indiqué comme l’asile assuré contre tous mes ennemis, et le port où je devais tendre sans cesse pour en triompher plus sûrement.
Qu’on pense de ce songe, et de bien d’autres semblables, tout ce qu’on voudra; qu’on tâche, si l’on veut, de les expliquer par des raisons toutes naturelles, je ne m’y oppose point; mais ce qu’il y a de bien sûr, et ce qui me paraîtrait bien difficile de faire cadrer avec cette opinion, c’est que ce songe m’est arrivé plusieurs fois à un âge où je n’avais ni ne pouvais avoir aucune connaissance de l’état religieux; voilà le fait. Je dirai plus encore : c’est qu’à cet âge-là même, rêvant une fois que j’étais au terme ordinaire de mon vol, je fus bien surprise de me trouver toute grande devant l’autel, et habillée précisément comme je le suis maintenant, moi qui n’avais jamais encore vu de religieuses, qui peut-être n’en avais jamais entendu parler, et qui, bien certainement, n’avais encore aucune idée de leur costume. Cependant je me voyais grande comme je suis, vêtue comme je suis, en religieuse Urbaniste, prosternée devant l’autel de cette même église où je n’avais jamais entré. J’étais déjà fille de saint François et de sainte Claire. Ce songe a cessé sitôt que j’ai eu le bonheur d’être revêtue réellement du saint habit de religion; c’est-à-dire, pour parler suivant ma façon de prendre les choses, quand la figure a eu son accomplissement. Mais nous n’en sommes pas encore là.
Autre songe, dans lequel saint François l’appelle dans son ordre.
Je me rappelle aussi un autre songe qui pourrait bien avoir la même signification, et que j’eus encore dans le temps dont nous parlons; je crois vous en avoir parlé ailleurs. Je songeai entendre la voix d’un grand prédicateur: comme j’étais hors de l’église où il prêchait, je montai sur quelque chose pour l’entendre mieux et le voir un peu par une fenêtre grillée. C’était notre Père saint François qui prêchait avec force des religieux et religieuses de son ordre, à qui il reprochait le refroidissement et leurs infractions à la règle. Le saint prédicateur m’aperçut en prêchant; et faisant un geste vers moi, comme pour m’apostropher, j’entendis qu’il me disait : « Puisqu’il n’y a presque plus d’obéissance ni de fidélité dans les miens, eh bien! que les étrangers en prennent la place. Venez à moi, fille d’Égypte, venez par votre fidélité me consoler de l’ingratitude et de la tiédeur de mes propres enfants. »
J’ai donc pris encore pour une marque de vocation ces paroles que saint François m’adressait : Venez à moi, fille d’Égypte…. Je suis même très persuadée que plusieurs autres penseront comme moi à cet égard; mais comme il s’en trouve toujours de plus intelligents, et qui se piquent de donner raison de tout sans avoir besoin du concours de Dieu, ni de l’ordre surnaturel, je leur abandonne volontiers cette occupation, si elle peut les satisfaire, et j’en reviens à mon but; car, quoi qu’il en soit de ces songes, comme de l’explication ou de la tournure qu’il leur plaira d’y donner, ce qui n’avait alors aucune apparence s’est pourtant effectué, malgré tous les obstacles que le monde, le démon et la chair ont pu y apporter. Au reste, mon Père, vous jugerez mieux par les détails à qui l’on doit attribuer ma vocation à l’état religieux et mon entrée dans cette communauté. Tout cela fut la suite de ma retraite du faubourg Roger; mais je pense que nous ferons bien d’en remettre la narration à ce soir ou à une autre fois. Qu’en pensez-vous, mon Père?
Elle est admise dans la communauté des Urbanistes de Fougères en qualité de servante des pensionnaires.
« Au nom du Père, du Fils, etc. »
Mon Père, je m’ouvris sur tout cela à M. Debrégel, alors supérieur de la retraite, que j’avais choisi pour mon directeur : ce fut à cet ouvrier zélé pour la gloire de Dieu et le salut des âmes que la Providence voulut m’adresser, afin de lui rendre compte de mon intérieur. M. Debrégel ne jugea pas à propos que je lui fisse une confession générale, comme je le désirais, disant qu’il ne fallait pas les renouveler si souvent; et il se contenta donc de me faire les questions qu’il jugea nécessaires pour avoir une juste idée de ma conscience et de mon état. Ensuite il me prit à tâche, et je trouvai dans cet homme apostolique un vrai père, qui mit tous ses soins à seconder les desseins de la Providence, qu’il me déclara lui-même d’une manière qui n’était point équivoque. Il me servit de guide jusqu’à sa mort, me recommandant toujours de ne pas mettre d’obstacle aux volontés du ciel, et d’être bien fidèle à la grâce, parce que, disait-il, je lui étais plus redevable que personne.
Ce M. Debrégel avait beaucoup d’ascendant sur l’esprit des religieuses Urbanistes, dont il dirigeait un certain nombre; il me proposa à elles pour être admise dans la communauté en qualité de servante des pensionnaires: c’était
__________________________
(85-89)
justement la première année qu’on leur permettent d’en avoir, c’est-à-dire en 1752, autant que je puis me le rappeler. Ce fut donc sur sa recommandation que je vins ici, par provision, pour servir les pensionnaires, premièrement au-dehors, en attendant que le chapitre eût pris un parti sur mon compte.
Pendant les six semaines que je restai au dehors, il y eut bien des troubles au-dedans à mon sujet; il semblait que tout s’opposait à mon bonheur. Les religieuses se partagèrent, les unes voulant m’admettre, et les autres me rejeter et me renvoyer. Avoir admis des pensionnaires, disaient les dernières, c’est déjà une infraction à notre règle; admettre une personne de plus pour les servir, ce serait s’en écarter encore davantage…. Quatre ou cinq chapitres furent tenus successivement, et l’on conclut enfin que madame l’abbesse ne pouvait m’admettre qu’à la condition de passer au-dedans comme une sœur de plus, ou plutôt comme une aide des Sœurs pour le service de toute la communauté. C’était précisément ce que je désirais, et je reconnus avec une agréable surprise que la sainte Vierge s’était servie des obstacles mêmes pour produire l’effet que le démon voulait empêcher.
Six semaines après, elle y entre comme Sœur converse postulante.
Je fus donc admise au-dedans comme Sœur postulante; il me semblait que je voyais le ciel ouvert, je tressaillais de joie, sans en rien laisser paraître, et je crois que je n’eusse pas laissé d’en ressentir, quand bien même j’eusse prévu tout ce que j’aurais dans la suite à souffrir, et de combien de manières le démon devait s’y prendre pour ébranler ma constance, empêcher l’émission de mes vœux, et détruire absolument ma vocation, s’il eût été en son pouvoir… Me voilà donc enfin entrée dans cette maison religieuse que j’avais tant désirée, et dans l’état où j’avais tant aspiré, que le ciel m’avait indiqué dès l’enfance de tant de manières.
D’abord, on peut bien dire que j’étais novice dans toute la force du terme: avant même que d’être au noviciat, tombée, pour ainsi dire, dans un monde tout nouveau, j’étais si nouvelle, si neuve sur tous les points, que les termes les plus en usage de la religion étaient de l’algèbre pour moi. Quand on me parlait de spiritualité, de recherche, ou d’abnégation de soi-même, d’abandon à Dieu…. de postulat, de coulpe, d’obédience, d’ouvroir, de parloir….. de guimpe, c’était parler grec ou hébreu; j’étais bien souvent obligée de me taire, quelquefois de ne pas répondre, de peur d’apprêter à rire par des contre sens qui auraient pu aller jusqu’à former des hérésies monastiques, faute de savoir les termes propres de chaque chose.
J’entendais les religieuses parler de ma vocation, et je ne savais ce qu’elles voulaient dire; j’aurais mieux compris, si elles avaient parlé du goût ou de l’inclination pour être religieuse, ou du désir de le devenir. Un jour, je demandai à une sœur où étaient actuellement les religieuses de chœur. Elle me répondit qu’elles étaient à l’oraison; je m’imaginai qu’elles étaient à lire une oraison comme celles que j’avais dans mes Heures; mais j’eus bientôt occasion de les y voir; je remarquai qu’elles étaient toutes à genoux, sans rien dire, plusieurs les yeux fermés, avec un air pensif et réfléchi. Alors, mon Père, je soupçonnai que leur esprit était appliqué à quelque chose de sérieux; que vraisemblablement elles pensaient à Dieu; qu’elles s’entretenaient avec lui, et qu’il se communiquent à elles dans ce moment, comme il s’était communiqué à moi dans tant de rencontres de ma vie, où je m’étais trouvée et où je me trouvais encore très souvent, tout occupée de lui, sans pouvoir m’en distraire ni penser à autre chose. Sans doute, me disais-je, que c’est là ce qu’on appelle faire l’oraison. J’en jugeai donc par moi-même; car Dieu avait aussi sa méthode pour me faire méditer, et cette méthode est celle que j’ai toujours suivie. Il ne me manquait que le temps (1).
(1) Après tout ce que nous avons vu , il me paraît qu’on peut assurer, sans beaucoup de témérité, qu’aucune de ces bonnes âmes ne faisait des oraisons aussi sublimes, ni aussi profitables que l’étaient celles de cette pauvre fille qui ignorait jusqu’au nom d’oraison : tant il est vrai qu’en matière de spiritualité surtout, les noms, les définitions, la méthode, la science ne sont rien, et que le sentiment seul que produit l’Esprit-Saint, est tout. Opto magis sentire compunctionem quàm scire ejus definitionem. (De Imitât., cap. 1).
Son zèle pour les travaux les plus pénibles.
Comme j’étais très contente de mon sort, je me livrai toute entière au service de mes Sœurs et de toute la communauté. Dans ce temps-là, je ne manquais ni de force, ni d’activité, je puis ajouter ni de bonne volonté pour tout ce qui était de mon devoir. Mes mains étaient endurcies, mes bras domptés aux durs travaux de la campagne, et tout mon corps accoutumé aux pénibles exercices. Dieu sait comme on en profitait! Jamais ma vie n’avait été plus laborieuse que dans la communauté : tout ce qu’il y avait de plus rude à faire m’était réservé; et, s’il y avait une obédience difficile, ou un fardeau un peu plus lourd à porter, soit à la basse-cour, soit à la cuisine, il fallait toujours que la pauvre Sœur de la Nativité y prît par un bout ou par l’autre. Je puis dire, mon Père, que je m’y portais avec une facilité qui faisait juger qu’on me faisait plaisir de m’y appeler.
__________________________
(90-94)
Non contente de soulager les Sœurs converses, suivant ma destination, je rendais encore tous les services que je pouvais aux dames de chœur, qui ne laissaient pas d’avoir souvent recours à moi: ce qui ne tarda guères à m’attirer un rude contre-temps, car je devais être éprouvée de bien des manières.
Persécution qu’elle éprouve six mois après son entrée, de la part de quelques-unes de ses Sœurs. Sa patience pendant cette longue épreuve.
Il y avait six mois au plus que je jouissais ainsi, à force de bras, si on peut le dire, de l’estime de toute la communauté, lorsque le démon se servit de la jalousie de certaines Sœurs pour me susciter une tempête dont peut-être j’avais besoin. Je puis bien, mon Père, vous le dire en confiance. Dieu sait que je ne leur en ai jamais voulu pour cela, et que je leur en veux aujourd’hui moins que jamais. Elles sont toutes mortes; vous ne les avez point connues, et je ne vous en nommerai aucune. Ainsi, je ne pense pas que la charité puisse être blessée d’un récit qui entre comme nécessairement dans le compte que je vous dois.
Dieu permit donc, mon Père, sans doute pour m’éprouver, que deux Sœurs converses, entre autres, devinssent un peu jalouses des services que je rendais aux religieuses de chœur, aussi bien que de l’amitié que toutes les religieuses et madame l’Abbesse elle même avaient la bonté de me témoigner (1). Une d’elles, entre autres, qui était alors dépensière, avait, m’a-t-on dit depuis, pris à tâche d’éprouver à tout propos et ma patience et ma vocation. Si cela est, elle méritait assurément bien des éloges, et je lui dois bien des obligations; car pendant un assez longtemps elle s’acquitta fort bien de sa commission. Après les reproches et les chagrins, on alla jusqu’à la persécution: je n’avais jamais bien dit, ni bien fait; si je gardais le silence, c’était humeur; si je disais quelque chose pour me justifier, c’était orgueil, ou à tout le moins amour-propre; si je faisais ma coulpe en avouant ma faute, c’était hypocrisie; j’étais comme la bête noire qu’on ne voit jamais que de mauvais œil et du mauvais côté. Enfin, peu s’en fallut dans un temps que toutes les religieuses ne fussent contre moi.
(1) J’ai déjà dit que depuis très longtemps le respect et la vénération des religieuses pour elle étaient toujours allés en augmentant : j’ajoute maintenant, de la part de toutes celles qui vivent encore, que, dans le temps même dont parle ici la Sœur, elle jouissait de l’estime de toutes, sans même en excepter celles qui la persécutaient.
Contre tant d’assauts et le découragement qui devait naturellement en être la suite, je n’avais que la lumière divine et les consolations intérieures qui, comme nous le verrons, n’étaient pas peu de chose, conjointement avec les avis de mon sage et respectable directeur, qui me venait très souvent voir pour m’exhorter à la patience et m’encourager à passer sur tout et à souffrir tout avec constance et résignation : ce que je tâchais de faire par obéissance et par amour pour Dieu.
Ainsi se passèrent mes deux années de postulat; mais, mon Père, j’oubliais que je ne dois vous entretenir ici que de ma vie intérieure. Revenons-y donc et ne pensons plus à ces petits déboires dont pourtant je ne vous ai parlé qu’autant qu’ils y ont de rapport. N’y pensons, vous et moi, que pour prier pour celles qui en furent moins la cause que les instruments, et encore sans le vouloir absolument peut-être, ou du moins croyant bien faire en tout cela. Avouons encore, mon Père, que j’en avais besoin, et que Dieu très-probablement l’a permis pour des raisons qui devaient tourner à mon avantage.
Elle est favorisée du don de la présence de Dieu. Apparitions de J.-C.
Pendant tout ce temps, mon Père, ma pauvre petite dévotion alla comme elle put; malgré tous les troubles que mon esprit en ressentait, je perdais la présence de Dieu le moins qu’il m’était possible: car il me semble que Dieu voulait me dédommager et me soutenir contre les assauts qu’on livrait à ma constance: jamais je n’avais encore été si fréquemment favorisée du Ciel. La présence divine se faisait sentir à moi au milieu des occupations les plus dissipantes, et souvent j’étais tout à Dieu, quand on me croyait tout à mon travail. Combien de fois il s’est rendu sensible à mon âme! Combien de fois il a parlé à mon cœur!
Que vous dirai-je, mon Père? et croirez-vous bien que plusieurs fois notre adorable sauveur Jésus-Christ s’est laissé apercevoir à moi-même par les yeux du corps, je crois pouvoir l’assurer; tantôt sous la forme d’un petit enfant parfaitement beau, pour me toucher par ses larmes et me gagner par ses caresses; tantôt prenant l’air et le ton d’un jeune homme, il me suivait jusques dans notre cellule, en me rappelant ce qu’il avait fait pour moi, et me reprochant quelquefois mon peu de reconnaissance et de fidélité. « Combien d’âmes en enfer, me disait-il, qui fussent parvenues à une sainteté éminente, si je leur avais accordé la moitié seulement des faveurs dont je t’ai comblée, et dont il faudra me rendre compte! etc. etc. »
J’étais alors si pénétrée de confusion, de crainte et d’amour, que je n’avais pas la force de lui répondre. Alors, pour me rassurer, il me parlait d’un air de bonne amitié qui me rendait la confiance; il me disait, par exemple, qu’il fallait me consoler et ne pas perdre courage ; qu’il ne me retrancherait pas
__________________________
(95-99)
ses faveurs, qu’il ne me retirerait pas ses grâces, si je voulais lui promettre d’être plus fidèle à l’avenir…
Autant de paroles, autant de traits de lumière dont j’étais éclairée et comme accablée; chacun de ses regards pénétrait le fond de mon âme: interdite et hors de moi-même, je ne savais bien souvent ce que je devenais devant lui. Jugez de la position où me mettait une conduite si étonnante de sa part!…. D’un côté la crainte de l’illusion, de l’autre celle de la défiance injurieuse, me jetaient dans un trouble et un embarras dont il semblait quelquefois comme s’amuser. Est-ce bien vous, ô mon Dieu! lui disais-je un jour qu’il me parlait de la manière la plus touchante? est-ce vous, mon Sauveur et mon Dieu? car si c’est vous, je vous prie de me pardonner la crainte où je suis d’être le jouet de l’illusion. Alors, mon Père, il me tendit la main, en m’adressant ces paroles qu’il dit à ses apôtres, quand ils le prirent pour un fantôme après sa résurrection : « Ne craignez rien, c’est moi-même….»
Épreuves de son confesseur pour s’assurer de là vérité de ces apparitions.
Un jour, mon confesseur ne sachant que penser de tout ce que je lui avais rapporté de ces différentes apparitions, m’ordonna de lui demander à la première fois le sens d’un certain passage très obscur des saintes écritures. Je n’osais prendre cette commission sur moi, crainte de n’en avoir ni la hardiesse, ni assez de mémoire pour me souvenir des mots. Jésus-Christ voulut bien suppléer à ma timidité et subir l’épreuve qu’on désirait. Allez, ma fille, m’a-t-il dit en m’abordant, dites à votre directeur que l’endroit de l’Écriture dont il désire l’explication, signifie telle et telle chose, qu’il me dit. Ce passage, ajouta Jésus-Christ, a été écrit dans telle circonstance, par tel auteur qui avait alors telle idée dans l’esprit… Je rapportai mot pour mot à mon directeur tout ce qui m’avait été dit, et dont je perdis aussitôt après le souvenir. Je me rappelle seulement le fait en gros, et que mon confesseur me dit dans le temps que cette explication était la plus satisfaisante qu’il eût encore vue nulle part sur cet endroit obscur.
Hélas! mon Père, le même confesseur n’eut pas lieu d’être aussi satisfait d’une autre commission dont je fus chargée de m’acquitter envers lui. C’était une petite admonition qu’il me coûta beaucoup de lui notifier, d’autant que je prévoyais bien qu’il devait en être mortifié. Il reçut pourtant mon avis avec beaucoup de soumission à la volonté divine. C’est tout ce que je m’en rappelle; car aussitôt après ma commission faite, Dieu m’ôta encore le souvenir de tout ce qu’il m’avait chargée de lui dire. Voilà donc tout ce je puis attester à cet égard.
Il est vrai, mon Père, et Dieu me l’avait assez fait entendre, je devais successivement passer de la paix au trouble, et de l’orage à la sérénité; de la lumière aux ténèbres, et des ténèbres à la lumière : mais, comme le doute ne détruit pas l’évidence, ni l’illusion la vérité; comme le nuage le plus épais ne peut qu’obscurcir le soleil lui-même, une certaine lumière ou rayon qui pénètre le nuage, suffit pour nous persuader de son existence , malgré l’obscurité qui le dérobe à nos yeux. Eh bien! mon Père, il en est tout exactement de même du soleil des esprits que de celui des corps.
Différence entre l’opération de Dieu et celle du démon. Effets de la présence de Dieu dans l’âme.
Quelle différence entre l’opération de Dieu et l’œuvre du démon! et que l’âme qui les éprouve se trouve différemment affectée à l’approche de l’une et à l’approche de l’autre !…. C’est, mon Père, ce que j’ai déjà eu occasion de vous faire remarquer plus d’une fois, et sur quoi je ne puis me dispenser de vous dire encore quelque chose, en parlant de mon intérieur, vu que l’ange de ténèbres, comme nous l’avons déjà expliqué, a souvent tenté de me faire prendre le change, en se transformant en ange de lumière. À l’approche du démon, ce n’est que doutes, inquiétudes, ténèbres et frayeurs, découragements, etc.; voilà l’orage, c’est l’œuvre de l’esprit méchant qui porte partout le désordre, la confusion, le trouble et l’enfer.
Au contraire, quand c’est Dieu qui approche, on ressent un calme, une douce tranquillité, une paix profonde que l’illusion ne produit point, et dont le prestige ne peut même approcher; une lumière douce et vive qui pénètre l’âme sans aucune contrainte, y porte la conviction de la présence divine, et semble dire aux passions agitées : taisez-vous, voici le Seigneur. Alors il se fait un calme profond, une paix que rien ne peut troubler, et c’est dans ce silence des sens, que le goût et l’odeur de la divinité se font sentir intérieurement à l’âme, mais d’une manière qu’il est impossible de bien rendre par aucune comparaison. Les liqueurs les plus excellentes, les parfums les plus exquis, les couleurs les plus vives, les concerts les plus mélodieux n’ont rien qui en approche, parce que Dieu n’a aucun rapport avec les sens corporels.
Cependant on le sent, on le touche, on le goûte, on l’entend; mais tout cela se passe dans le fond du sens intime. Dieu est intimément uni à l’âme; elle jouit alors du souverain bien, qui consiste dans la possession de son Dieu. C’est un écoulement du paradis. Que dis-je? on est soi-même un paradis
__________________________
(100-104)
vivant et animé. L’âme vit de son Dieu, et son Dieu vit en elle; et voilà en deux mots tout le bonheur des saints, au-delà duquel on ne peut plus rien imaginer.
Un seul mot prononcé de la part de Dieu dans l’âme a des sens infinis.
Dans cet heureux temps, mon Père, l’âme se livre aux transports que lui fait éprouver la présence de son Dieu, qui s’empare de toutes ses puissances, pour se les unir intimement. Quel comble de bonheur ne se trouve pas dans cette union ineffable d’une créature avec cet Être par excellence qui est tout à la fois son principe et sa fin dernière, en la possession duquel elle trouve sa parfaite et bienheureuse existence, son éternel et souverain bien! Heureuse du bonheur de son Dieu, cette âme fortunée prête l’oreille aux délicieux accents de sa voix qui l’enchante; elle nage dans un torrent de pure volupté, etc.; et voilà encore une fois, mon Père, d’où il faut partir pour bien entendre les mots que je vous ai souvent répétés dans le compte que je vous ai rendu : Je vois en Dieu, je vois en la lumière de Dieu, Dieu m’a dit. Dieu m’a fait voir, etc.; parce que toutes ces différentes expressions signifient que ce que j’énonce s’est passé en moi d’une manière que je ne puis rendre autrement, mais si éloquente et si persuasive, que rien au monde n’est comparable à son évidence, et qu’il est aussi difficile à l’homme spirituel de s’y tromper, qu’il est impossible à l’homme charnel d’y rien comprendre. Un seul mot dit ainsi de la part de Dieu, a des sens infinis, et en dit infiniment plus à l’âme qui l’entend, que ne feraient des discours entiers de l’éloquence humaine, et qu’il est vrai de dire qu’il surpasse infiniment le langage des anges eux-mêmes. Je vous en citerai, si vous voulez, un seul petit trait en passant, et pendant qu’il me vient à l’esprit (1).
(1) Qu’on me permette encore de demander s’il est naturel, s’il est raisonnable de penser qu’une âme qui parle ainsi puisse être dans l’illusion? Est-il rien de plus divin que le langage que nous venons d’entendre ? Comment une ignorante peut-elle le tenir ? Comment le père du mensonge pourrait-il le lui inspirer?… Mais continuons de l’entendre elle-même.
L’autre nuit que, pendant un moment d’insomnie, je pensais à la tendresse de Dieu pour moi, ce seul mot, mon enfant, qu’il m’a fait entendre tant de fois, me vint alors au souvenir, et sur ce mot tout seul un seul trait de lumière me frappa, et voici en substance ce qu’il me fit comprendre en un clin d’œil.
Oui, ma fille, tu es mon enfant, et tu l’es à plus d’un titre; considère ce que je suis à ton égard, ce que tu es au mien; vois ce que j’ai fait pour toi, dans l’ordre de la nature comme dans celui de la grâce; combien tu as coûté à mon amour, et juge de là combien tu dois être chère à mon cœur; rappelle les bienfaits de ta création, de ta rédemption, de ta prédestination; rappelle les grâces de prédilection, les faveurs dont je t’ai prévenue, et dis-moi si j’ai droit de t’appeler mon enfant? dis-moi si mon cœur a des droits sur le tien, et s’il pourrait se plaindre de ton indifférence? Ah! n’en doute aucunement, jamais Père n’eut des droits comparables aux miens, et jamais enfant n’eut d’obligations plus sacrées ni plus indispensables que le sont les tiennes à mon égard.
Oui, ma fille, tu es mon enfant, et voici ce que j’exige de ta reconnaissance pour tous mes bienfaits; c’est mon amour qui te va dicter une loi, écoute-la bien pour ne t’en écarter jamais. Je veux que tu conformes en tout ta volonté à ma volonté, pour ne plus faire qu’une seule et même volonté, parce que l’enfant ne doit vouloir que ce que veut son Père. De même je veux que tu renfermes ton amour dans mon amour, pour ne plus faire qu’un seul et même amour, et cela sans milieu, sans partage et sans aucune réserve, comme le cœur d’un enfant est étroitement uni à celui des auteurs de son existence; qui le comblent d’attentions, de soins empressés et de toutes sortes de bienfaits.
Il faut, ma fille, que tu me sacrifies toute recherche de toi-même et de ton amour-propre, toute affection terrestre, tout retour vers la créature, pour ne vouloir et n’aimer plus rien au monde qu’en moi, pour moi, et à cause de moi Voilà ce qu’on appelle une vraie fille qui répond à toute l’étendue de ce beau nom, et voilà aussi ce que je veux te faire entendre par ce même nom d’enfant que je t’ai donné tant de fois, et que tu dois travailler à mériter plus que jamais, par la douceur, la simplicité, la reconnaissance filiale, l’amour tendre, soumis et affectueux, qui doivent t’en rendre digne toujours de plus en plus.
Tout cela, mon Père, et beaucoup plus encore, était compris dans ce petit trait de lumière qui m’éclaira tout à coup et dans un seul instant, sur le seul mot d’enfant, qui m’était d’abord venu à l’esprit; mais tout cela me fut présenté, et comme imprimé, avec une clarté et une profondeur qui me le faisaient voir sous tous les rapports. Ah! mon Père, que l’éloquence humaine est faible et chétive en comparaison! Qu’elle est impuissante pour rendre ce que Dieu fait voir d’un seul clin-d’œil à l’âme qui a le bonheur de le posséder ! Remettons, s’il vous plaît, la suite à ce soir, après que vous aurez récité l’office divin.
__________________________
(105-109)
Exercices de piété de la Sœur. Son attrait pour l’humilité, l’abnégation et la pénitence.
« Au nom du Père, etc. »
Mon Père, outre cet exercice continuel de la présence de Dieu, je faisais mes prières du soir et du matin avec le plus d’exactitude qu’il m’était possible, J’assistais souvent à matines, où je trouvais beaucoup de consolation et de plaisir. Quoique je n’allasse à confesse que tous les huit jours au plus, cependant je communiais fréquemment, par l’avis de mon directeur. Madame l’Abbesse avait pour moi des bontés qu’elle me témoignait en mille rencontres, surtout par la liberté pleine et entière qu’elle me laissait complaisamment, par rapport à tout ce qui regardait mes dévotions particulières.
L’impression que j’avais ressentie d’abord, et qui m’avait tout à fait déterminée, était une impression qui me portait sans cesse à l’humilité, à l’abnégation, à la pénitence. Continuellement je me sentais pressée de renoncer de plus en plus au monde, au péché et à moi-même. Je cherchais toutes les occasions de plaire à Dieu par la mortification des sens. La grâce me faisait employer bien des moyens pour cela, dont mes directeurs m’ont quelquefois retranché quelque chose : il serait inutile de les détailler.
Pendant mes deux années de postulat le démon m’avait laissée assez tranquille. Je n’avais été exercée que de la part de quelques personnes de la maison; et Dieu, comme on l’a vu, avait pris soin de me soutenir et de me consoler par lui-même. Il n’en parut pas toujours ainsi dans la suite, où les combats furent plus rudes encore et d’une tout autre nature.
Après ses deux années de postulat, sa grande pauvreté est un obstacle à son admission. Ses peines et ses efforts pour réussir.
Le temps de quitter l’habit du siècle, pour prendre celui de la religion approchait, et cette approche excita une tempête d’une nouvelle espèce. D’abord, pour commencer mon noviciat, il me fallait fournir une somme de 3oo liv. : on me les demandait, et je n’avais en tout que 6 liv., sans espérance d’en avoir jamais davantage. Ce premier obstacle, qui eût paru si léger pour tant d’autres, était considérable par rapport à moi, et capable lui seul de tout déconcerter; car enfin il les fallait, et où les prendre? On me permit cependant, et c’est tout ce qu’on put m’accorder, de faire un tour à la Chapelle Janson, pour essayer si dans le lieu de ma naissance il ne se fût pas trouvé quelques âmes assez charitables et assez à l’aise pour m’aider de quelque chose. Mes recherches furent inutiles, et je me fatiguai beaucoup en vain. Tous mes parents étaient aussi pauvres que moi-même; notre tuteur avait rendu ses comptes, et l’inventaire avait à peine suffi pour payer les frais de justice et nous fournir le nécessaire à la vie. Mes courses n’aboutirent qu’à m’exposer au dernier danger que j’aie couru dans le monde.
En revenant de mon village, je fus attaquée par un homme ivre, qui me tint de très mauvais propos, et contre lequel il me fallut, pour ainsi dire, me mettre en défense. La crainte, et la vive émotion qu’il m’occasionna, me donnèrent la fièvre, avec un surcroît de dégoût pour un monde qui ne m’offrait que des périls sans consolation ni ressource. Voilà tout ce que je rapportai à la communauté en y rentrant malade, trois jours après que j’en étais sortie.
Il faut convenir, mon Père, que ma position était bien triste, et mon sort bien incertain, du moins à ne l’envisager que du côté des choses humaines. La communauté elle-même avait besoin de secours, et je voyais, non sans beaucoup de frayeur, des postulantes, très riches en comparaison de moi, se présenter pour prendre ma place, avec des dots considérables. Quelle crainte ! quel chagrin ! Je serais volontiers allée de porte en porte intéresser la pitié des habitants de Fougères, si l’on eût voulu me le permettre, pour tâcher d’en obtenir de quoi être admise à la prise d’habit.
Elle recourt à Marie, est enfin admise au noviciat, et prend le nom de Sœur de la Nativité.
Ne sachant plus, comme on dit, à quel saint me vouer, je m’adressai aux pensionnaires, pour les prier en grâce de me recommander à leurs parents; mais je ne sais par quelle raison, après en avoir délibéré entre elles, elles me répondirent qu’elles ne se chargeaient de rien et ne pouvaient rien me procurer. Quel crève-cœur ! Je me voyais continuellement à la veille d’être renvoyée, et déjà l’on parlait de me placer à la maison de retraite en qualité de servante !…. Je pleurais jour et nuit, sans éprouver ni repos ni consolation. Que devenir?…. Me voyant abandonnée de tout le monde, je me tournai vers Dieu, suivant mon usage pour trouver en lui ce que je ne pouvais plus me promettre des moyens humains, et je tâchai encore d’intéresser la divine Mère de J.-C., que j’appelais aussi la mienne, et je ne tardai pas d’éprouver encore qu’elle l’était véritablement, puisqu’elle en montrait tous les sentiments et tous les soins à mon égard.
Je priai donc encore la très-sainte Vierge de me tirer de ce mauvais pas, ou, si vous l’aimez mieux, de cette fâcheuse situation. Je lui promis que si elle voulait me procurer d’être admise à
__________________________
(110-114)
la prise d’habit, je ferais brûler un cierge et dire une messe devant son image de Saint-Sulpice, où j’avais fait mes premiers vœux; que je prendrais l’habit monastique sous ses auspices, et la fête de la Nativité pour mon nom de religion, comme il arriva bientôt après.
Il ne m’est jamais arrivé de m’adresser à la sainte Vierge en pareille détresse sans en recevoir à l’heure même beaucoup d’espérance et de soulagement. Après cette prière, qui me consola beaucoup, j’allai trouver notre Mère; c’était alors Madame Saint Joachim, et je la priai de me mettre en chapitre pour qu’on eût à décider de mon sort. Notre Mère m’aimait sincèrement, et ne m’eût pas rejetée d’un œil indifférent. Ne me pressez pas, me dit-elle; il me vient une idée: je veux un peu prendre mon temps et mes mesures; laissez-moi faire, je ferai tout pour vous garder, soyez-en sûre. Je pris donc le parti d’attendre, d’espérer et de prier, car déjà je ne désespérais de rien.
Enfin Madame l’Abbesse assembla le chapitre à mon occasion, dans lequel, par ses soins ou autrement, tout alla de façon que, malgré les offres considérables des postulantes riches, malgré l’avis des religieuses en grand nombre, j’eus le bonheur de l’emporter. Je fus admise au noviciat, sans aucune dot, et sur le seul titre de pauvreté, qui n’était sûrement ni frauduleux ni imaginaire. Je pris donc enfin le saint habit de religion, avec le nom de Sœur de la Nativité, que j’ai toujours porté depuis. Ah! pauvre sœur de la Nativité, que tu as encore de combats à soutenir et de dangers à craindre pour ton salut et ta sanctification ! Ne t’attends pas que le démon va te laisser longtemps tranquille dans ce nouvel état que tu viens d’embrasser et qui fut si longtemps l’objet de tes travaux !….
Violente tentation du démon contre sa vocation.
Le calme succéda donc encore à la Violente tempête; mais hélas ! ce ne fut que pour faire place à une bourrasque plus furieuse encore que toutes celles du passé; car, comme je vous l’ai dit tant de fois, ma pauvre vie n’a été jusqu’ici qu’une succession de douleurs et d’amertumes, de consolations et de chagrins, de joie et de tristesse, d’obscurité et de lumières, de tentations et de faveurs. Plaise au ciel, mon Père, que la fin en soit au moins calme et tranquille!
Le démon, qui depuis longtemps n’avait employé que des moyens extérieurs pour me troubler, revint à ses premières attaques. Il y avait quelques mois que je jouissais du bonheur d’être revêtue du saint habit que j’avais tant désiré, lorsqu’il réveilla en moi le goût du monde que j’avais quitté, et les passions auxquelles j’avais renoncé, même bien du temps avant mon entrée en religion Il me répétait vivement que n’ayant point eu de vocation pour un état si saint, j’avais fait, en y entrant, la plus imprudente de toutes les démarches et la plus dangereuse pour l’avenir : que si j’étais assez hardie pour faire mes vœux, j’allais évidemment exposer mon salut éternel; que ces vœux téméraires étant faits contre la volonté de Dieu, seraient pour moi une source de repentirs, et ne serviraient qu’à me rendre plus coupable, et qu’ils deviendraient infailliblement la cause de ma damnation; qu’il fallait y penser pendant qu’il en était encore temps; qu’il valait mille fois mieux braver le respect humain en sortant de la communauté, que de s’y rendre malheureuse pour toujours en s’y fixant irrévocablement, etc., etc.
Ces cruelles pensées me troublaient et m’agitaient si fortement, que j’en perdis absolument la paix et le repos; plus de tranquillité, plus de sommeil qui ne fût interrompu par des songes effrayants. Je réfléchissais, je pleurais, je priais; enfin, presque vaincue par ces mortelles inquiétudes, je pensais à me retirer et à céder. Un jour que, tout occupée de ces tristes et accablantes perplexités, je passais devant l’église, j’entendis très distinctement une voix qui me parut sortir du fond du sanctuaire, et qui me dit: Hé quoi! ma fille, voudrais-tu me quitter ? Non, tu ne m’échapperas pas!
Cette voix, que je reconnus pour être celle de J.-C. lui-même, me pénétra de confusion en me découvrant le piège de mon ennemi, et la tentation disparut. Non, mon Seigneur et mon Dieu, répondis-je aussitôt, non, mon divin et adorable maître, je ne vous quitterai point : vous connaissez le désir que j’ai de vous choisir pour mon partage et d’être tout à vous pour toujours.
Pour être plus en sûreté de conscience, j’allai trouver mon directeur, qui était alors feu M. Duclos. Il m’avait revêtue du saint habit de religion. Je lui parlai de la tentation que j’avais éprouvée, et il acheva de me rassurer et de la dissiper. Ne vous y arrêtez seulement pas, me dit-il, et n’en parlez à personne. Votre découragement ne peut venir que du démon; allons, ma Sœur, méprisez votre ennemi; il ne faut pour cela qu’un peu de courage : je réponds de votre vocation (1).
(1) Quand la Sœur me parlait ainsi, il y avait cinq ou six ans que M. Duclos était mort au bourg de Parrigné, à deux lieues de Fougères. Il était alors âgé de soixante-onze ans, et il y en avait au moins vingt qu’il gouvernait cette paroisse. J’avais été pendant huit ans son dernier vicaire, et ce fut entre mes bras qu’il mourut. Il m’avait souvent parlé des religieuses Urbanistes qu’il avait longtemps dirigées avant d’être recteur, et entre autres d’une Sœur qu’il me nommait de la Nativité, comme d’une fille extraordinaire pour la solidité de sa vertu, et par les lumières que Dieu lui avait accordées. Il m’a cité quelques traits de ses révélations, qui avaient fait bruit, et que j’ai trouvés exactement conformes au récit que la Sœur m’en a fait depuis. Ni lui, ni moi, n’aurions dit en ce temps que je devais un jour la connaître plus particulièrement encore que lui-même ne l’avait jamais connue.
__________________________
(115-119)
Terrible assaut que lui livre le démon au moment de sa profession.
Depuis ce temps, mon Père, le démon parut confus et me laissa assez tranquille, jusqu’au moment de prononcer mes vœux, où il revint à la charge avec plus de rage que jamais, et me livra le plus furieux assaut que j’eusse encore souffert de sa part; assaut qu’on peut bien mettre au nombre des traits de ma vie que plusieurs ne croiront point, et qu’ils ne regarderont que comme une des extravagances qu’ils appelleront les fruits ou délires de mon imagination. De quelque manière qu’ils prennent encore ici la chose, voici le fait tel qu’il se passa sous mes yeux:
Pendant que, suivant le cérémonial de la profession, les mères me conduisaient du bas du chœur au haut, pour y recevoir le voile, la couronne d’épines, etc., etc., et pour y prononcer mes vœux solennels, je vis devant moi un spectre, un monstre épouvantable dont la forme tenait beaucoup de celle de l’ours, quoiqu’il fût de beaucoup plus hideux encore. Il marchait d’un air triomphant vers le haut du chœur, se tournant vers moi par intervalles, d’une manière tout à la fois horrible et indécente ; il semblait vouloir autant salir qu’épouvanter mon imagination. Il me faisait entendre que c’était pour lui seul que j’allais faire mes vœux; que tout le profit lui en reviendrait, et que si j’étais assez téméraire pour faire ce dernier pas, il n’y aurait plus aucune espérance pour mon salut, puisque le ciel allait m’abandonner pour toujours à son pouvoir, etc., etc.
Jugez, mon Père, si, dans un moment si critique, où l’on est à peine à soi-même, je devais être frappée et ébranlée de cette étrange apparition? Que serais-je devenue, je vous le demande, si Dieu n’eût encore eu la bonté de me secourir dans ce moment terrible, ou si le secours n’eût été proportionné au genre et à la circonstance de l’attaque? J’eus donc encore recours à lui seul dans ce pressant danger, et il permit que les paroles même de la cérémonie me fournirent les armes dont j’avais besoin pour terrasser mon ennemi et pour remporter sur lui une victoire complète.
En montant le chœur, le cérémonial prescrit trois génuflexions, à chacune desquelles le chœur chante des paroles qui commencent par Suscipe…, et dont le sens, que j’avais bien appris, est à peu près : Recevez, Seigneur, dévouement et la consécration de votre créature, et ne permettez pas que je sois confondue, parce que c’est en vous seul que j’ai mis tout mon espoir. Le sens de ces belles paroles ne pouvait me venir plus à propos à tous égards. Dieu et l’Église me les mettaient à la bouche, et pour ainsi dire en main, et je m’en servis comme d’une arme offensive et défensive, dont je perçai mon ennemi au moment où il se flattait de la victoire, et où il triomphait avec plus d’insolence.
Je les prononçai donc trois fois dans toute la sincérité de mon cœur, autant du moins que la frayeur où j’étais me laissait de liberté pour le faire, et trois fois j’en retirai une force intérieure que je sentais aller toujours en augmentant. Mon Dieu, disais-je, ne me confondez pas, puisque j’espère en vous. Recevez, je vous en conjure, l’hommage de mes vœux et de ma personne! Je vous prends pour mon unique partage, et c’est à vous seul que je me donne et que je veux être pour le temps et pour l’éternité….
Déjà le monstre avait disparu d’un air menaçant et plein de dépit. Mais mes frayeurs subsistaient encore, et semblaient redoubler à mesure que le moment approchait. Arrivée au haut du chœur, je fis un effort sur moi-même, et je me déterminai à espérer contre toute espérance, s’il le fallait. Je me précipitai aux genoux et aux pieds de madame l’Abbesse, pour lui promettre obéissance comme à J.-C. lui-même, et dès ce moment je passai de l’enfer au ciel. Le calme le plus profond succéda à la plus furieuse tempête, et J.-C. fit entendre au fond de mon cœur ces consolantes paroles qui en dissipèrent tout le trouble et toute l’agitation: « Je reçois, ma fille, l’hommage de tes vœux et de ta personne; sois-moi fidèle et ne t’effraie pas, je saurai te défendre contre tes ennemis. C’est moi que tu as pris pour ton partage, et c’est moi, si tu réponds à ta vocation, qui serai ton partage dans le temps et dans l’éternité. »
Pour le coup, mon Père je croyais mon bonheur assuré, et en cela je me flattais trop encore. Dans ce moment, je me trouvais si heureuse et si tranquille, que j’aurais osé défier tout l’enfer. C’eût été présomption, et J.-C. ne veut pas que nous nous appuyions sur nous-mêmes. Le monstre, que je ne craignais plus, avait été confondu par le seul secours du ciel, il est vrai; il avait même pris la fuite; mais ce ne fut pas pour longtemps, et j’avais
__________________________
(120-124)
encore bien des combats à soutenir, bien des méchancetés à essuyer de sa part. Nous en parlerons une autre fois.
Faveurs extraordinaires qu’elle reçoit de J.-C. Ses extases et ses ravissements.
« Au nom du Père, etc. »
Enfin, mon Père, mes vœux solennels étaient prononcés, ma profession était faite, malgré tous les efforts de l’enfer; j’étais enfin religieuse pour toujours, et J.-C. ne tarda pas à m’en témoigner son contentement par des faveurs toutes nouvelles et proportionnées; que dis-je? bien supérieures à tout ce que j’avais fait pour lui. Il y avait à peine quelque mois que j’étais professe, qu’il se communiqua à moi par des faveurs et des grâces plus abondantes que jamais, et qui devinrent bientôt comme habituelles, jusque-là, le croirez-vous, mon Père, qu’il m’a fallu plus d’une fois le prier d’en modérer les effets. J’ose à peine le dire, par la crainte qu’on n’attribue à l’extravagance tout ce que je vous ai fait écrire de plus sérieux; car, mon Père, combien ne se trouve-t-il pas de personnes qui, ne jugeant des choses spirituelles que par ce qu’elles en ont éprouvé, ne peuvent rien croire de ce qui passe tant soit peu leur expérience ou la portée de leur entendement? Vous diriez que Dieu est obligé de s’en tenir là, sans aller plus loin. Appuyées sur une raison aussi trompeuse qu’elle est faible, elles osent, pour ainsi dire, lui tracer la ligne dont, suivant elles, il ne peut s’écarter, et rejettent avec un orgueil et un mépris, comme indigne de lui, tout ce qui ne s’accommode pas avec leur façon de voir et de juger. Qu’ils sachent, ces téméraires, que Dieu n’en tient aucun compte, et qu’indépendamment de leurs petits raisonnements, il fait ce qui lui plaît, et de la manière qu’il le juge à propos, pour sa propre gloire et le salut de tous ceux qui veulent en profiter…
D’abord, mon Père, J.-C. me communiqua et me fit éprouver une lumière extraordinaire qui va quelquefois jusqu’à produire la privation de l’usage des sens, les ravissements, les extases… Après ma profession, je ne faisais presque plus de communion sans éprouver quelque chose de semblable. On sonnait la cloche à côté de moi; on chantait; les religieuses entraient au chœur, ou en sortaient, sans que je m’en aperçusse le moindrement. J’étais ravie en Dieu, mais toujours à ma place, sans mouvement et sans aucun sentiment. Revenue à moi-même, je ne me rappelais pas toujours ce qui s’était passé dans mon intérieur. Voici pourtant quelques traits que je m’en suis rappelés très distinctement, et que je vais vous dire: on en pensera donc tout ce qu’on voudra. En vous rendant ce compte, je ne ferai encore qu’obéir à l’ordre que j’ai reçu.
Elle se trouve comme un petit enfant entre les bras de J.-C.
La première fois que pareille chose m’arriva, ce fut dans une communion, quatre ou cinq mois après mes vœux solennels. Quelle agréable surprise, lorsqu’au centre d’une lumière plus vive et plus étendue, et où la présence de Dieu se rendait plus sensible que jamais, je me trouvai sous la forme d’un petit enfant entre les bras de J.-C., qui me chérissait. J’étais enveloppée de langes, sans force, sans mouvement; tout ce que j’avais de plus que les enfants ordinaires, c’était l’intelligence pour connaître mon bienfaiteur, et la volonté pour l’aimer, pour le remercier, sans pouvoir le faire que très faiblement. Je me rappelle qu’il me disait en me caressant : « C’est ainsi, mon enfant, que ma providence a toujours veillé à ta conservation, et que tu as toujours été entre les bras de mon amour. Car, ajouta-t-il, il n’y a pas de mère qui aime si tendrement l’enfant qui lui est redevable de la vie.
Je veux donc, ma fille, poursuivait-il, pour répondre aux soins de ma tendresse, que, semblable au petit enfant que tu représentes en ce moment, tu te conformes en tout à ma volonté sainte, pour ne faire et ne vouloir que ce que j’exigerai de toi….» Après cela, mon Père, je fus rendue à moi-même et à ma forme ordinaire. Ce trait et bien d’autres semblables m’ont été rappelés vivement à l’esprit lorsque nous avons commencé d’écrire mes révélations. J.-C. me dit : C’est maintenant ma fille, que tu dois être dans l’état du petit enfant, qui, loin d’apporter aucune opposition à la volonté de sa mère, s’y conforme sans la comprendre. C’est la disposition que j’exige de toi.
Dans une autre apparition de J.-C., elle veut par amour s’élancer entre ses bras. Elle se sent repoussée. Paroles qu’elle entend.
Dans une circonstance pareille J.-C. m’apparut : j’étais si ravie de le voir que je balançais entre l’amour et le respect. Tantôt je me prosternais à ses pieds pour l’adorer, et tantôt, ne pouvant plus résister à mon empressement, je m’élançais entre ses bras; mais je me trouvais sans cesse repoussée de son sein, ce qui ne faisait qu’enflammer le désir dont je brûlais d’y parvenir et de m’y reposer. Je fis à plusieurs reprises la même tentative et toujours inutilement. Tout à coup une voix forte se fit entendre qui me parut celle d’un esprit bienheureux : Il n’est pas temps encore, me cria t-il, ces faveurs ne s’achètent que par des tribulations et des croix souffertes pour son amour. Je me bornai donc à les désirer, comme le seul moyen d’être heureuse, et je l’étais déjà en pensant que ce moyen
__________________________
(125-129)
si facile était en ma disposition, et pour ainsi dire entre mes mains; que je pouvais à chaque instant en faire usage et le mettre en pratique; car, quel est l’homme au monde qui n’ait pas l’occasion de souffrir quelque chose pour l’amour de J.-C.? et quel jour de notre vie ne nous offre pas mille moyens d’avancer ainsi dans ses bonnes grâces, et de faire des progrès dans ce saint amour qui seul peut nous rendre heureux pour le temps et pour l’éternité !…
Faveurs signalées qu’elle reçoit de J.-C. dans la Sainte-Eucharistie.
C’est surtout, mon Père, à l’égard de la sainte et adorable Eucharistie, pour laquelle Dieu m’a toujours donné une dévotion très-sensible, que se sont passées en moi les choses les plus surprenantes, par cette lumière divine et si extraordinaire dont nous avons tant parlé. Il faut que je vous en donne connaissance, en vous rappelant quelques-uns des principaux traits qui ont été comme la source et l’origine de bien des lumières, et à l’occasion desquels j’ai connu la plupart des choses que vous avez déjà écrites pour les rédiger.
Ce commerce d’amour, si on peut le dire, cette intime familiarité avec mon divin maître, mon Sauveur et mon Dieu, commença le jour de Saint-Augustin, où j’étais allée adorer J.-C. dans le saint-sacrement pendant quelques minutes. C’était, si je me rappelle bien, trois ou quatre ans au moins après ma profession. Je fus frappée si vivement de la présence réelle de J.-C., dans la divine eucharistie, qu’on aurait dit ensuite que la réalité de cette présence me suivait partout, et partout me rendait sensibles les anéantissements de mon Dieu dans ce mystère adorable. O si ceux qui en doutent, si les incrédules qui le nient et le blasphèment, pouvaient éprouver une pareille faveur; si leurs passions, leur incrédulité, leur mauvaise foi, leur aveuglement volontaire, leur méchanceté, n’y mettaient point d’obstacles !… Mais hélas !…. Dieu est le maître de ses dons, et les impies s’en rendent indignes: Aussi est-il un Dieu doublement caché pour eux!….
J’avais continuellement l’esprit et le cœur vers le saint sacrement; sans cesse je l’apercevais, au moins des yeux de la foi, et d’une manière qui ne se peut bien expliquer, faute de comparaisons qui en donnent une juste idée. Mille fois, et surtout pendant le saint sacrifice de la messe, j’ai cru voir J.-C. des yeux du corps, pour ne pas dire que je l’ai vu réellement. Aux élévations des espèces consacrées, il me paraissait entre les mains du prêtre, environné d’un globe de lumière, et tout éclatant de gloire et de majesté. Le soleil est moins lumineux dans toute sa splendeur. Ensuite je le voyais couché sur l’autel, en état d’immolation témoignant à l’égard de plusieurs son empressement à être reçu d’eux par la sainte communion, et son aversion pour entrer dans le cœur des autres.
Son commerce d’amour avec J.-C.
J’ai vu plusieurs fois le saint tabernacle comme une fournaise d’amour, J.-C. au milieu de laquelle les plus pures flammes me laissaient apercevoir un petit enfant d’une beauté ravissante, assis sur les espèces qu’on y conserve, et qui lui servaient d’un voile officieux, qui couvrait son corps adorable et tempérait l’éclat de sa majesté… Je le voyais, je l’entendais, il me tendait les bras et m’appelait à lui. Jugez quelle devait être l’activité de mes désirs!
C’est ici, me disait-il, que je suis captif de mon amour !… Prêtre et victime tout à la fois, c’est ici que je satisfais encore à la justice de mon divin Père, et que je m’immole encore chaque jour pour le salut de tous. C’est ici que j’attends tous les cœurs pour les immoler avec moi, et les brûler des flammes qui me consument… Viens, ma fille, viens t’unir avec mon cœur sacré pour honorer ton auteur comme il mérite de l’être !… Hâte-toi !…. Viens, n’ayons qu’un cœur et qu’un amour, et tu sentiras du soulagement dans les tentations et dans les peines qui t’accablent! Cette sainte union, source de ton bonheur, amortira la violence de tes passions et éteindra le feu de ta concupiscence…. Eh ! pourquoi souffrez-vous, enfants des hommes ? pourquoi vous obstinez-vous à vouloir périr quand le remède est entre vos mains!… venez donc tous, et ne résistez pas plus longtemps aux empressements de mon amour! Eh ! mon Père, combien de fois j’ai reçu cette invitation amoureuse et pressante de la part de mon Dieu ! combien de fois j’ai éprouvé la force toute-puissante de ce remède divin!…
Pendant quinze jours ou davantage, ces tendres engagements, ces amoureuses invitations ne cessèrent point; ce fut même à la suite de ces touchantes conversations avec J.-C. qu’il me prescrivit les six pratiques dont je vous ai parlé ailleurs, et que je vous ai d’abord données par écrit. Je vis dans cette même lumière tout ce qu’il exigeait de moi à cet égard, ou plutôt ce fut lui-même qui me les dicta mot à mot, telles que vous les avez lues et écrites. Il m’en expliqua le sens, et il exigea que je m’y engageasse par vœu, ajoutant que c’était un moyen de lui être agréable et de satisfaire à sa justice pour mes péchés et ceux de tous les hommes. Il me dit cependant qu’il ne voulait pas en charger ma conscience
__________________________
(130-134)
de manière à me rendre coupable, si j’y manquais quelquefois, pourvu que ce fût sans mépris et même sans négligence de ma part. Enfin, mon Père, il me l’enjoignit dans le même sens où vous m’avez permis d’en renouveler le vœu pour le reste de mes jours. Aussi voulait-il que je m’en fusse rapportée à mes directeurs.
En conséquence j’attendis bien un an pour m’y engager en premier lieu, et je ne le fis encore qu’avec l’agrément de feu M. Audouin, qui venait de succéder à M. Duclos. Ce fut le jour du Sacré-Cœur, après ma communion, que je prononçai ce vœu pour la suite. Dans le moment même je vis à côté de moi J.-C. qui parut agréer fort cet engagement. Il paraissait alors sous la figure d’un prêtre revêtu d’une aube très fine, mais surtout d’une blancheur si éclatante que j’en avais les yeux éblouis et qu’il m’était impossible de le fixer.
En mille autres rencontres dont je vous ai ailleurs rapporté une partie, mon esprit s’est porté vers J.-C. au saint-sacrement de l’autel, par cette même lumière extraordinaire; et soit que les sens corporels en fussent réellement affectés comme je l’ai souvent cru, soit que tout cela se passât dans mon esprit seulement et par les yeux de la foi, de quelque manière que la chose ait eu lieu, je puis dire dans un sens très véritable, que j’ai vu J.-C., que je l’ai entendu, que je me suis entretenue avec lui; et si j’étais dans l’illusion, comme on ne manquera pas de le supposer, ce sont du moins les plus agréables où l’on puisse se trouver. Ces prétendues illusions m’ont toujours procuré le bonheur le plus parfait et le plus vrai que j’aie jamais goûté sur la terre, au point que tout autre plaisir a disparu devant celui-là. Voilà ce qu’il y a de bien certain, et ce qu’on s’efforcerait en vain de me contester.
Grâces qu’elle reçoit pour les autres. J.-C. lui fait connaître l’état de la conscience de quelques personnes.
Je dois encore vous dire, mon Père, que par un surcroît de bonté, Dieu a voulu quelquefois faire rejaillir sur d’autres que sur moi les bienfaits dont il me comblait sans aucun mérite de ma part. Il m’a plus d’une fois fait connaître l’état des consciences, et plus d’une âme a profité de la connaissance qu’il m’en avait donnée. Je voyais donc tout ce qui se passait dans l’esprit et le cœur de certaines personnes, les tentations qu’elles éprouvaient ou devaient éprouver, les pièges que le démon leur préparait, et j’étais chargée de les en avertir, en leur indiquant les moyens de découvrir ces pièges et de faire échouer les projets et les ruses de leur ennemi. Ceux qui suivaient mes avertissements trompaient sa cruelle attente; ceux, au contraire, qui s’amusaient à douter et à disputer, étaient à coup sûr dupes de leur incrédulité, et ne tardaient pas à s’en repentir.
Cela m’est arrivé, mon Père, à l’égard de différentes personnes laïques, religieuses, ecclésiastiques, quelquefois même à l’égard de mes supérieurs, et même de mes confesseurs, comme je vous l’ai déjà dit, à qui j’ai donné différents avis, suivant leurs différents besoins, et suivant la lumière que je voyais en Dieu, et leur parlant de la part de J.-C.; enfin, mon Père, je vous ai quelquefois averti vous-même, comme vous le savez (1).
(1) J’ai rapporté ailleurs les différents avertissements que la Sœur m’a donné.
Considérant un jour une religieuse, je connus intérieurement qu’elle était fortement tentée d’orgueil. Je vis par la même voie qu’une domestique de la maison ne savait pas un mot de sa religion, ce qui se vérifia par l’absurdité des réponses qu’elle fit aux questions les plus simples du catéchisme. Hélas! combien d’autres plus savants qu’elle sur toute autre chose, n’en savent pas davantage sur ce point essentiel ! Ils avaient cependant appris autrefois leur catéchisme; mais ils ne l’ont pas revu depuis l’enfance, et la teinture superficielle qu’ils en avaient, s’est totalement effacée de leur mémoire et de leur esprit.
Pendant un certain temps, il y eut ici une pensionnaire dont on parlait beaucoup dans la communauté : elle portait la haire et le cilice, prenait fréquemment la discipline, pratiquait des austérités extraordinaires, dont tout le monde avait connaissance. On l’entendait jour et nuit soupirer de manière à troubler le repos des autres, et même le chœur des religieuses. Dieu me fit voir qu’elle était trompée par le démon. J’allai de sa part l’en avertir: elle se trouva si déconcertée de ma commission, et si frappée des preuves que je lui en donnai, qu’elle avoua son hypocrisie et son orgueil.
1. Duclos, devenu recteur de Parigné, avait eu le malheur de donner un coup à un des enfants de sa paroisse à qui il faisait le catéchisme. Le lendemain, ou le jour même, l’enfant fut attaqué d’une grosse fièvre qui l’enleva en peu de temps. Les parents de cet enfant accusèrent leur recteur d’avoir occasionné sa mort, par ce qu’ils appelaient sa brutalité. M. Duclos n’avait guère, pour se justifier, que de faire exhumer et visiter le corps de l’enfant. Ses amis l’en pressaient: il croyait lui-même ce parti nécessaire pour éviter le coup de la calomnie et les suites qu’elle pouvait avoir; car quel scandale pour
__________________________
(135-139)
une paroisse, et combien n’est-il pas dur et disgracieux pour un pasteur, d’être regardé comme le meurtrier d’un enfant qu’il voulait instruire, et à qui il n’avait donné qu’une correction charitable pour le rendre plus attentif?
L’affaire était vivement poursuivie, et M. Duclos dans un grand embarras: il était sur le point de faire exhumer le corps; mais Dieu m’ordonna de le faire venir pour l’avertir de n’en rien faire. Cette exhumation, lui dis-je, ne pourrait rien prouver en votre faveur, et laisserait au contraire une impression très désavantageuse sur l’esprit de vos paroissiens. Souffrez un peu de temps la calomnie, et Dieu se charge de mieux vous justifier. M. Duclos en passa par-là, et quelques semaines après ses accusateurs et leurs faux témoins vinrent d’eux-mêmes se rétracter, et lui faire une réparation publique à l’issue de la grand’messe (1).
(1) Ce trait m’avait été raconté lorsque j’étais curé de la même paroisse, où plusieurs personnes en avaient encore connaissance.
Après une élection qui s’était faite dans une communauté que je ne nomme point, Dieu me fit voir que la supérieure nouvelle n’était point suivant son choix, et que les voies qu’elle avait employées ne pouvaient lui plaire. À l’élection suivante elle fut continuée, et Dieu me dit: Elle a voulu l’être, mais ce ne sera pas pour longtemps. Elle mourut en effet bientôt après…. Deux de nos pensionnaires, qui étaient sœurs, paraissaient vouloir également entrer en religion. Je les vis en songe toutes les deux; mais l’une était vêtue en religieuse, et l’autre en nouvelle mariée. J’annonçai sur cela le parti que chacune d’elles devait prendre, et mon annonce fut vérifiée par l’événement. Mais nous parlerons ailleurs de mes songes prophétiques.
Elle connaît aussi le sort de quelques personnes décédées.
Voilà, mon Père, une partie de ce que Dieu m’a fait voir en faveur de certains personnages, et cela dans le temps où il m’instruisait si au long sur le sort de l’Église en général, et de celle de France en particulier. Il serait comme impossible de vous détailler toutes les circonstances de ces révélations concernant ces particuliers, et qui allèrent quelquefois jusqu’à me faire connaître le sort des personnes décédées; comme il arriva entre autres à l’égard de la mère Sainte-Hyacinthe, dont j’appris l’entrée au ciel après quelques jours de purgatoire. Je sus même pour quelles fautes elle y avait passé ce temps.
Le rapport que j’en fis à notre Mère cadrait parfaitement avec une lettre que nous reçûmes du Père Cornillaye, son frère, qui rapportait ce que lui avait dit à ce sujet une veuve de Nantes, à qui Dieu avait communiqué la même lumière sur le sort de Madame Sainte-Hyacinthe (1).
(1) En rédigeant cet endroit, j’avais sous les yeux la copie de cette lettre que madame la Supérieure m’avait communiquée. Elle portait en substance, qu’après plusieurs jours de prières et de pénitence pour le soulagement et le rétablissement de cette religieuse malade, cette bonne et sainte veuve étant au lit, entendit des plaintes et des gémissements dans sa chambre, qu’elle vit éclairée d’une lumière tout extraordinaire. S’étant levée pour prier, elle aperçut cette religieuse qui lui dit qu’elle était la Sœur Sainte-Hyacinthe pour qui elle avait tant prié, par l’avis de son directeur, mais qu’elle avait subi le sort de tous les hommes; qu’elle l’exhortait à finir la neuvaine qu’elle avait commencée, et à faire acquitter la messe qu’elle avait eu la charité de promettre pour elle. Le lendemain la messe fut dite de grand matin par le père Cornillaye, frère de la défunte. La sainte veuve y assista, et vit, tout le temps du sacrifice, une religieuse de Sainte-Claire agenouillée sur le premier gradin de l’autel. Elle disparut après la bénédiction, et la veuve la vit s’élever vers le ciel, portant des espèces d’étoiles sur ses vêtements. Elle lui recommanda sa petite fille affligée du mal caduc, et qui se trouva guérie sur-le-champ. Malgré le laps du temps, on s’en ressouvenait et on en parlait encore. Il paraît, par le témoignage des religieuses, que le fait avait été bien constaté, ainsi que sa conformité avec l’énoncé de la Sœur, qui n’avait jamais eu la moindre relation avec la veuve de Nantes. On sait ce qui arriva à la Sœur après la mort de madame Saint-Benoît.
Tout récemment encore, mon Père, Dieu m’a fait voir le sort effrayant d’un de ses plus grands ennemis, qu’il vient pour ainsi dire de citer à son tribunal, et dont la mort précipitée a fait sensation. Il me défend de le nommer: il veut même, en général, que je m’abstienne de porter mon jugement sur ceux qu’il a jugés, quand même ils auraient été ses ennemis les plus déclarés. Quant à ceux qui vivent encore, il me fait entendre que je dois prier pour eux et les plaindre; que sa miséricorde aura lieu à l’égard d’un grand nombre, et qu’il n’en est aucun qui ne puisse encore mériter son pardon. Ainsi, mon Père, abandonnons tout à sa bonté, et remettons à la prochaine fois la suite de ma vie intérieure; et ce sera pour tantôt, si vous voulez.
Nouveaux assauts du démon contre la Sœur. Au nom du Père, du Fils, etc.
Il n’était pas possible que tant de grâces et si extraordinaires m’eussent été accordées sans que le démon en eût été jaloux et n’en eût profité pour attaquer mon humilité par l’orgueil, qu’il ne sut que trop m’inspirer, et qui, très probablement, contribua le plus à faire échouer le premier projet d’écrire, comme nous le verrons bientôt. Oui, je dois l’avouer, si la chose n’a pas réussi d’abord, comme de saints et si savants personnages l’avaient désiré, je le dis à ma honte et à ma confusion, c’est
__________________________
(140-144)
particulièrement à mon orgueil qu’il faut s’en prendre. Oui, c’est à mon orgueil diabolique, que Dieu voulait humilier et punir, qu’il faut surtout attribuer ce fâcheux contre-temps (1).
(1) On voit par là et par mille accusations semblables, que la Sœur ne s’épargne pas et ne s’en fait point accroire. Ceux qui seraient tentés de la regarder comme une hypocrite, doivent du moins convenir que ce serait une hypocrite d’une bien singulière espèce, et qu’il serait difficile d’en trouver à qui on pût la comparer.
Le démon ne manqua donc pas de me tenter de ce côté-là, et on peut dire qu’il y mit tout ce qu’il avait de ruses et d’adresses. Il commença donc, de longue main, par jeter dans mon âme la semence de cet orgueil malheureux, en cherchant dans toutes mes actions de quoi nourrir et entretenir l’amour-propre dont mon méchant cœur a toujours été rempli. Il relevait mes moindres vertus avec beaucoup de soin, et me donnait, malgré moi, des sentiments de préférence sur les autres. Il me comparait aux plus grands saints, et profitait de toutes les occasions pour me faire remarquer combien j’étais agréable à Dieu par mon humilité, ma patience, et combien Dieu m’avait réservé de faveurs et de grâces qu’il n’avait encore accordées à personne; et qu’enfin je serais un jour bien plus élevée dans le ciel que tant d’autres que, disait-il, l’Église y a pourtant placé. Sans cesse il me rappelait ces idées importunes et vraiment extravagantes.
Il allait plus loin encore, et se transformait en ange de lumière; il s’efforçait de contrefaire l’œuvre de Dieu par des apparitions de sa façon. C’était aussi des espèces de lumières dont l’esprit était frappé quelquefois très vivement, mais qui ne servaient qu’à l’éblouir ou l’offusquer, plutôt qu’à l’éclairer. Lumières fausses, par conséquent, qui n’affectaient jamais le fond de l’âme de la manière dont j’ai parlé précédemment. Loin d’en être satisfaite et éclairée, l’âme restait dans un trouble plus grand et des ténèbres plus épaisses. Tout se bornait donc à faire illusion à l’esprit, et quelquefois aux sens, qui en étaient troublés et affectés. Le cœur demeurait insensible, ou du moins il ne lui en restait qu’une certaine enflure, bien différente de l’impression d’humilité et d’anéantissement que laisse toujours après soi le sentiment de la présence divine.
Je me rappelle, à ce sujet, qu’un jour où l’obéissance m’appelait à travailler dans un lieu malpropre et infect, le démon me fit éprouver la sensation d’une odeur suave et charmante, dont je ne pouvais deviner la cause, jusqu’à ce qu’il m’eût inspiré que c’était Dieu qui la produisait à cause de ma grande sainteté. Vois, me disait-il comme il t’aime et te favorise. Dès ce moment le piège grossièrement tendu fut découvert, et tout disparut. Je restai donc dans l’odeur qui s’exhalait naturellement du lieu où je devais travailler.
Ainsi, mon Père, de fois à autres, cet ennemi avait la honte de se trouver pris dans ses propres filets; mais l’infatigable ne s’y prenait qu’avec plus d’adresse dans la suite; et loin de se déconcerter pour un désavantage, il savait tirer parti de sa défaite, et revenait toujours à la charge avec une nouvelle fureur. ll avait grand soin de susciter partout des éloges outrés qu’on faisait de moi et de mes pratiques de piété. J’entendais qu’on me proposait pour un modèle de vertu. Notre Sœur est une Sainte, disait-on; c’est une excellente religieuse…. Je faisais semblant de n’en rien croire, et même de ne le pas entendre; mais j’avais beau faire, malgré moi quelque chose me disait intérieurement: Cela ne peut guère être autrement.
Mes confesseurs eux-mêmes ne laissaient pas d’y contribuer, sans le vouloir, par les petits égards qu’ils me témoignaient quelquefois: car le démon savait profiter de tout. Un d’eux me dit imprudemment un jour: Ma Sœur, vous êtes maintenant cachée dans le sanctuaire; un jour vous serez mise sur le chandelier…. O ciel! quel coup pour mon humilité, et que cette parole me donna à faire! Heureusement, Dieu, sans doute pour m’en punir, m’a bien humiliée depuis par le moyen de mes confesseurs. Sur je ne sais quels bruits qui s’étaient répandus au-dehors, les gens du monde venaient me voir exprès, et me demandaient au parloir pour me consulter. Sitôt que je m’en aperçus, je les renvoyai. Quelquefois même il m’est arrivé de les brusquer ou de ne rien leur répondre. Pour couper pied à toutes ces visites dangereuses et importunes, je renonçai tout à fait au parloir, et n’y suis jamais allée depuis.
Peut-être (1) ne donnais-je pas pleinement dans l’orgueil; mais le démon qui se tait fait une retraite au fond de mon cœur, avait toujours sa part dans toutes mes actions, même dans mes meilleures œuvres. C’est du moins ce que je compris, lorsqu’il m’apparut un jour que je me disposais à faire une revue générale. Il était tout occupé à lier et faire un paquet composé de tout ce qu’il avait recueilli, et comme glané, sur toutes les bonnes œuvres de ma vie. Son air méchant, son ris moqueur semblaient me dire : tu auras beau faire, j’aurai ma part en tout, et tout ceci m’appartient de tes prétendues vertus. Et effectivement, l’orgueil m’avait aveuglée sur bien des choses que j’avais toujours cachées, n’y croyant pas du péché.
(1) Ce peut-être, dans la bouche de la Sœur, surtout si on le joint à sa conduite, seule interprète des vrais sentiments, est, à mon avis, une bonne preuve qu’elle n’y donnait pas du tout, ou du moins entièrement, et qu’à peu près tout se terminait à des tentations et des combats.
__________________________
(145-149)
Mais, mon Père, ce qui donnait plus de prise sur moi à cette dangereuse et maudite tentation de l’orgueil, c’étaient les apparitions et les visions, les grâces extraordinaires dont le ciel m’avait favorisée. Il n’est pas douteux que mon ennemi s’en fût servi pour me perdre absolument par l’orgueil, si Dieu ne s’en fût servi lui-même pour m’humilier, en tirant, comme il le fit, le contre-poison du poison même.
Visions et révélations qui regardent l’Église, et qu’elle fait écrire par M. Audouin, son directeur.
C’était pendant que Dieu se plaisait à me dédommager de mes peines par des intervalles de consolations intérieures, que j’eus la plupart des visions et révélations qui nous ont tant occupés sur le sort de l’Église. J’en parlai à quelques personnes qui furent très frappées de ce que je leur en dis. Le peu qui en transpira, fit grand bruit. De bons prêtres, habiles théologiens, s’assemblèrent pour en délibérer. Il fut arrêté entre eux que j’aurais fait écrire la suite des révélations dont je leur avais dit quelque chose. M. Audouin, alors notre directeur, en qui j’avais beaucoup de confiance, se chargea de cette pénible commission, dont il s’acquitta avec beaucoup de zèle et un soin tout particulier. Mais, mon Père, le démon sut si bien jouer son rôle, qu’il en prit occasion de mettre le trouble dans la communauté, qui se partagea en deux factions. Il profita de mes mauvaises dispositions, et peut-être encore de celles des autres, pour exciter contre moi la plus furieuse, comme la plus longue tempête que j’eusse encore essuyée. Enfin il joua si bien son personnage qu’il réussit à tout déconcerter, et on finit par brûler les écrits de M. Audouin. Mais, mon Père, ce dénouement n’arriva qu’après bien des scènes, toutes plus contraires et plus humiliantes pour moi.
Ses écrits sont brûlés. Ses grandes humiliations à ce sujet. Elle passe pour folle et visionnaire.
D’abord, mon Père, les choses ne se passèrent pas, à beaucoup près, aussi secrètement quelles se sont, passées entre vous et moi. On ne tarda pas à découvrir mes entrevues secrètes avec M. Audouin. Elles occasionnèrent bientôt des soupçons et de l’ombrage; on observa mes démarches, on vint nous écouter et nous épier. On répandit même qu’on m’avait entendu dire des extravagances à M. Audouin, touchant des malheurs où le clergé, les nobles et même la famille royale, devaient être enveloppés. On me fit passer pour une visionnaire, un vrai cerveau déréglé: On reprocha à M. Audouin de m’entretenir dans mes illusions. On alla jusqu’à en écrire aux supérieurs, et le petit parloir nous fut interdit (1).
(1) C’est pourtant par ce même petit parloir, autrefois interdit, que les dernières notes se sont encore tirées, et qu’on a encore passé et reçu les matériaux du nouvel ouvrage. Dieu peut différer et choisir ses moments; mais, quand il le veut, rien ne peut mettre obstacle à ses desseins.
Jugez, mon Père, combien tout cela devait me molester; pour comble de disgrâces, M. Larticle et M. Audouin se brouillèrent un peu à l’occasion de ce que j’avais fait écrire. Enfin, tout se termina comme j’ai déjà dit.
En quelles peines, en quelles humiliations ce fâcheux contre-temps ne devait-il pas me jeter? Et que ne dût-il pas en coûter à mon pauvre amour propre ! Hélas! mon Père, c’est en quoi je gagnais plus que je ne pensais; peines, combats et tentations contre la charité par le ressentiment et l’aversion que j’éprouvais contre celles de mes Sœurs qui avaient le plus contribué à mon chagrin. Que d’efforts ne m’en coûta-t-il pas pour vaincre cette antipathie qui, sans une grâce particulière, ne m’eût jamais permis de les voir d’un bon œil, ni surtout de les aimer jamais du fond du cœur, comme Dieu l’ordonne à l’égard de tous sans aucune distinction! Accablée de honte, de confusion et d’opprobre, je me voyais en butte aux ironies par lesquelles, à tout propos, elles satisfaisaient leur secrète jalousie. Je devins la fable de la communauté; mais Dieu m’assista au point de trouver du plaisir à me voir, ainsi humiliée, quoique d’ailleurs ces différentes tentations et peines d’esprit fussent réellement le tourment de ma vie.
Ses tentations contre la foi et les mystères.
Combats, tentations et peines d’esprit sur l’objet de ma croyance; car de combien de manières le démon ne m’a-t-il pas attaquée? Le croirez-vous, mon Père, après tout ce que je vous ai dit? il a même tenté d’ébranler ma foi aux principaux mystères de notre religion; il m’a inspiré des doutes sur le grand mystère de la sainte Trinité, celui de l’incarnation du verbe, et sur la perpétuelle virginité de la mère de J.-C. La Sainte-Vierge a bien voulu les dissiper elle-même dans une vision. J’eus longtemps une peine terrible sur la validité de mon baptême; mon confesseur et une lecture y avaient donné lieu. Le démon, qui savait profiter de tout, me répétait sans cesse que je n’avais point été bien baptisée. Il peignait si vivement dans mon imagination les suites de ce premier défaut capital, qu’il y avait pour moi de quoi perdre la tête, si, dans une communion, J.-C. lui-même ne m’eût guérie, en m’assurant
__________________________
(150-154)
que j’avais bien été baptisée, et que, quand je ne l’aurais pas été par l’eau, j’avais toujours le baptême de désir pour y suppléer. Il me parut même que pour me tranquilliser davantage, il me fit voir l’image de la Très-Sainte-Trinité gravée dans le fond de mon âme. Jamais depuis je n’ai ressenti la moindre peine à ce sujet.
Une autre tentation que le démon entretint encore longtemps dans mon esprit, c’était de croire, ou du moins de penser, que les réprouvés étaient condamnés à l’enfer sans leur faute, et en vertu des seuls décrets qui les y prédestinent irrévocablement. Dieu, me disait le démon, se comporte à leur égard comme un tyran jaloux de sa gloire, et qui se voit également honoré, et par le malheur des esclaves qui gémissent dans les prisons, et par le bonheur des courtisans et des favoris qu’il comble de ses bienfaits, sans qu’il y ait plus de mérite dans les uns que de faute dans les autres. Vous savez, et vous l’avez écrit, que Dieu m’a fait voir que ce serait là une des dernières hérésies qui doivent désoler la sainte église de J.-C.
Ainsi, mon Père, comme vous me l’avez dit dans une circonstance, j’étais alors janséniste, fataliste, prédestinianiste. Ciel ! j’en frémis encore; mais vous me rassurâtes, en ajoutant que tout cela n’était que dans mon imagination, ou plutôt dans les suggestions de mon ennemi. Je m’en tins là.
Sans cesse je me représentais à moi-même comme suspendue par un fil sur un précipice affreux. Qu’on souffre dans cet état, mon Père! il y a de quoi mourir de frayeur. J’en fus tout à coup délivrée en faisant des actes d’espérance et de résignation, et surtout par une action très humiliante que je fis en me jetant aux pieds d’une religieuse contre ma répugnance naturelle, ou plutôt contre mon ressentiment particulier. Dieu voulut bien me rendre la paix, en considération de cette petite victoire sur moi-même.
Ses tentations contre la chasteté.
Combats et tentations contre mon vœu de chasteté, qui se réveillèrent dans ce temps et devinrent plus furieux que jamais. Qui pourrait vous dire, mon Père, les soufflets et les insultes que j’ai reçus de l’ange de Satan, de l’ennemi de la pureté, qui s’armait de ma faiblesse naturelle pour me souffleter et m’humilier de toutes les façons? Il faut y avoir passé pour le comprendre. Le jour, la nuit, éveillée ou ‘endormie, combien de fois cet esprit impur a suggéré à mon imagination des représentations sales et infâmes ! Combien de fois il a troublé mon sommeil par des illusions obscènes, par des fantômes indécents, pour exciter en moi des révoltes auxquelles, par la grâce de mon Dieu, je ne crois pas avoir consenti, pas même en dormant (1)!
(1) Ne peut-elle pas bien dire, en effet, comme l’apôtre : Ne magnitudo revelationum extollat me, datus est mihi stimulus carnis meae angelus Satanae, qui me colaphizet, propter quod ter Dominum rogavi ut discederet à me; et dixit mihi : sufficit tibi gratia mea, nam virtus in firmitate perficitur. (2 Cor. 12, 7).
Songe dans lequel elle est poursuivie par un monstre, et reçoit un lis pour sa défense.
Puisque je ne dois rien vous cacher de ce qui concerne l’état de mon âme, je vous rapporterai, mon Père, à cette occasion, un songe que je n’ai jamais encore fait connaître à personne. Vous en ferez l’usage qu’il vous plaira. J’ai rêvé une nuit que j’étais poursuivie par une espèce d’homme monstrueux dont le dessein était encore plus odieux que la figure; je fuyais de toutes mes forces pour éviter sa poursuite, et, en fuyant, j’avais recours à Dieu, à la Sainte Vierge et à mon bon ange que j’implorais. Voilà qu’en courant le pied me glisse. O frayeur! Mais pendant qu’en tombant j’allais être saisie par le monstre, j’aperçois un beau jeune homme qui me reçoit entre ses bras et m’empêche de tomber. En même temps il lance sur mon ennemi un regard menaçant et terrible; le monstre fuit à son aspect, comme l’on voit une bête carnassière rentrer dans l’obscurité des forêts à la vue du berger vigilant qui paraît au moment où elle allait dévorer une brebis de son troupeau.
Ne craignez rien, me dit le jeune homme en me regardant d’un visage assuré, riant et gracieux; ne craignez rien : il peut vous épouvanter, mais on peut bien aussi réprimes ses efforts. Il tenait en main un lis charmant et d’une odeur la plus suave. Gardez-le bien, me dit-il en me le donnant, J.-C. le porta toujours dans son sein. Nous en verrons demain la suite; en voilà bien assez, je pense, pour aujourd’hui.
À ces mots, mon Père, je me réveille charmée du beau présent, et transportée tout à la fois de reconnaissance pour mon bienfaiteur, et d’indignation contre le monstre odieux qui avait disparu sans oser presque paraître depuis ce temps. Je dis presque, car il m’a encore apparu quelquefois, mais toujours de loin, et seulement pour me reprocher un usage que j’ai pris, il y a bien des années, et qui est d’asperger tous les soirs mon lit avec de l’eau bénite, avant de m’y coucher, comme aussi d’en faire des signes de croix sur moi-même.
Cet esprit méchant et jaloux, qui ne paraît pas s’en accommoder, voudrait m’épouvanter par des menaces. Il me
__________________________
(155-159)
dit que si je continue ces pratiques, qu’il appelle superstitieuses, ridicules et méprisables, il trouvera bien le moyen de s’en venger, en faisant encore échouer l’entreprise que nous avons commencée. ll ne faut pas tout à fait mépriser ses menaces, Dieu m’a fait voir, et l’expérience m’a trop appris qu’elles doivent être pour moi un motif de plus d’être sur mes gardes. J’ai souvent remarqué que les songes menaçants sont ordinairement les annonces de tentations sérieuses de la part de mon ennemi, et trop souvent de manquements et de chutes de ma part, dont quelquefois je ne m’aperçois pas même, à cause de la soustraction plus ou moins sensible des grâces du ciel; car, mon Père, ce sont toujours mes négligences et mes fautes plus ou moins marquées qui ont formé le nuage entre Dieu et moi; mais, si vous le trouvez bon, mon Père, nous ferons un article à part de mes songes agréables ou effrayants, dont j’ai dessein de vous rendre compte à cause du rapport qu’ils ont avec ma vie intérieure, et les différents états où je me suis trouvée par rapport à Dieu; car, mon Père, endormie ou éveillée, je serai toujours une énigme inconcevable pour les autres et pour moi-même.
Songe mystérieux, dans lequel elle comprend la difficulté de déraciner l’amour-propre.
Je ne dois pas craindre de le répéter, après tant d’épreuves de toutes les maladies de mon âme, nulle peut-être ne l’a exposée à tant de périls que l’amour-propre, qui faisait comme le fond de mon caractère; nulle n’a été si difficile à déraciner; nulle ne lui a fait des plaies si profondes et si dangereuses que cette malheureuse passion, cet ennemi domestique que Dieu permet que nous portions au dedans de nous-mêmes. C’est ce qu’il me fit comprendre par un songe mystérieux, dans lequel je me voyais obligée de combattre et de lutter contre différents monstres plus ou moins hideux qui représentaient les péchés capitaux. Celui de tous qui me parut le plus opiniâtre, et qui me fut le plus difficile à vaincre et à terrasser, ce fut une certaine petite coquette, extrêmement propre, souple et vigilante. Je pourrai vous en parler encore à l’article de mes songes.
Non contente de s’être mesurée seule à seule avec moi, elle entrait toujours pour quelque chose dans le combat qu’il me fallait soutenir contre chacun des autres. Elle semblait renaître de sa défaite, et, comme un Protée, revenait continuellement à la charge sous des formes différentes. L’esprit de Dieu me fît entendre que ce monstre, le moins hideux de tous, aimable même en apparence, était l’amour-propre, père de la superbe, le plus grand ennemi de Dieu et des hommes, et dont j’avais le plus à me défier, et contre lequel je devais le plus prendre de précautions, si je voulais mettre mon salut en sûreté, comme je l’ai éprouvé tant de fois dans le cours de ma vie.
Remèdes qu’elle emploie dans ses tentations. Humiliations et macérations
Pour me défendre donc de cet ennemi mortel, plus encore, si on peut le dire, que des tentations impures et autres misères dont j’étais assiégée, je sentais le besoin des humiliations et des austérités; j’usais donc de macérations, de jeûnes, de veilles, de disciplines et de prières, qui me furent d’un très grand secours. À cette époque, mon confesseur m’avait permis de porter la ceinture de fer; je la portais; mais J.-C. me dit qu’il ne fallait pas employer ce moyen, et qu’il m’en procurerait pour toujours un plus efficace; que cette ceinture que je voulais porter serait remplacée par une autre, et que la souffrance qu’elle m’occasionnerait lui serait d’autant plus agréable, qu’elle serait de son choix et non pas du mien.
Réforme qui a lieu dans la Communauté par l’ordre de Dieu.
Ce fut à cette occasion, mon Père, que Dieu me donna ordre de dire à madame l’abbesse que les Sœurs eussent à quitter les chemises de lin, qu’elles portaient depuis quelque temps, pour reprendre la tunique intérieure de laine qu’elles avaient quittée contre la règle. Ce qui se fit même par Ordre du supérieur (1).
(1) Cette réformé eut lieu suivant le témoignage des autres religieuses, lors d’une visite de monseigneur l’évêque de Rennes; mais je ne me rappelle pas si c’était alors M. de Girac ou bien M. Desnos, son prédécesseur. Ceci importe peu.
Elle demande à Notre-Seigneur des maladies; elle est exaucée. Ses longues et cruelles souffrances.
Pour éteindre tout à la fois ce feu de l’impureté, et abattre cet orgueil secret, caché pour ainsi dire au fond de mon cœur à mon insu, je priai J.-C. de vouloir bien m’envoyer des forces, en m’humiliant aux yeux de mes Sœurs et aux miens propres. J.-C. connaissait mon besoin mieux que moi-même, et sa bonté ne manqua pas d’y remédier. Bientôt on eût dit que toutes les infirmités du corps fussent venues fondre sur moi successivement, et cela dans le temps même des grandes lumières dont j’ai parlé. C’était apparemment la circonstance où j’en avais le plus besoin. Quoniam acceptus eras Deo, necesse fuit ut tentatio probaret te. (Tobie.)
D’abord je fus attaquée d’une fièvre lente qui, pendant plusieurs années, mina mes forces au point de faire craindre pour ma vie. Cette fièvre continue me jeta à la tête des douleurs insupportables et très opiniâtres; la poitrine en fut affectée de manière à me faire traiter pour la pulmonie. Quelque temps après, il me survint au genou gauche une énorme grosseur charnue dont il fallut faire l’amputation par une incision
__________________________
(160-164)
très douloureuse; mais Dieu, par condescendance pour ma faiblesse, voulut bien me faire éprouver dans ce moment un échantillon de ce qui se passait dans les martyrs qui ont étonné le monde par leur constance à souffrir les tourments dont l’idée seule fait encore frémir. Il suspendit donc en moi la sensibilité naturelle; et c’est ainsi, quand il veut, qu’il élève l’homme au-dessus de lui-même, et que, parmi les siens, les femmes, les vieillards, les enfants ordinaires l’ont emporté de beaucoup par leur courage sur tout ce que l’héroïsme même a enfanté de plus étonnant chez les païens.
Au lieu de se fermer, la plaie dégénéra en un dépôt d’humeur cancéreuse où la paralysie se jeta. Ce membre devint perclus, et je fus réduite à ne pouvoir marcher qu’à l’aide de deux bâtons. Le médecin et le chirurgien qui me voyaient avaient même déclaré que je ne pourrais jamais marcher autrement, puisque ma jambe étant gangrenée et percluse, il m’était impossible d’en faire usage. Cependant, mon Père, je ne tardai pas à m’en servir, malgré leur décision; aussi furent-ils les premiers à déclarer et à dire hautement que cette guérison était au-dessus de leur art, au-dessus même des forces de la nature, et tout à fait miraculeuse.
Sa prompte guérison après une messe en l’honneur de la Passion de Jésus-Christ et des douleurs de Marie.
J’avais seulement prié la communauté de faire une neuvaine en l’honneur des saints martyrs, et ce fut pendant cette neuvaine que j’éprouvai à mon genou un mieux si sensible que j’en fus surprise moi-même; mais la parfaite guérison ne s’opéra que le jour où M. Audouin acquitta pour moi une messe en l’honneur de la passion de J.-C, et des douleurs de sa sainte mère au pied de la croix; et ce temps fut si court qu’on ne balança point à y voir un vrai miracle, et le bruit s’en répandit bientôt. Pour moi, qui ne suis pas si hardie dans ces sortes de matières, je n’ose l’assurer, quoique je ne doute aucunement qu’il n’y ait eu un secours particulier du ciel, et que la Sainte Vierge n’ait encore ici interposé son pouvoir en donnant encore une preuve de sa bonne volonté pour moi.
Effort dans le travail, qui lui cause un accident très douloureux et incurable.
II ne se passa point, ou très-peu d’années, que je n’aie essuyé une maladie plus ou moins sérieuse, qui presque toujours me conduisait aux portes du trépas; et pour comble de faveur un, effort de travail m’occasionna un accident qui depuis dix-sept ou dix-huit ans est ma croix la plus pesante, croix qu’il faudra pourtant porter jusqu’au tombeau. Cet accident me parut d’abord un mal passager auquel je ne voulus pas faire la moindre attention; mille raisons m’empêchèrent, pendant six mois, de m’en déclarer à personne; mais les coliques affreuses, les douleurs vives que j’en ressentais m’obligèrent enfin d’en venir là. Notre Mère consulta les médecins, qui déclarèrent qu’avec un tel ennemi chaque instant pouvait être le dernier de ma vie. On voulut, en quelque sorte, m’obliger à le prévenir, en consentant à des moyens dont je ne pouvais souffrir la seule idée. Je répondis à notre Mère que je préférais de mourir, s’il le fallait; qu’au reste, je mettais ma confiance en Dieu seul qui connaissait mes raisons et mon besoin, et que sur cet article je n’aurais jamais d’autre médecin que lui. Notre Mère en chargea ma conscience; elle me l’ordonna même sous peine de désobéissance, et me voilà encore bien embarrassée de ce côté-là; car, que faire? quel parti prendre entre deux inconvénients que je redoutais également?
Cependant Dieu permit que de bons prêtres vinrent ici à mon secours; ils dirent à madame l’Abbesse, d’après leur théologie, que, sur ce point délicat, il ne fallait pas décider si prestement par rapport à moi. Ils écrivirent même à Paris, et la réponse qu’ils reçurent d’une grande école, portait qu’une religieuse surtout pouvait, en conscience, préférer la mort et la recevoir, plutôt que de souffrir aucune opération en pareil cas. Me voilà donc à l’aise; j’en fus quitte pour user d’un peu de précaution, et me servir d’un certain bandage que je regarde comme la ceinture que Dieu m’avait promise pour suppléer à celle que je voulais porter. Il faut convenir, mon Père, que par moi-même je n’aurais peut-être pas penché vers ce genre de souffrance; mais enfin il doit me plaire, puisque c’est Dieu qui l’a déterminé. Ce n’est point à nous, pécheurs, mais à lui qu’il appartient de nous choisir nos croix; et cette ceinture, toute pénible, douloureuse et humiliante qu’elle est, doit m’être bien chère, puisqu’elle est du propre choix de J.-C. qui me l’avait promise.
Tout se tournait contre moi, tout contribuait à me faire souffrir et à m’humilier par les endroits les plus sensibles. Il faut, mon Père, que l’orgueil soit bien insupportable à Dieu, puisqu’il le poursuit et le frappe avec tant de rigueur partout où il en découvre la moindre trace; car je puis dire qu’il l’a poursuivi à mon égard jusque dans ses derniers retranchements, et je n’ai garde de m’en plaindre. Contre les peines et les adversités dont j’étais assiégée, je n’avais qu’un ami à qui j’ouvrais mon cœur avec confiance, et aux pieds de qui j’étais sûre de trouver du courage et de la consolation, le seul qui
__________________________
(165-169)
jusque-là ait bien entré dans mes vues et dans celles de Dieu, qu’il seconde toujours de son mieux. Qui m’aurait dit que je devais jamais avoir eu aucun autre la même confiance, à tout le moins? Eh bien ! mon Père, cet ami, hélas! que n’ai-je pas eu à souffrir à son occasion! car encore une fois tout devait y contribuer.
D’abord, j’eus la douleur de voir rejaillir sur lui une partie de mes chagrins, comme vous l’avez vu; bientôt après il me fut enlevé lorsque j’avais le plus besoin de son secours… Le pauvre M. Audouin mourut, et ce fut moi encore qui fus comme chargée de lui annoncer sa mort de la part de Dieu. Je lui dis donc que je l’avais vu en proie à la souffrance, et comme attaché à la croix de J.-C., où il devait expirer; ce qui se vérifia quelques jours après…
Quel coup pour moi!… Ce fut sans doute pour m’en consoler que Dieu me le fît voir, peu de jours après sa mort, sortant du purgatoire, et s’asseyant au rang des bienheureux dans un fauteuil orné de fleurs, de palmes et de guirlandes. Sur l’assurance de sa peine, j’avais beaucoup exhorté les religieuses à se joindre à moi pour hâter sa délivrance par nos prières: ce qu’elles faisaient avec beaucoup de zèle et de ferveur; et l’annonce de sa réception au ciel leur fit aussi beaucoup de plaisir (1).
(1) Je me rappelle parfaitement que mesdames la supérieure et la dépositaire m’ont parlé de cette anecdote touchant la délivrance de feu M. Audouin, ajoutant que sur l’annonce de la Sœur les religieuses n’en avaient pas douté.
Je ne puis, à cette occasion, omettre un trait singulier qui m’arriva quelques mois après celui-ci. C’était précisément l’instant où la persécution était plus ardente contre moi. Le parti du démon triomphait, si je puis parler ainsi. J’étais atterrée, et cependant, s’il faut l’avouer, je ne faisais que de vains efforts pour me persuader à moi-même que j’avais été le jouet de l’erreur. Dieu, malgré moi, se faisait entendre au-dedans de moi-même. Mon Dieu, lui disais-je quelquefois, daignez m’instruire, m’éclairer, mettre fin à mon trouble…. Ah! si j’avais encore M. Audouin, au moins il me consolerait ! Qui me donnera de connaître ce qu’il en pense maintenant? Autrefois il était de mon avis, et si j’étais dans l’erreur, il y était aussi; mais de quel œil voit-il la chose depuis qu’il a paru devant Dieu? Voilà, si je le savais, ce qui me déterminerait; mais c’est en vain que je le désire, et Dieu ne permettra pas qu’il sorte, pour m’instruire, du fond de son tombeau.
Ainsi, mon Père, je raisonnais en moi-même un soir en me menant au lit. À peine y fus-je couchée, et notre lumière éteinte, que j’entendis derrière le rideau une voix très distincte, que je reconnus pour être celle de feu M. Audouin; tellement que je ne pense pas qu’il eût été possible à qui que ce fût, qu’on voudrait, contre toute apparence, supposer être entré dans notre cellule, de pouvoir, jusqu’à ce point, contrefaire ou imiter sa prononciation. La voix me dit, parlant bas, et du même ton qu’il prenait au tribunal : Ma Sœur, suivez la lumière du ciel qui vous éclaire, et ne vous arrêtez point aux vains discours de ceux qui n’y entendent rien.
Je fus surprise au dernier point, sans être le moindrement effrayée; au contraire, j’aurais bien désiré avoir avec lui une plus longue conversation, quoiqu’il m’eût beaucoup dit en ce peu de mots. C’était même le fond de tout ce que je voulais savoir, et je n’eusse voulu qu’avoir été un peu plus assurée encore que je ne l’étais de la réalité de la chose. Dieu ne le permit pas, et je ne dois dire que ce qui est arrivé, suivant l’exacte vérité du fait. Est-ce vous, M. Audouin, m’écriai-je?… J’eus beau parler et regarder à la faveur du clair de la lune, je n’entendis rien davantage, et n’aperçus aucune apparition; sur quoi il n’est pas facile, à mon avis, d’expliquer comment, si mes oreilles avaient été trompées, mes yeux n’eussent pas été affectés de la même illusion (1). Revenons un peu sur nos pas.
(1) C’étaient bien ici, en effet, ou jamais, le lieu et le temps de voir ou de croire apercevoir un fantôme, s’il était vrai que l’imagination pût en produire, comme on aime tant à le répéter.
M. Le Marié, nouveau directeur, est prévenu contre elle. Ce qu’elle a à souffrir.
M. Audouin avait été remplacé par M. Le Marié, qu’on eut grand soin de prévenir contre ce qu’on appelait mes extravagances, mes illusions, mes rêveries. (2). On prévint aussi M. Larticle, directeur des dames Ursulines, en qui j’avais beaucoup de confiance. J’étais suivie et observée partout avec le plus grand soin, jusqu’au tribunal de la pénitence, où, pour peu que ma confession eût été plus longue qu’à l’ordinaire on ne craignait point de m’avertir de finir, en me demandant tout haut si j’allais recommencer mes anciennes erreurs, et revenir à mes rêveries.
(2) M. Le Marié devint recteur de la paroisse de Balazé, près la ville de Vitré. Chassé de la communauté, j’allai pour le voir; mais j’arrivai chez lui le soir même où il était contraint d’en sortir pour échapper aux poursuites. Il me semble qu’il devait sentir alors que les annonces de la Sœur n’étaient pas aussi imaginaires qu’on lui avait persuadé. Je ne sais ce qu’est devenu cet excellent recteur.
__________________________
(170-174)
Je me rappelle, entre autres, qu’une pensionnaire entra un jour jusque dans le confessionnal, en m’apostrophant d’une manière très brutale, me traitant de fausse dévote, de folle, de bête, d’insensée, et autres gentillesses semblables, et cela pendant que M. Le Marié me donnait l’absolution, que je reçus très tranquillement. Sortie de là, j’avais presque envie d’éclater de rire, en pensant qu’on venait de me bénir et de m’absoudre d’un côté, tandis que de l’autre je ne recevais que des injures et des malédictions; mais la chose était trop sérieuse pour m’en amuser; je me contentai donc de prier pour elle sans rien en dire à personne.
M. Larticle lui déclare qu’elle a été trompée, et elle le croit.
Dieu, pendant un temps, ne me faisait plus rien voir; je n’avais plus à dire à mes confesseurs que des choses ordinaires et des misères humaines. Ils se crurent alors comme en droit de m’insulter eux-mêmes, en me représentant que plusieurs avaient été trompés par le démon, que tôt ou tard l’erreur se découvre, etc. M. Larticle me dit un jour tout nettement que nous l’avions été, M. Audouin et moi; qu’il avait trop peu d’expérience pour ces sortes de choses; que j’avais bien risqué de me perdre… On m’insinuait que j’aurais bien pu donner dans le piège d’une secte qu’on nommait les convulsionnaires, et où je ne connaissais pas plus qu’à tous leurs raisonnements (1).
(1) Tous leurs raisonnements et leurs principes manquaient en effet de base et d’application. Au reste, ceux qui ont lu la Vie des Saints, savent que celle-ci n’est pas la première que Dieu ait éprouvée de cette sorte, en permettant pour un temps que leurs directeurs aient attribué à l’opération du démon ce qui était l’effet d’une conduite extraordinaire du ciel; mais Dieu n’a jamais permis que les âmes dociles aient été abandonnées de tous leurs directeurs; il leur en est toujours resté assez pour les rassurer. La seule vie de sainte Thérèse suffît pour vérifier tout ce que je dis.
Tout cela, joint à la crainte que j’avais d’être trompée, vint à bout de me le persuader; et en cela, plus trompée que jamais, je remerciai Dieu de m’avoir enfin tirée de mon erreur, tandis qu’il n’avait fait que me guérir de mon orgueil. Je me trompe encore, mon Père, je n’en étais pas tout à fait guérie; mais voici le coup qui acheva pour ainsi dire de l’écraser: le coup heureux qui fit crever enfin ce vieux apostème, cet ulcère secret et envenimé que je nourrissais toujours, et que Dieu travaillait toujours à purger et à détruire de toutes les manières, et même à mon insu. Il faut, oui, il faut que ce malheureux orgueil lui soit bien insupportable, et qu’il fût bien enraciné dans mon coupable cœur, puisqu’il fallut des coups si multipliés et si sensibles pour l’en extirper, si je puis dire qu’il le soit encore; mais il y a toujours eu en moi une grande différence à cet égard, depuis l’époque que voici.
Elle se sent portée à annoncer à M. Larticle la persécution de l’Église. Il la traite de folle ou d’hérétique.
Je me sentis très portée à faire connaître à feu M. Larticle ce que Dieu m’avait fait voir sur la persécution de l’Église, l’usurpation des biens du clergé? le mépris de la puissance du pape, la persécution des ecclésiastiques, et le danger de la religion, par une puissance orgueilleuse que je voyais s’avancer contre elle…. J’étais comme hors de moi-même, et je lui parlai alors sans bien me comprendre. Tenez ferme, mon Père, lui disais-je, tenez ferme; je vois la sainte église qui s’ébranle à la vue de cette puissance formidable qui s’élève contre elle…. Plusieurs de ses piliers tombent… Je tremble pour elle. Tenez ferme, mon Père; je le dis à tous, tenez ferme.
À ces expressions, qu’il ne comprenait point, M. Larticle crut qu’il devait s’efforcer d’éteindre en moi jusqu’au souvenir de ce qu’il nommait mes illusions passées. Que dites-vous là, ma sœur, s’écria-t-il brusquement? que prétendez-vous dire? car je vous avoue que je ne vous comprends aucunement…. Êtes-vous prophète de malheurs…? (Il est bien clair aujourd’hui qu’elle ne l’était que trop.) Vous nous annoncez des choses sinistres et contraires à la foi. Luther a aussi prédit la chute de l’Église, mais l’Église ne doit jamais tomber. Prenez-y garde, ma Sœur, ou vous êtes hérétique, ou vous êtes folle, il n’y a pas de milieu. Pour moi, je n’y comprends rien (1). Il y avait pourtant un milieu.
(1) Pour moi, je n’y comprends rien. C’est à mon avis tout ce qu’il y avait de bien vrai dans son raisonnement, et en ce cas il n’eût pas dû affirmer si positivement qu’il y eût hérésie ou extravagance dans une chose où il ne comprenait rien. Nous avons déjà observé ailleurs que c’était lui-même qui était dans l’erreur par la seule crainte d’y tomber, et tout ce qu’il dit ici ne sert qu’à le confirmer. Il est bien dangereux de décider précipitamment, et surtout avec préjugé, sur ces sortes de matières.
Elle se soumet à sa décision, rétracte ses prétendues erreurs, et fait une confession générale.
La seule idée d’hérésie me déconcerta. Par le mot de sinistre dont il s’était servi, j’entendis qu’il me croyait janséniste. Seigneur, mon Dieu, m’écriai-je, moi janséniste! Ah! mon Père, plutôt mourir que d’être hérétique. Je vous déclare que je ne veux croire que ce que l’Église croit. Eh bien! mon Père, puisque l’Église me condamne, je rétracte et condamne avec elle tout ce que mon imagination m’a fait voir. (On voit ici que la pauvre Sœur avait une foi si simple, qu’elle prenait un prêtre pour l’Église, et une petite vivacité de sa part pour une décision dogmatique. Il y a pourtant en tout cela bien de la différence de l’un à l’autre.) Jamais je ne veux plus m’arrêter aux illusions de mon esprit; car puisque
__________________________
(175-179)
l’Église le décide, il n’y a plus aucun doute. Oui, j’ai eu le malheur d’être le jouet du démon…. Mon Dieu, ne m’en faites pas un crime, ou daignez me le pardonner; surtout préservez-moi de l’hérésie, que je crains plus que la mort. Je ne veux plus penser qu’à faire pénitence.
Et je ne m’en tins pas là, car j’en fis une confession générale et très ample, où je m’accusai de tout ce qui s’était passé, autant du moins que je m’en croyais capable; je refis toutes mes confessions précédentes, que je regardais comme inutiles à tout le moins; je pleurai même comme autant de crimes les visions et les révélations que je n’avais pourtant reçues que du ciel.
Ainsi, je le répète, car j’en suis convaincue maintenant, plus trompée que jamais, je remerciai Dieu de m’avoir guérie de l’illusion du diable, et il ne m’avait guérie que de l’illusion de mon esprit et de l’enflure de mon cœur. J’avais toujours bien raison de le remercier, mais je ne connaissais pas la nature du service qu’il m’avait rendu; je comptais tout perdu du côté du dessein de publier ce qu’il m’avait fait connaître, et pourtant il n’avait fait que me rendre plus propre à l’exécution de ce dessein. Il y travaillait depuis longtemps de toutes les manières, par différentes humiliations; mais jamais il ne m’abandonnait tout à fait, son divin amour suppléait à toutes les privations, et pouvait seul me soutenir au milieu de tant de souffrances et de peines.
Dieu la console dans ses peines, qu’elle attribue à la grandeur de son orgueil.
J’éprouvais des consolations intérieures qu’il serait inutile de vouloir expliquer, j’avais des intervalles où Dieu semblait se plaire à me dédommager de tout par des lumières et des faveurs extraordinaires sur différents points de notre sainte religion, et cela dans le temps même où il portait les plus rudes coups à mon orgueil. O mon Père, que Dieu est bon, et que nous avons grand tort de nous plaindre de ses rigueurs, puisqu’il ne frappe que ceux qu’il aime, et qu’il ne les blesse que pour les guérir ! Plus il m’abaissait d’un côté, et plus il semblait vouloir m’élever de l’autre; il semblait d’une main me montrer les récompenses et les couronnes, et de l’autre les combats et les croix qui pouvaient me les mériter. Il semblait me dire par sa conduite : Tu ne seras victorieuse de tes ennemis étrangers qu’après avoir triomphé de toi-même, en foulant sous tes pieds tous les désirs de la nature. C’est sur ses ruines que doit être construit l’édifice de la perfection. Il faut sans cesse travailler à crucifier le vieil homme en toi, pour donner la vie à l’homme nouveau. Ainsi, mon Père, environnée de croix, j’éprouvais les secours d’une charmante ouvrière que Dieu me fit voir en songe, je veux dire l’amour divin, qui s’occupait sans cesse à me les rendre légères et supportables, en les adoucissant par son travail. Je vous en parlerai ailleurs; en voilà beaucoup pour aujourd’hui.
Grande maladie qui la conduit aux portes de la mort. Terrible attaque du démon.
« Au nom du Père, du Fils, etc. »
Avant la plus sérieuse maladie que j’aie jamais éprouvée, J.-C. m’apparut sous la forme d’un beau soleil, dont la lumière douce et tempérée me fit entendre qu’il fallait m’armer de patience contre les attaques du démon; que pour cela je devais avoir la soumission la plus humble et la plus parfaite à la volonté divine, m’y abandonner sans réserve pour l’âme et pour le corps, et enfin me disposer à me résigner à tout ce que Dieu paraîtrait exiger de moi. Ce que je fis dès l’heure même, en lui offrant de bon cœur le sacrifice de ma vie pour quand il lui plairait d’en disposer.
Dès lors, mon Père, se déclara cette maladie sérieuse qu’on jugea bientôt devoir être la dernière : les médecins s’en étaient expliqués; mais celui qui l’avait permise, et qui est le souverain maître de la vie et de la mort, n’en jugea pas comme les médecins : il en avait même ordonné autrement, mais il fallait que j’eusse encore subi cette épreuve pour épuiser le calice d’amertume auquel il m’avait donné la grâce de me résigner. Munie des derniers sacrements, il ne me restait plus qu’un souffle de vie; qu’on s’attendait de voir s’éteindre à chaque instant. Toutes mes Sœurs en prières attendaient à recevoir mon dernier soupir; on alluma le cierge béni pour cette triste cérémonie; je croyais voir sous mes yeux la châsse ou cercueil destiné à m’ensevelir. On me jugeait sans connaissance. Hélas! mon Père, il ne m’en restait que trop encore pour ma tranquillité!
Quand on eut achevé toutes les prières de la recommandation de mon âme, voyant que je n’expirais pas encore, les religieuses se retirèrent et me laissèrent presque seule. C’était le moment où le démon m’attendait, et où Dieu lui permit de me livrer une cruelle attaque, j’aperçus au bout de mon lit, et presque à mes pieds, deux spectres noirs et d’une figure épouvantable qui paraissaient sortir du fond d’un abîme ; ils étaient armés de fourches, et ils disaient en m’insultant : Nous attendons ton âme pour nous en emparer, nous sommes destinés à te récompenser en enfer de ton orgueil, de ton hypocrisie et de tes crimes…. Sors donc bien vite,
__________________________
(180-184)
âme infortunée, et nous suis dans nos brasiers.
Que serais-je devenue, je vous le demande, mon Père, si Dieu ne m’eût arrêtée sur l’abîme du désespoir, et s’il ne m’eût seul soutenu contre ce terrible assaut qu’il permettait ? Tout ce que je pus faire dans l’état d’abandon où j’étais, ce fut de me tourner vers lui avec le plus de confiance qu’il me fut possible, et de lui promettre de faire pénitence, s’il me rendait la santé; après quoi les deux spectres me parurent rentrer dans l’abîme d’où ils étaient sortis.
Tremblante et tout épouvantée de cette horrible vision, mon esprit était aussi humilié que mon corps était abattu; et Dieu, comme vous l’allez voir, a travaillé depuis à entretenir en moi, par une voie toute nouvelle, cette disposition d’humilité qu’il y avait établie par des moyens si coûteux et si durs à la nature. Peu à peu je sentis les forces me revenir : l’appétit annonça le retour de la santé, et sitôt que je fus convalescente, j’allai rendre compte de tout ce qui s’était passé à M. Le Marié, qui ne comprit rien à tout cela.
Changement dans l’intérieur de la Sœur. Les grâces sensibles et extraordinaires cessent. Elle entre dans la connaissance de l’Être divin et de son néant.
Les disgrâces, les persécutions avaient humilié mon esprit, les maladies et les douleurs avaient abattu mon corps et réprimé les révoltes de la chair. La calomnie n’avait plus de prise, et le démon lui-même paraissait n’oser plus se présenter; et ce fut, mon Père, dans ce silence favorable des sens et des passions, dans cette trêve de la part de tous mes ennemis, que Dieu se fit entendre à moi pour me conduire par une route toute nouvelle qu’il me destinait.
Les apparitions, les extases, les lumières en Dieu, les consolations sensibles sont d’autant plus dangereuses pour ceux à qui Dieu les accorde, qu’il est toujours facile au démon de les contrefaire jusqu’à un certain point, et d’en faire au moins l’aliment de l’orgueil, qui s’en nourrit toujours, à moins que Dieu n’accorde en même temps, comme il l’a fait aux saints qu’il en a favorisés, des grâces proportionnées, des épreuves, des tentations, des croix capables de les contrebalancer, et de tenir toujours l’esprit dans l’humilité, sans quoi l’on pourrait encore tomber comme Satan, du haut du ciel jusqu’au fond de l’enfer.
Dieu suspendit donc en moi, fit même cesser tout à fait les lumières extraordinaires, les extases, les ravissements, les visions extérieures, pour leurs substituer des impressions que le démon ne peut que très rarement et très difficilement contrefaire, parce qu’elles n’ont presque aucun rapport avec les sens extérieurs; je veux dire, mon Père, la connaissance de Dieu et de moi-même, qui est à tous égards la voix la plus sûre pour le salut.
Dieu commença donc par me perdre dans l’idée toujours présente de son immensité, qui me tint lieu de toute consolation intérieure. Je voyais Dieu en tout et partout; tous les êtres me paraissaient absorbés et engloutis dans son immensité: c’était autant d’effets de sa toute-puissance, autant de ruisseaux qui partaient de son être divin et retournaient vers leur source commune: lui seul était grand, puissant, éternel, immuable. C’était l’être nécessaire et par excellence, puisque tous les autres n’existaient qu’en lui et par lui, sans avoir pour ainsi dire d’existence propre. Ainsi tout, excepté Dieu me présentait un vide affreux, une sorte de néant, dans lequel j’étais moi-même plongée, ou plutôt j’étais moi-même le vide affreux que je trouvais partout. Je portais en moi ce pur néant dont j’avais horreur.
C’était là que Dieu me faisait rentrer pour y voir ma misère et puiser les dispositions qu’il exigeait pour l’œuvre auquel nous travaillons aujourd’hui vous et moi. Cette idée de mon néant, par laquelle il m’a fait commencer ce que vous deviez écrire, il l’imprima si fortement au fond de mon âme et de tout mon être, qu’il m’a semblé quelquefois qu’elle y a enfin desséché jusqu’à la racine de l’orgueil. Plût au ciel! mon Père…. C’est ainsi, me dit-il un jour, après ma communion, que je veux désormais opérer en toi, sans ton secours ni l’entremise des sens corporels.
Toute sa vie lui paraît un amas de fautes, elle fait une nouvelle confession générale à M. Lesné.
Dans cette nouvelle disposition, mon Père, toute ma vie passée me parut comme un amas de fautes sans nombre, d’imperfections et de péchés considérables dont la multitude me glaçait d’effroi; pour me rassurer un peu et me tranquilliser, je voulus donc encore faire une confession générale, et ce fut jusque-là la plus exacte et la plus circonstanciée de ma vie. Je la fis à M. Lesné de Montaubert, qui venait de succéder à M. Le Marié, devenu recteur de la paroisse de Balazé. Il m’aida beaucoup; et comme je m’effrayais du nombre infini de mes fautes en tout genre, il me dit: Ma Sœur, si Dieu vous en donnait une entière connaissance, vous verriez que vous en laissez peut-être encore davantage, à prendre votre vie en général.
Il ne se trompait pas, et, pour m’en convaincre, bientôt Dieu mit aux yeux de mon âme le miroir fidèle de ma conscience. O ciel! quel aspect! j’y vis une multitude effroyable de manquements, de négligences, d’infidélités de toute espèce, que je reconnaissais pour
__________________________
(185-189)
être à moi, mais dont je n’avais jamais pensé à m’accuser en confession. Comme il n’y avait point eu de ma faute dans cette omission, j’en perdis encore la mémoire aussitôt que le miroir me fut ôté. Je me contentai donc de m’en accuser en général comme je les avais vus, et d’en être d’autant plus disposée à m’en humilier et à m’anéantir.
Ce grand vide que je voyais sans cesse hors de moi et en moi-même, joint à cette vue affligeante et continuelle de l’état de ma conscience, enfin le sentiment intime de mes misères et de la grandeur de Dieu, me portaient par eux-mêmes à la plus douce confiance en la bonté de mon auteur. Je me jetais alors toute entière en lui pour y trouver mon soutien, ma force, et toute ma consolation. Ces idées me tenaient dans mon centre, et n’auraient jamais dû me troubler en rien; cependant je m’aperçus que plus d’une fois le démon tenta d’en profiter pour m’attrister à l’excès, et m’inspirer de la défiance en la divine bonté.
Elle est épouvantée à la vue de ses infidélités. J.-C. la rassure.
Je sentais naître en moi une certaine crainte excessive que Dieu ne meut abandonnée, ou ne dût m’abandonner un jour pour mes infidélités. Cette effrayante perspective m’eût peut-être jetée dans une espèce d’état funeste, si J.-C. n’eût encore prévenu cette ruse du tentateur. Il m’apparut un jour que je me troublais davantage sur le grand néant des créatures et de moi-même. Que crains-tu, me dit-il? ne suis-je pas suffisant pour remplir un cœur? renonce à tout le reste, et tu trouveras tout en moi; abandonne-toi à ma volonté, et je saurai payer ta confiance, je saurai bien te dédommager des sacrifices que tu m’auras fait. Je suis tout pour celui qui ne tient plus à rien. Voici, ma fille, ajouta-t-il, ce que je te veux faire entendre par cette nouvelle conduite.
Ce grand vide de l’univers, ce néant de la créature, cette mort à toi-même et à tous les objets créés, est une figure frappante de ce qui arrive à la mort. L’âme, dégagée des sens par cette séparation de tout objet sensible, tombe dans ce parfait anéantissement de la nature entière. Tout a disparu, tout a péri, tout est mort pour elle : le monde n’existe plus ; elle ne voit plus, elle ne touche plus que Dieu; et dès l’instant même elle se voit plongée toute entière dans son immensité, comme une goutte d’eau qui tombe dans le sein de l’Océan, où elle est aussitôt absorbée sans perdre son existence propre.
C’est là que le vide est parfaitement rempli, parce que l’être créé se trouve alors dans son centre; il a atteint son but, il jouit de sa fin dernière et de son souverain bien. C’est là, ma fille, où je t’attends un jour, et c’est pour cela que je veux t’y préparer d’avance; car il n’y aura de reçu dans cet océan de bonheur que ceux qui s’y seront plongés pendant leur vie, en renonçant à tout pour s’abandonner sans réserve au sein paternel qui les a créés pour lui. C’est là la source d’où ils sont partis, vers laquelle ils doivent tendre sans cesse, parce que c’est l’unique centre de leur repos.
Malheur de l’âme qui a placé son bonheur dans les choses créées.
Quelle différence, mon Père, entre cette âme fortunée et celle du pécheur qui aura placé son bonheur et sa félicité dans la créature, les plaisirs sensuels et les désirs de la nature corrompue! Au moment où se rompront les liens qui l’attachaient à la vie et à la jouissance de ce monde trompeur, elle sentira aussi la présence de Dieu, mais elle ne le verra que comme un juge inflexible et inexorable. Des mouvements impétueux la porteront vers lui; elle voudra aussi se précipiter dans son sein; car c’est la pente naturelle et nécessaire de tout esprit créé; mais elle en sera continuellement repoussée par une force invisible, une main qui l’en arrachera sans pitié, un jugement terrible qu’elle ne pourra jamais fléchir, et qui aura toujours son exécution. Une voix formidable fera sans cesse retentir au fond de sa conscience criminelle ces désespérantes paroles: Retirez-vous, vous ne m’appartenez pas; je ne vous connais point.
Elle sera donc éternellement accablée sous le poids de ce néant qu’elle portera partout; néant d’elle-même et des créatures en qui elle avait mis sa confiance et son bonheur; vide effrayant, elle n’y trouvera de réel que l’illusion qui la séduit, les péchés qu’elle aura commis, et qui ne cesseront jamais de la tourmenter. Quel sort pour une âme immortelle! Quelle destinée pour une éternité! Pécheurs infortunés, deviez-vous naître pour un si grand malheur que vous ne voulez pas éviter, et auquel vous ne vous donnez pas même la peine de réfléchir ?
Cette connaissance de moi-même, mon Père, était donc la disposition où Dieu me voulait, et où il me conduisait depuis très longtemps, comme il a bien voulu me le faire connaître; mais ce n’était pas celle que le démon eût désirée, aussi n’a-t-il pas cessé de m’inquiéter encore sur ce point, comme il l’avait fait sur les autres, en me représentant que si j’avais été véritablement inspirée de Dieu, j’aurais été ravie jusqu’au troisième ciel et toute transportée hors de moi-même; enfin toutes les impertinences dont je vous ai rendu
__________________________
(190-194)
compte, et qui occasionnèrent les combats terribles par où nous avons commencé à écrire; car, à mesure qu’il redoublait d’efforts, Dieu faisait renaître et redoublait en moi les premières impressions qui avaient échoué.
Son impuissance à s’ouvrir avec M. Lesné. Sa grande facilité à le faire avec le rédacteur, à qui Dieu lui avait commandé de répéter comme un écho tout ce qu’il lui avait fait connaître.
J’avais beaucoup de confiance en M. Lesné pour lui faire mes confessions ordinaires; mais il faut l’avouer, j’éprouvais une répugnance invincible à lui faire connaître mon intérieur, relativement à ce que Dieu y opérait d’extraordinaire. Cette répugnance était encore fortifiée par certaines décisions et réponses très laconiques par lesquelles il savait éluder toutes les discussions qui auraient eu un peu l’air de revenir sur le passé. Soit que ce fût pour m’éprouver, ou que ce fût de sa part une certaine prévention qui lui eût été communiquée, comme on pourrait, je pense, le conjecturer; soit enfin que Dieu ne l’eût pas destiné pour cela, comme on pourrait le croire encore, de quelque manière que la chose ait eu lieu, je n’en étais pas moins obligée de concentrer ma peine en moi-même sans oser m’en ouvrir à personne. Je pris donc le parti d’attendre que le ciel s’expliquât davantage en me fournissant lui-même le temps et les moyens pour exécuter ce qu’il semblait encore exiger.
Enfin, mon Père, ce temps et ces moyens n’étaient pas éloignés, la divine Providence vous a conduit ici pour lever mes doutes, fixer mes inquiétudes, tranquilliser mon esprit, et remplacer tout ce que j’avais perdu dans feu M. Audouin, en mettant, comme je l’espère, la dernière main à l’ouvrage qu’il avait entrepris et commencé. Ce pressentiment, mon Père, je l’avais de vous, longtemps avant de vous avoir jamais vu, et avant qu’on sût que vous seriez notre directeur à la place de M. Lesné. Je vous dis ceci, mon Père, avec la même naïveté que je vous ai dit tout le reste (1). J’ai eu dès le commencement une confiance en vous qui ne s’est point démentie, et qui, j’espère, ne se démentira jamais. Aussi je vous ai dit plus de choses qu’à personne, et je puis vous assurer qu’aucun directeur ne m’a connue comme vous me connaissez. Je désire bien que vous soyez le dernier, et que vous m’assistiez à l’heure de la mort pour m’inspirer de la confiance à ce dernier passage, que j’ai tant lieu d’appréhender à cause des efforts que ne manquera pas de faire encore le démon, si Dieu lui en laisse la permission.
(1) Je puis le dire comme la Sœur, j’ai écrit tout ce qu’elle m’a dit, en tâchant de ne rien altérer, et même ce qui pourrait avoir quelque rapport à moi, avec la même naïveté que j’ai écrit le reste. Dieu est le maître de se servir de qui il veut, et les instruments les plus faibles sont toujours les meilleurs entre ses mains, comme je l’ai dit ailleurs.
Cette confiance que j’ai mise en vous, mon Père, m’était commandée, et presque jamais elle ne m’a coûté. Oui, je le répète, j’ai eu ordre de vous faire écrire tout ce qui s’est passé en moi pour les lieux, les temps et autres circonstances. Dieu m’a recommandé plus d’une fois de vous répéter comme un écho ce qu’il m’avait dit ou fait voir, parce qu’il en devait tirer sa gloire et le bien de son église. De votre côté, mon Père, vous avez exigé que je vous en rendisse compte; c’est donc pour obéir à Dieu et à vous que je l’ai fait: aussi j’ai commencé toutes mes narrations par me rappeler l’obligation où j’étais d’obéir. C’est Dieu encore, mon Père, qui veut que je finisse le long récit de ma vie intérieure, en vous donnant quelques réflexions générales sur les différents états ou je me suis trouvée, et les différentes lumières que j’ai reçues du ciel. Mais en voilà suffisamment pour aujourd’hui, il est temps de nous reposer. Adieu, mon Père, priez pour moi.
Manière dont Dieu lui a fait connaître ce qu’elle a fait écrire.
« Au nom du Père, du Fils, etc. »
Mon Père, pour ce qui concerne les visions et la manière dont Dieu m’a fait connaître les différentes choses dont je vous ai entretenu, l’Église et ses persécutions, le jugement, le paradis, l’enfer, le purgatoire, etc., etc., je vous ai parlé des lieux où les choses paraissaient se passer devant moi, tantôt un endroit, tantôt un autre, presque toujours sur des montagnes. Je vous ai dit que J.-C. m’y était apparu, comme aussi dans l’église, et même dans notre cellule, sous la forme humaine, et tel qu’il était pendant sa vie mortelle; quelquefois qu’il se faisait entendre, soit par des paroles, soit par des lumières intérieures, sans se laisser apercevoir.
Je vous ai déjà expliqué tout cela autant qu’il m’a été possible; mais si vous me demandez, par exemple, de quelle manière je me trouvais dans les différents lieux, je vous répondrai que je n’en sais rien. Tout ce que je puis vous attester de plus certain, c’est que, quand la présence de Dieu m’était manifestée d’une manière sensible par cette lumière, tout aussitôt, et dans le même instant, je me trouvais transportée dans le lieu où Dieu me voulait, et qui devait être le théâtre des scènes dont il avait arrêté de me rendre spectatrice; et alors, soit qu’il m’approchât des objets ou qu’il approchât les objets de moi, ce que je ne puis bien distinguer, et ce qui, je pense,
__________________________
(195-199)
n’importe guère, il est certain que je les voyais, à tout le moins, des yeux de l’esprit. Quoique je restasse beaucoup de temps dans la considération des différents objets qui m’étaient montrés, le premier mouvement qui m’y transportait se faisait toujours dans un clin d’œil; ce qui a lieu encore quelquefois quoiqu’un peu plus rarement. Je vois, je touche, j’entends, quoique l’usage des sens soit interrompu en tout ou en partie, comme je vous l’ai dit autrefois.
Pour vous le mieux faire comprendre, mon Père, il suffira de vous rappeler encore ce qui s’est passé en moi pendant qu’on chantait la prose des morts, à la Toussaint dernière. Je me sentis et me vis tout à coup transportée en enfer; mais, comme vous savez, je n’avais rien à craindre, puisque j’y étais avec J.-C. Là, je vis, j’examinai tous les objets effrayants dont je vous ai parlé dans le détail que je vous en ai fait. Pendant le temps que mon esprit en était occupé, j’entendais à demi les religieuses qui chantaient à côté de moi; mais leurs voix réunies ne formaient qu’un son presque imperceptible et insensible à mes oreilles. Vers la fin de la prose, je sortis de cette espèce de léthargie, je repris l’usage des sens comme une personne qu’on réveille d’un sommeil profond, où elle avait cru entendre certain bruit qui l’avait un peu troublée.
Ces ravissements qui m’arrivaient plus fréquemment autrefois, ne laissent pas de m’arriver encore par intervalles; et alors, soit que je médite dans le chœur, dans ma cellule, ou même pendant la récréation, je suis beaucoup plus où Dieu transporte mon esprit, que dans l’endroit où reste mon corps. C’est ce qui me fait tant craindre les récréations, comme je vous l’ai dit ailleurs, parce qu’elles sont une gêne pour moi.
La moindre négligence de sa part met obstacle aux, faveurs de Dieu.
La moindre négligence de ma part, la faute la plus légère met toujours plus ou moins d’obstacles aux faveurs du ciel. Une faute plus griève peut m’en priver tout à fait, et si cette faute allait au mortel, elle mettrait un mur de séparation entre Dieu et moi. Il retire alors ses grâces et se retire lui-même; mais dans les fautes ordinaires, il se contente de me faire des reproches plus ou moins vifs : quelquefois ce ne sont que des reproches de tendresse; vous diriez un époux indigné qui se plaint des froideurs d’une épouse toujours aimée, et qu’il menace pourtant de son abandon. Ce n’est quelquefois qu’après l’absolution et plusieurs communions qu’il m’apparaît pour me laisser le temps de le désirer et la douleur de l’avoir contristé. Je crains alors son approche et ses premiers regards; mais je les désire encore bien plus que je ne les crains.
Impressions de grâces qu’elle recevait dans les révélations dont Dieu la favorisait. Forte impression de haine du péché.
Dans ces moments d’apparition, je me trouvais frappée des objets agréables ou terribles qui venaient tour-à-tour m’affecter de crainte, d’espérance ou d’amour, et ces impressions étaient relatives aux différents objets. En considérant les tourments de l’enfer, par exemple, je ressentais des impressions aussi salutaires qu’elles étaient vives, qui me portaient à trembler sur moi-même et sur l’incertitude de mon sort éternel. Il en était ainsi du purgatoire par proportion.
En voyant le bonheur des saints, je me sentais portée à tâcher de le mériter par des bonnes œuvres; comme en voyant le malheur et les tourments des réprouvés, je me sentais fortement portée à tout entreprendre pour les éviter. Ces deux extrêmes me faisaient sentir, et comme toucher au doigt, par leur effrayante et inévitable alternative, tout le prix de mon âme et toute l’importance de son sort éternel. Je comprenais alors toute la force et toute la vérité de ces paroles de l’évangile: Que sert à l’homme d’avoir gagné tout le monde entier, s’il vient à perdre son âme? Qui pourra jamais le dédommager de cette perte irréparable?
Voilà l’importance du salut. Je flottais ainsi entre l’espérance du ciel et la crainte de l’enfer, et je tremblais sur l’incertitude de mon éternité; disposition que le démon n’a jamais fait naître, qu’il n’essaie pas même de contrefaire, et qu’il ne pourrait jamais bien imiter.
Considérant, entre autres, certains tourments des réprouvés, je sentais ma conscience me dire que je les avais mérités. Quelle frayeur! je concevais sur l’heure une haine si grande contre le malheureux péché qui m’avait rendue digne d’un pareil châtiment, qu’elle surpassait la haine que j’avais contre le démon qui m’y avait portée, et jusqu’à la crainte de ce tourment même : la séparation et la perte de Dieu, quelque insupportable qu’elle soit en elle-même, me le paraissait alors moins dans un sens; rien n’était au-dessus de la crainte que je concevais d’être éternellement le sujet du monstre qui l’outrage; d’avoir éternellement dans le cœur des crimes qui ne seraient ni remis, ni pardonnés, ni oubliés, et qui existeraient sans fin pour le malheur d’une créature indestructible, qu’ils auraient pour toujours rendue ennemie de son Dieu, et d’un Dieu qu’ils auraient pour toujours armé contre elle.
J’entrais alors tellement dans la haine irréconciliable que Dieu porte à cet ennemi mortel, qu’entendant la sentence
__________________________
(200-204)
qu’il prononça contre lui au jugement général dont il me rendit témoin, je lui dis : Oui, ô mon Dieu! si jamais j’ai le malheur d’être réprouvée comme ces pauvres infortunés que vous condamnez pour avoir le péché dans le cœur, je ratifie d’avance cette même sentence que vous portez contre moi, comme vous la portez contre eux. Quelqu’effroyable qu’elle soit, je la reçois et la ratifie; je me condamne moi-même aux tourments de l’enfer, afin de vous venger des outrages horribles que le monstre odieux vous a faits. O mon Père ! si les hommes en avaient une juste idée; s’ils en connaissaient la laideur; s’ils savaient quelle haine lui est due, comme ils le puniraient et le détruiraient en eux-mêmes par une pénitence salutaire qui préviendrait la rigueur de la justice de Dieu!
Une âme, fût-elle revenue du troisième ciel, comme l’apôtre Saint-Paul lui-même, pourra-t-elle jamais penser à s’enorgueillir, quand on lui aura fait voir et son néant, et l’énormité, et la laideur des péchés qu’elle a commis ou pu commettre, ainsi que les tourments horribles qu’ils lui ont mérités, et qui l’attendent peut-être au bout de sa carrière; car qui sait s’il est digne d’amour ou de haine ? Cet homme, loin d’abuser des faveurs du ciel, en se rassurant sur l’incertitude de son salut, n’en sera-t-il pas que plus disposé à travailler à cette grande affaire avec tout le soin que demande son importance et sa nécessité, afin de réussir à l’opérer avec la crainte et le tremblement que l’Esprit-Saint nous demande par la bouche de l’apôtre que je viens de nommer?
C’est, mon Père, la disposition où je me trouve actuellement, et que Dieu a toujours demandée de moi, comme il a toujours tâché de l’y faire naître; mais cette heureuse disposition, il s’en faut beaucoup qu’elle me soit venue tout à coup, ni même dès le commencement de mes révélations. Il a fallu que la grâce m’y ait disposée par toute sorte de moyens, comme vous l’avez vu, et par des moyens extraordinaires qui sont pour moi un nouveau sujet de tremblement pour le compte qu’il m’en faudra rendre.
Oui, mon Père, et vous le savez, autrefois j’étais bien éloignée du point où, par la grâce de Dieu, je me trouve aujourd’hui. Il entrait bien des imperfections dans le peu de bien que je faisais; la nature se retrouvait sans cesse; le démon mettait du sien partout. Ainsi, je le répète encore, et je parle comme je suis affectée, si tout a manqué par le passé, ce n’est guère qu’à mon orgueil et à mes mauvaises dispositions qu’il faut s’en prendre: ce qui arriverait encore infailliblement si Dieu n’avait fait tous les frais en détruisant tous les obstacles; car, pour ce qui est de moi, je puis, sans avoir besoin d’humilité, vous assurer que je ne suis capable que de gâter l’ouvrage de Dieu et de nuire à ses grands desseins : c’est de quoi je suis aussi sûre que de mon existence.
Danger des grâces extraordinaires. Dans les saints, elles sont accompagnées de grandes souffrances et humiliations.
Quant aux faveurs sensibles, et aux lumières qui produisent des extases et des ravissements, ou dont l’effet se termine au-dehors par des apparitions et choses visibles et extraordinaires, il est hors de doute qu’elles sont, dans un sens très réel, bien plus à craindre qu’à désirer, parce que c’est toujours en faveur des autres qu’elles sont accordées, et qu’elles sont dangereuses pour ceux en qui elles se passent, si elles n’y sont contrebalancées par des moyens qui puissent efficacement détruire ce qui pourrait nuire à la vertu du sujet dans lequel elles se trouvent.
Ainsi, mon Père, Dieu m’a fait connaître que toutes les fois qu’il les a employées pour le bien de son église et le salut des âmes, il a toujours accordé à ceux qui en étaient les instruments, des humiliations, des souffrances, des grâces enfin de prédilection qui les forçaient, pour ainsi dire, de rentrer en eux-mêmes, et les tenaient toujours dans leur néant. Aussi voit-on que ceux dont Dieu s’est servi pour être les instruments de ses miséricordes, afin de rappeler les hommes à leur devoir, ont été presque tous des saints de la mortification la plus parfaite et la plus entière, comme de la plus profonde humilité.
Profonde humilité des hommes appelés à opérer des merveilles dans l’Église.
Oui, mon Père, ces hommes extraordinaires et du premier mérite pour la plupart, ces saints à miracle, et à qui les prodiges qu’ils opéraient en tout genre ont fait souvent donner le nom de thaumaturges, Dieu m’a fait voir qu’ils n’étaient en sûreté, au milieu des honneurs qu’on leur rendait, qu’autant que leurs passions étaient éteintes et mortes dans leur cœur, qu’autant qu’ils n’agissaient plus qu’au nom de Dieu, et sans aucun retour sur eux-mêmes. L’orgueil se présentait encore : mais dans la plupart il trouvait un cœur inaccessible à ses attaques, et des passions qui ne respiraient plus. Le démon et la nature étaient vaincus et obligés de se taire, et c’est ce qui faisait leur sûreté.
Oui, mon Père, je vois que ces saints personnages ne vivaient plus que de l’amour de Dieu, dont ils recherchaient la gloire en tout et partout; n’usant de la créature que pour s’élever au
__________________________
(205-209)
Créateur; en un mot, ils étaient morts à eux-mêmes, au monde et aux plaisirs des sens; ils ne cherchaient qu’à répondre à sa grâce, à combattre leurs passions, vaincre leurs tentations, et triompher absolument du vieil homme. Il s’en est trouvé, et il s’en trouve encore d’autres qui ne sont pas tout à fait dégagés de l’empire des sens et des passions, qui sont encore remplis de retours sur eux-mêmes, d’imperfections et même de défauts. Ces personnes ne sont pas grandement criminelles, mais elles peuvent le devenir et ne le deviennent que trop souvent, ou du moins leur attache à la créature ne leur fournit que trop d’occasions de chutes et d’infidélités. C’est pour elles surtout que les faveurs sensibles et extraordinaires sont dangereuses, parce que comme nous l’avons exposé, non-seulement le démon peut toujours les contrefaire jusqu’à un certain point pour les jeter dans l’illusion, mais encore il peut s’en servir pour réveiller un orgueil mal assoupi et leur faire perdre la belle vertu d’humilité sans laquelle un ange de lumières n’est pourtant qu’un ange de ténèbres, qu’un vrai démon aux yeux de Dieu.
Manière dont Dieu a prémuni la Sœur contre l’orgueil dans les grâces extraordinaires qu’il lui a communiquées pour le salut des âmes.
Aussi, mon Père, dans ces grâces extraordinaires qu’il m’a communiquées pour le salut des autres, il m’a fait voir que sa bonté a beaucoup épargné ma faiblesse. Mon amour-propre était trop sensible, mes passions trop vives, et mon orgueil trop prêt à s’enflammer. Il m’a fait entendre que je me fusse perdue sans ressource, s’il n’eût tempéré les grâces qu’il mettait en moi gratuitement et pour les autres, par celles qu’il n’y mettait que pour moi. Telles sont la claire vue de ses grandeurs, de mon néant, de mes péchés, la crainte de ses jugements, ainsi que l’oubli parfait et entier de mille choses qu’il m’avait fait connaître, et dont il ne m’a rappelé le souvenir que pour vous les faire écrire, sans même que je puisse, le moment d’après, en faire aucun usage. Bonne preuve, à mon avis, que les idées ne viennent point pour moi, puisque je ne puis ni les avoir de moi-même, ni les éviter quand Dieu me les donne, ni les reprendre ou les garder quand il me les ôte. Peut-on encore conserver de l’orgueil quand on a éprouvé autant d’impuissance et de pauvreté, quand on a enfin autant de sujets de s’humilier que j’en ai?
Dieu m’a donc fait voir, mon Père, que le démon peut imprimer, par exemple, dans l’oraison, des lumières extraordinaires, des suavités des goûts sensibles, qui, joints à la persuasion d’une humilité qui n’est qu’imaginaire, comme le reste, font croire aux âmes qui les éprouvent pour leur malheur, qu’elles sont agréables à Dieu, et qu’il n’y a plus rien à craindre pour elles; piège d’autant plus dangereux qu’il leur est bien plus difficile de l’éviter, et même de l’apercevoir, quoique les personnes plus versées dans la vraie spiritualité et dans la vie intérieure sachent pourtant bien s’en défendre. Elles n’ont besoin pour cela que de comparer ensemble les impulsions différentes qu’elles ressentent en certains moments pour discerner l’illusion et débrouiller l’œuvre de Dieu de l’œuvre du démon. Mais nous y reviendrons encore si vous le jugez à propos. Restons-en donc là pour ce matin; et ce soir, après la récitation de votre bréviaire, nous reprendrons le détail de ma pauvre vie intérieure. Dieu aidant, nous tâcherons enfin d’en finir. Priez pour moi….
Illusions du démon dans certaines choses extraordinaires qu’il peut contrefaire. Leur effet est toujours l’enflure du cœur.
« Au nom du Père, etc. »
Mon Père, l’effet que produit toujours l’illusion du démon, je ne saurais trop le répéter, consiste dans une vaine satisfaction qui vient d’une grande estime de soi-même, une enflure de cœur qui porte toujours à se croire meilleur que les autres. Cette impression, comme je l’ai déjà dit, jamais les âmes vraiment intérieures ne la confondent avec celle qu’occasionne la vue de la présence de Dieu, et il n’y a pas moyen de s’y tromper quand une fois l’on a éprouvé l’une et l’autre. L’une affecte l’intérieur de l’âme, qu’elle satisfait et tranquillise en l’humiliant; l’autre s’empare de l’imagination et des sens, qu’elle trompe en les troublant. Dieu seul peut guérir le cœur humain, comme il peut seul le satisfaire et le remplir; il peut seul y rétablir la paix en y détruisant les passions qui s’y opposent. Le démon n’en produit que l’apparence en mettant le fantôme à la place de la vérité; il combat une passion par une autre passion, un vice par un autre vice plus caché, et ne nous fait éviter un abîme que pour nous faire tomber dans un autre souvent plus profond. Oui, mon Père, quand on aurait détruit tous les vices, le démon serait toujours content, pourvu seulement qu’il pût faire renaître l’orgueil sur leurs débris. Ainsi, nous ballottant d’un excès dans un autre, il fomente tous les vices et toutes les passions, toutes les mauvaises inclinations de la nature corrompue, et prépare au fond du cœur une guerre plus cruelle sous l’apparence de la paix. C’est un feu caché sous la cendre qui cause l’incendie, un calme trompeur qui annonce l’orage et expose à une perte irréparable l’imprudent qui ne sait pas l’éviter.
Je me représente, mon Père, le
__________________________
(210-214)
combat de Moïse et des magiciens de Pharaon. C’est précisément Dieu et le démon aux prises. Par l’artifice du démon et leur commerce avec l’enfer, les magiciens viennent à bout de contrefaire, jusqu’à un certain point, ce que fait le saint législateur des Hébreux : ils opposent des prestiges et des enchantements à des prodiges véritables; mais il y a un point où ils se voient obligés d’avouer leur impuissance et leur défaite, ainsi que la supériorité de leur antagoniste, et c’est ce point où la Divinité les attendait pour les forcer à la reconnaître à son opération, en disant: Le doigt de Dieu est ici. Il n’était donc pas de leur côté.
C’est ainsi que dans tous les temps le singe de la divinité a voulu se mêler de son œuvre; mais ce n’a jamais été que pour la défigurer. C’est pour cela qu’il a opposé les oracles aux prophéties, et le culte des faux dieux à celui du vrai. C’est lui qui, par les mêmes moyens et pour la même fin, a produit des schismes et des hérésies, sous prétexte de réforme, et a prétendu rétablir la religion et l’Église, quand il travaillait à son entière destruction. Que de pièges ne tend-il pas tous les jours à la simplicité de la foi et de l’innocence, dans ses productions insidieuses où le serpent se cache sous les fleurs, où l’on fait avaler le poison mortel dans des liqueurs délicieuses, et où le faux de l’erreur disparaît sous les apparences de la vérité !
Règles pour discerner les fausses lumières qui viennent du démon.
Mais, mon Père, c’est surtout en genre de spiritualité que cet habile charlatan met tout en œuvre pour faire prendre le change. C’est là surtout qu’il s’y prend de toutes les manières pour tromper une âme, sous prétexte de perfection, comme je l’ai dit. Nous l’avons vu, mon Père, il est toujours facile aux âmes versées dans la vraie spiritualité, de découvrir ses embûches et de discerner ses fausses lumières; mais pour celles à qui leur expérience n’a pas donné un goût si délicat, un discernement si sûr dans les voies de Dieu, elles doivent s’appliquer à considérer, d’après les principes de la foi :
1° ce que le démon peut et ne peut pas ;
2° la manière dont il opère, par opposition à celle de Dieu, comme nous l’avons développé fort au long à différentes fois; enfin , surtout, le but qu’il se propose, qui est toujours de combattre les desseins de Dieu, et de jeter ou retenir les âmes dans l’illusion, comme de fortifier le malheureux roi d’Égypte dans l’aveuglement d’où Dieu tâchait de le retirer de toutes les manières. D’après ces règles secondées surtout de la lumière divine, on verra clairement que dans tous les genres dont il veut se mêler, il est un point que le démon ne peut contrefaire, ou dans lequel il est toujours facile de discerner la vérité de la contrefaction. Ce point, mon Père, Dieu le doit à son œuvre, à Sa créature et à soi-même, et cette pierre de touche doit être a la portée de tous, afin que personne ne soit tenté au-dessus de ses forces.
Un bon moyen de découvrir l’erreur de ses suggestions, quand il se présente à une âme, c’est de ne rien admettre de contraire à la foi, à l’écriture ni aux décisions de l’Église. Voilà encore pour les différentes suggestions prises en particulier, la pierre de touche de la vérité. Il n’est pas possible que le Père du mensonge ne s’en écarte bientôt, et ne tâche de nous en écarter avec lui, puisque son but principal est de combattre et de détruire, autant qu’il est en lui, notre soumission à l’Église et notre foi aux vérités qu’elle est chargée de nous proposer; mais, comme je l’ai dit, d’après ce que Dieu m’en fait connaître, il n’est pas possible que l’imposture ne se contredise, il faut nécessairement qu’elle se trahisse elle-même par quelque endroit.
Oui, mon Père, et prenez ceci pour une vérité incontestable : quelques belles connaissances que le démon prétende nous donner dans les matières de spiritualité, il est impossible qu’il ne gauchisse en quelque chose sur la foi et l’obéissance à l’Église, qui a toujours fait le tourment de sa haine et de son orgueil. Mais un autre moyen, et très excellent encore, de découvrir la ruse de cet esprit d’erreur, c’est de joindre à ce dévouement à la foi une volonté ferme et constante de suivre en tout la volonté divine et de ne s’en écarter en rien. Cette disposition, qui plaît infiniment à Dieu, déplaît, n’en doutez pas, souverainement à son ennemi, et il est encore impossible qu’un cœur où elle se trouve soit longtemps le jouet de l’erreur; le flambeau de la foi qui le conduit par la voie de l’obéissance et de l’amour, aura bientôt dissipé cette fausse lumière qui lui fait illusion.
Bien différente de ce charlatanisme spirituel, de cette lueur trompeuse et momentanée, qui ne peut éblouir qu’un instant et disparaître le moment après la lumière vive et douce qui vient de J.-C, ne fait que s’augmenter et s’accroître à l’approche de ce divin flambeau de la foi. C’est un feu ajouté à un autre feu de la même nature, et qui n’en devient que plus ardent par cette réunion; au lieu que le prestige du démon disparaît comme des feux follets ou phosphores de la nuit, devant l’astre qui éclaire le monde par la force de ses rayons bienfaisants. D’où il faut conclure que toutes ces prétendues
__________________________
(215-219)
inspirations qui viennent du monde ne sont, à le bien prendre, que les tours de passe-passe d’un habile escamoteur qui ne vit qu’aux dépends de ceux qu’il rend dupes de son charlatanisme; et cependant, mon Père, quelque grossières que fussent les tromperies de ce charlatan, Dieu me fait connaître que j’en eusse été infailliblement dupe moi-même en bien des rencontres, s’il ne m’eût prêté une main secourable pour me retirer de l’erreur ou me préserver d’y tomber.
Un des confesseurs de la Sœur consulte Dieu sur la voie par laquelle il devait la conduire. Réponse de J.-C. à la Sœur à ce sujet.
Un de mes confesseurs extraordinaires avait consulté Dieu sur la voie par laquelle il devait me conduire (1). « Ma fille, me dit J.-C., dis de ma part à ton confesseur que je t’appelle par la voie des souffrances à l’union avec ton Dieu crucifié, c’est la moins sujette à l’erreur; car, ajouta-t-il, je me plais à
(1) C’était feu M. Beurier, grand missionnaire de la Congrégation des Eudistes, très versé dans la direction des âmes, auteur d’un ouvrage estimé, Conférences sur la Foi, mort enfin en odeur de sainteté. Il avait, comme bien d’autres, été d’avis que la Sœur eût fait écrire par M. Audouin, comme on l’a vu d’abord.
conduire les âmes par différentes voies qui sont inconnues quelquefois même à leur propre directeur, aussi bien qu’à elles-mêmes. Comme le démon a ses ruses secrètes et ses détours cachés, et les mondains leurs fausses maximes pour les tromper et les séduire, j’ai aussi, pour les soutenir et détruire les ruses du démon et des mondains, des moyens particuliers que la prudence humaine ni la diabolique ne saurait comprendre. Je permets très souvent leurs tentations et leurs combats intérieurs, pour contrebalancer ce qu’il y a de bien en elles, et tenir mes grâces à couvert de l’amour-propre qui ne cherche qu’à les enlever. S’il arrive que le démon triomphe en quelque chose sur leur volonté, dans les combats que je lui permets de leur livrer, je me sers alors de sa victoire pour le combattre avec plus d’avantage, le vaincre à mon tour en le perçant de ses propres traits. Ainsi, par un secret que le démon craint, et qui est au-dessus de ce qu’on peut dire, j’oppose l’effet à la cause, et j’emploie les crimes commis pour extirper l’orgueil qui les a produits. Par là j’écrase la tête du serpent sur sa propre morsure pour en faire un cataplasme qui puisse la guérir.»
Grâce d’anéantissement établie par les souffrances dans le cœur de la Sœur. Son union avec J.-C. souffrant et anéanti, surtout au Saint-Sacrement de l’autel.
Combien de fois, mon Père, n’ai-je pas eu le bonheur d’éprouver cette conduite charitable de la part de mon Dieu ! Que de grâces n’ai-je point à lui rendre pour m’avoir retenue auprès de lui en m’attachant à la croix! Il avait sans doute ses desseins de miséricorde, en me jetant dans la mer des humiliations et des souffrances. Ah! qu’il en soit éternellement béni! Le démon s’était servi des lumières de Dieu même pour faire entrer l’orgueil dans mon esprit; il a donc fallu que, pour déjouer ses ruses, tromper ses espérances et triompher de ses succès, Dieu ait agi par toutes les voies inconnues à la malice du démon comme à toute la prudence humaine.
Son ennemi comptait bien avoir détruit de fond en comble le projet qu’il avait à craindre, et ce projet n’avait jamais été si près de réussir qu’au moment où il s’applaudissait de son triomphe, et où je croyais moi-même que tout était manqué. Mais, je le répète, je reconnais que jamais je n’aurais été si heureusement trompée que dans le moment où je remerciais Dieu de m’avoir tirée de l’erreur.
Ce fut aussi dans ce temps qu’une nouvelle grâce et une nouvelle lumière commença à me faire descendre dans l’abîme de mon néant; miroir fidèle où je puise à loisir la connaissance de Dieu et de moi-même. J’y vois comme deux extrémités opposées, la puissance d’un côté, la faiblesse de l’autre, et Satan comme posté entre les deux, toujours aux aguets pour nuire à l’un ou à l’autre parti, s’étudiant sans cesse à profiter de toutes les occasions et de tous les moments pour soulever, pour armer les passions contre l’infirmité d’une nature qui ne peut rien sans la grâce; mais ce qu’il y a de consolant, je vois aussi dans ce miroir que Dieu ne la refuse jamais au besoin à ceux surtout qui la demandent comme il faut, et font ce qu’ils peuvent pour en profiter.
Je dois encore vous dire, mon Père, que par l’attrait de cette grâce d’anéantissement et d’union avec mon Sauveur, je me trouve portée sans cesse à unir mes croix à la croix de J.-C., mes humiliations à ses humiliations, mes souffrances à ses souffrances, ma mort à sa mort et passion, pour en honorer les circonstances douloureuses, et faire par ce moyen pénitence pour tous mes péchés et ceux de tous les hommes, suivant qu’il me l’a été prescrit comme je vous l’ai dit ailleurs.
Je me trouve encore, par cet attrait intérieur, très fortement portée à m’unir à J.-C. au Saint-Sacrement de l’autel, par le mystère de sa vie et de sa mort, et par ses anéantissements et ses opprobres. J’éprouve comme une faim et une soif de me perdre dans le divin sacrement, comme une goutte d’eau qui se perd et se confond dans la vaste étendue de l’océan où elle est tombée. C’est, mon Père, ce qu’il me grava profondément au fond de l’âme dans une circonstance dont je vous ai rendu compte, et où, se plaignant à moi, et
__________________________
(220-224)
de mes péchés et de ceux de tous les hommes, il me dit : « Ma fille, si tu veux m’être agréable et te rendre digne d’accomplir ma volonté, en exécutant les desseins que j’ai sur toi, c’est de me rapporter à chaque heure du jour les mérites de ma passion, suivant les différents mystères qui la composent, et cela en union de l’état d’oraison et de sacrifice où je me trouve au divin sacrement de mes autels, qui est le perpétuel mémorial de ma passion, en même temps qu’il est le trône de mon amour…. » Voilà, vous le savez, mon Père, l’origine des pratiques dont vous m’avez permis de renouveler le vœu.
Il y aurait bien des volumes à écrire sur ce que J.-C. m’a fait voir et éprouver à cette occasion, sur la nécessité où nous sommes tous d’être unis à lui dans nos souffrances, et sur l’inutilité de nos mérites sans cette union. « Veillez, priez, me dit-il, pour résister à la tentation; ne cherchez en tout que ma pure gloire et mon pur amour; détachez-vous de la créature et de vous-même pour ne vous attacher qu’à moi, et je serai votre soutien et votre lumière. Ce n’est qu’en moi et par moi que vous pouvez combattre et mériter, etc., etc. »
Nécessité d’être uni à J.-C. souffrant, et de combattre toujours l’orgueil, qui vient autant du fond de notre nature corrompue, que du démon.
Au reste, mon Père, en vous faisant, par obéissance, connaître l’attrait de cette grâce qui me porte à l’anéantissement de tout moi-même, je ne me prétends pas pour cela exempte de l’orgueil ni des autres vices de la nature humaine. Ah! je m’attends bien, au contraire, que je les aurai à combattre plus ou moins jusqu’au dernier soupir. Le premier, surtout, est un ennemi rusé, qui ne se retire pendant un temps que pour mieux surprendre, en revenant à la charge au moment où il est le moins attendu. Oui, je vois en Dieu que dans les plus grands saints eux-mêmes ce monstre infernal peut renaître de ses cendres et causer la perte de celui qui triomphait de sa défaite. Ah! qu’il est terrible d’être toujours aux prises avec un ennemi aussi subtil et aussi dangereux ! Que le démon est à craindre pour nous, et que nous devons désirer d’être une bonne fois hors de ses atteintes !…
Mais, mon Père, pourquoi m’en prendre toujours au démon sur mes misères? Pourquoi le rendre tout seul responsable de mes vices, de mon orgueil? Hélas! pour peu que je sonde mon propre cœur, je sens que ma nature ayant été infectée et corrompue par le péché d’origine, je suis par moi-même remplie de vanité, d’orgueil et de mensonge; un composé de misère et de péché plus à craindre pour moi, je dirais presque que tous les hommes ensemble. Que pourrais-je devenir, si J.-C. ne me fournissait dans l’ouverture de ses plaies un asile assuré contre l’enfer et contre moi-même ? Aussi c’est le port tranquille, et comme le terme où il m’a toujours appelée pour éviter le naufrage infortuné qui pourrait me rendre inutile et me faire perdre pour toujours le fruit de tant de grâces et de tant de travaux.
Vérité bien effrayante, mon Père, et qu’il vient encore, pour ainsi dire, me regraver dans l’esprit d’une manière bien énergique et bien capable de faire une impression durable. Comme elle me paraît venir ici à propos, et que Dieu sans doute a eu ses raisons de choisir cette circonstance pour me la retracer, je vais vous la conter en finissant.
Trait frappant d’un naufrage, que Dieu applique intérieurement à la Sœur. Ses humbles sentiments.
Une religieuse rapportait un jour, pendant la récréation, un trait qu’elle avait lu autretois ou entendu lire dans je ne sais quels papiers publics. Il s’agissait d’un riche marchand ou commerçant qui revenait d’un loug et pénible voyage, sur un vaisseau chargé de richesses immenses et considérables qui devaient assurer sa fortune et le sort de sa famille. Impatients de le voir, et informés du jour où il doit arriver, sa femme, ses enfants, tous ses amis s’étaient rendus sur le rivage, où ils semblaient, par leurs cris de joie, hâter la marche trop lente, à leur gré, du vaisseau qu’ils découvrent en pleine mer. Cette vue les fait jouir du bonheur; mais hélas! ce ne fut pas pour longtemps. Cette jouissance prématurée ne leur procura qu’un bonheur passager qui fut suivi de bien des larmes.
Le vaisseau tant désiré approche, il arrive, on le touche presque. Le maître paraît, reconnaît sa chère famille, et la salue quoique de loin; et le moment d’après, sous les yeux de cette même famille le vaisseau vient à échouer et faire naufrage, de sorte que tout périt sans qu’on n’en pût rien sauver ni conserver.
Pendant qu’avec les autres religieuses j’écoutais attentivement le récit tragique, qui n’avait rien assurément que de très propre à nous faire sentir l’inconstance et la caducité des faux biens d’ici-bas, Dieu m’en fit sur-le-champ une application bien plus frappante encore, et me la grava si profondément dans l’âme, qu’il n’y a pas de crainte qu’elle puisse jamais s’en effacer….
« Voilà, me dit-il intérieurement, à quoi une âme, est exposée jusqu’au dernier moment. Après avoir acquis de grandes; richesses spirituelles, évité tous les écueils du salut, échappé à tous les dangers, et même vaincu tous les ennemis, elle peut malheureusement faire naufrage comme à la vue du port et sur le point de recevoir la
__________________________
(225-229)
récompense éternelle de ses nobles travaux. »
Ah ! mon Père, si un sort si déplorable, si un aussi triste dénouement peut être celui d’une âme remplie de mérites et de vertus chargée de toutes sortes de bonnes œuvres comme je l’ai compris, que n’aura pas à craindre, je vous le demande, celle qui n’a presque rien fait que du mal, et ne s’est rendue digne que de châtiments? Pensée effrayante pour moi, mon Père; Dieu m’a fait voir combien je suis éloignée d’une parfaite religieuse, et combien il me reste à faire pour l’avenir. Il est grand temps que je profite du peu qui me reste a vivre, pour assurer mon salut autant qu’il dépendra de moi, de peur que je ne trouve que des châtiments au lieu de récompenses au terme de ma carrière que je sens approcher de jour en jour.
Reconnaissance de la Sœur envers son directeur. Prédictions et recommandations qu’elle lui fait.
Vous m’avez déchargée, mon Père, de deux fardeaux bien pesants;
1° le compte que je devais vous rendre des lumières que Dieu m’a données, et dont je charge maintenant votre conscience; c’est un dépôt qui ne m’appartient plus, et dont vous répondrez tout seul ; car je vois ce que Dieu exige de vous à cet égard, et je vous l’ai déjà fait connaître sans qu’il soit besoin de le répéter ici; en second lieu vous m’avez déchargée du poids de mes péchés, des péchés de toute ma vie, par l’absolution que vous m’en avez donnée après la confession générale et très-ample que je vous en ai faite , et dont, grâce à Dieu , je suis très contente. Ce sera pourtant, j’espère, la dernière confession générale de ma vie, car je suis bien décidée à n’en plus faire désormais, et à tout abandonner à la miséricorde divine, comme vous me le conseillez.
Puissiez-vous, mon Père, me fermer les yeux, car, je vous le répète encore, je serais contente de mourir entre vos mains, et que vous fussiez mon dernier directeur, comme vous êtes le dernier de la communauté: mais Dieu seul sait ce qui en arrivera; car, mon Père, je vous le répète, et je vous l’annonce les larmes aux yeux, je prévois un orage affreux. Le temps approche où vous allez être obligé de nous quitter et de fuir; vous ne pourrez faire autrement, il faut se soumettre à tout. Dieu sait si nous nous reverrons jamais; mais je le désire beaucoup plus que je ne l’espère.
Quelque chose qui arrive, mon Père, je vous en conjure, ne m’oubliez pas, car j’aurai grand besoin du secours de vos prières; ainsi ressouvenez-vous souvent de votre pauvre Sœur de la Nativité, qui doit tant vous occasionner de peines et de travail. Soit que Dieu nous laisse encore jouir quelque temps de la vie, soit qu’il nous en prive par la mort, promettons-nous réciproquement de ne point nous oublier; car de mon côté, mon Père, je suis décidée, morte ou vive, à prier pour vous; je vous le dois pour toutes sortes de raisons, et jamais je ne vous oublierai devant Dieu; promettez-moi, je vous prie, la même chose.
Je vais maintenant, mon Père, oublier tout le reste, pour ne m’occuper que du salut de ma pauvre âme, et des moyens de la sanctifier avec la grâce pour la disposer à paraître devant son juge. Pour tout le reste, je m’abandonne aux soins de la divine Providence, et me soumets à tous les événements qu’il lui plaira d’ordonner. De grâce, mon Père, soyons toujours unis dans le sacré cœur de J.-C. pendant cette courte et malheureuse vie, afin de l’être un jour dans la bienheureuse éternité. Ainsi soit-il.
Fin de la vie intérieure de la Sœur de la Nativité.
———————————
RÉFLEXIONS.
Après tout ce que nous avons vu, surtout après la lecture de ces deux ou trois dernières sections, on conviendra sans doute, j’espère, que les détails de cette vie intérieure, tels qu’ils nous ont été ici exposés, ne peuvent venir que de la personne même qui en est le sujet, ou plutôt du même esprit qui a comme dicté le volume de ses révélations. Cette nouvelle production doit donc être reçue et regardée comme une nouvelle preuve qui vient à l’appui de l’autre, et qui confirme en même temps que je n’ai pas eu tort de regarder cette fille extraordinaire comme le phénomène de son siècle, le prodige de la main du Tout-Puissant, dont il est impossible de rendre raison qu’en admettant à son égard une conduite de Dieu sur elle, qui la tire absolument de l’ordre commun, et cela encore en faveur de la communauté des enfants de l’Église; car, qui ne voit que cette heureuse ignorante n’a été éclairée jusqu’à ce point à la source des vraies lumières, que pour les transmettre aux autres, et éclairer à son tour l’église entière sur son sort, et chacun de ses enfants sur la route et la conduite qu’ils doivent tenir dans les différents états où ils peuvent se trouver par rapport à la grande affaire de leur salut.
Si pourtant il se trouvait quelque lecteur qui, après cet examen, fût décidé à conserver ses doutes sur ce sujet, ou même à refuser son acquiescement, je lui déclarerais que je n’ai aucun droit encore de forcer son opinion; mais en même temps je le
__________________________
(230-234)
prierais de nous dire s’il a jamais lu quelque auteur en genre de spiritualité qui soit supérieur à celui-ci, et de nous le nommer. Qu’il nous nomme l’ignorante qui, sans autre ressource que ses propres lumières y ait parlé de Dieu avec autant de grandeur et de sublimité, discuté des matières aussi abstraites et aussi épineuses avec autant de clarté, de précision, d’exactitude et de profondeur. Qu’il nous montre en général plus d’ordre, de sagesse, de dignité, dans un ouvrage quelconque sorti de la main des hommes, et surtout qu’il nous fasse voir dans l’auteur plus de cet esprit de foi et d’humilité, plus de cette frayeur d’être dans l’illusion, plus de cette aveugle soumission aux décisions de l’Église, plus de cette terreur des jugements de Dieu, enfin plus de toutes les grandes qualités qui font la pierre de touche de la vérité et caractérisent les personnes dont Dieu se sert ordinairement pour transmettre ses volontés aux autres hommes.
Oui, qu’il nous montre tout cela, ou qu’il se taise; mais que dis-je? s’il est obligé d’avouer qu’il n’a rien de satisfaisant à nous opposer, qu’il avoue donc aussi avec nous qu’il n’y a pas la moindre apparence qu’on puisse supposer jamais dans l’illusion du démon une religieuse exemplaire qui combat le démon avec tant de succès, et sait si bien nous découvrir ses ruses pour nous en préserver. Finissons par le recueil des songes qu’elle a promis.
___________
Songes mystérieux et prophétiques de la Sœur de la Nativité.
Si quis fuerit inter vos propheta Domini in visione apparebo ei, vel per visionem loqnar ad illum. (Num., 12,6.)
« Au nom du Père et du Fils, et » du Saint-Esprit, par Jésus et Marie je fais l’obéissance. »
Vous vous rappelez sans doute, mon Père, ce que J.-C. me dit un jour en m’expliquant le sens d’un certain passage de l’Écriture, qui dit que « Près de la fin des temps l’esprit de prophétie » serait accordé à toute chair; que les jeunes gens et les jeunes filles prophétiseraient, quelques jeunes personnes auraient des visions, et les vieillards des songes mystérieux et prophétiques (1). Ce qu’il y a de particulier, c’est qu’il trouvait en moi seule le sens de la lettre prise dans toute son étendue; car, comme je vous le dis alors, d’après son explication, on peut facilement reconnaître tout cela en moi seule.
(1) Et erit in novissimis diebus, dicit Dominus, effundam de spiritu meo super omnem carnem, et prophetabunt filii vestri, et filia vestrae, et juvenes vestri visiones videbunt, et seniores vestri soninia somniabunt. (Act. 2,17.)
Je suis vieille aujourd’hui, mais j’ai été jeune, et même enfant autrefois, et on peut dire que je le suis encore à bien des égards, et par rapport à bien des choses qu’il ne s’agit pas de détailler ici; on peut donc trouver en moi toute seule, comme Dieu me l’a fait entendre, l’accomplissement de toute la prophétie en question.
Et en effet, mon Père, non seulement j’ai eu des révélations proprement dites, et j’ai annoncé les événements futurs, mais encore j’ai eu des songes que je crois mystérieux et prophétiques, dans tous les temps et toutes les époques de ma vie, comme vous l’avez vu. C’est de quoi il s’agit de nous occuper encore un moment, puisque vous le jugez à propos. Vous ne vous plaindrez pas de moi, puisque mon obéissance sera aussi parfaite qu’elle puisse l’être sur tout ce qui regarde mon intérieur et le compte que je vous en devais.
J’ai donc souvent éprouvé, mon Père, que mes songes avaient un grand rapport à ce qui m’avait occupé le plus l’esprit et frappé l’imagination. Jusque-là, sans doute, on n’y verra rien que de très simple et de très naturel, et c’est aussi ce que j’en pense moi-même; mais il y a plus que cela, si je ne suis dans l’erreur à ce sujet. Il me paraît que Dieu s’en est servi plus d’une fois pour me découvrir et l’état actuel de ma conscience, et les pièges que le démon me tendait, et tout ce que j’avais à craindre ou à espérer pour moi ou pour les autres. Mes tentations les plus violentes, et des événements qu’on ne pouvait prévoir, ont presque toujours été précédés par des songes plus ou moins frappants qui les annonçaient, en m’indiquant la conduite que je devais tenir pour éviter les dangers ou pour vaincre les obstacles. Cela me paraît digne d’attention.
Vous m’assurez d’ailleurs, mon Père, et vous me l’avez prouvé dès le commencement, en opposant des textes formels à l’objection que me faisait le démon sur cet article; vous m’assurez, dis-je, que la sainte écriture nous fournit un grand nombre d’exemples de songes significatifs et prophétiques qui contenaient de pareils avertissements de la part de Dieu. Vous ajoutez qu’on peut encore aujourd’hui, sans superstition ni vaine observance, ajouter une certaine croyance à ceux qui seraient marqués à certains caractères, et sans
__________________________
(235-239)
se mettre en peine de certaines façons de penser sur tout cela. Eh bien, mon Père, je vous ferai donc juge de ces caractères, ce sera à vous de vous arranger comme il vous plaira avec les esprits forts, qui probablement ne penseront pas comme vous sur tout ce que je vous ai dit.
Persuadé, que vous l’êtes, ainsi que moi, très décidé à n’admettre et ne suivre que ce que vous croirez conforme au jugement de la sainte Église, il me suffît que ma conscience soit en sûreté, et ne voulant induire en erreur ni exposer personne, je déclare qu’absolument je ne donne mes songes que pour ce qu’ils sont, laissant à chacun toute la liberté de les rejeter ou de les admettre, suivant qu’il les jugera plus ou moins conformes aux règles du bon sens et de la raison.
Pour moi, je vais tout simplement vous rapporter, autant que je le pourrai, une partie de ceux qui m’ont frappée davantage; car il faudrait des volumes si on voulait tout dire avec un certain détail. Nous nous bornerons donc à ceux qui paraissent avoir plus de suite et d’application. Pour y mettre quelque ordre, je les réduirai aux songes effrayants et aux songes agréables. Commençons par les premiers, en observant pour les uns et les autres de ne pas beaucoup appuyer sur ceux dont il a déjà été fait mention par le passé.
Songes effrayants.
Songes de son enfance au sujet de sa vocation à la vie religieuse. Ses peines et ses combats.
Dès mon enfance, à peine âgée de cinq ou six ans, j’avais des songes qui, je crois, étaient des indices de ma vocation et des grâces que Dieu devait me faire, aussi bien que des combats que j’aurais à soutenir. J’ai cru mille fois, en dormant, me voir environnée d’ennemis qui me poursuivaient à mort avec des menaces et des figures effrayantes. Il me fallait combattre contre eux à toute outrance et de toutes mes forces; je ne leur échappais jamais que par le secours de Dieu, quand j’avais soin de l’appeler à mon aide. Quelquefois mes ennemis prévalaient contre moi, et me faisaient tomber dans des abîmes profonds qui figuraient sans doute les péchés que j’ai eu le malheur de commettre depuis ces temps heureux.
Dans cet état, mon Père, je criais à Dieu qui me tendait la main pour me retirer du précipice, et alors il me semblait que j’avais reçu deux ailes avec lesquelles je me levais jusqu’à une hauteur que mes ennemis ne pouvaient atteindre. Je planais alors dans les airs comme une colombe, et je retombais toujours légèrement au pied du maître autel d’une communauté de filles, où je trouvais un plaisir qui ne se peut exprimer : une fois, surtout, je m’y trouvai toute grande et toute vêtue comme je le suis, en religieuse urbaniste, et cela à un âge où je n’avais pas la moindre idée ni de l’état, ni du costume religieux ; c’est ce que je vous ai déjà fait connaître. Dans la suite, cette facilité à m’élever en l’air, dans mes songes, augmenta ou diminua à proportion de mes fidélités ou infidélités à l’égard de Dieu; enfin elle cessa tout à fait à certaine époque dont je vous ai parlé dans le compte que je vous ai rendu de ma vie intérieure.
Ses combats en songe contre des monstres qui figuraient les péchés. Combat plus opiniâtre contre l’amour-propre.
Dans un âge plus avancé, j’ai souvent pensé, en dormant, que je me battais avec des démons de différentes formes et laideurs. Une fois, entre autres, il fallut me mesurer tour-à-tour avec sept monstres, dont chacun représentait, par des emblèmes effrayants et hideux, un des sept péchés capitaux. J’avais une peine infinie à en venir à bout; à peine en avais-je terrassé un, qu’il fallait recommencer avec l’autre sans interruption, et quelquefois j’en avais plusieurs ensemble à culbuter. Par la grâce de Dieu j’en sortis enfin victorieuse; mais celui de tous qui me fit le plus de peine, ce fut cette malheureuse petite coquette dont je vous ai parlé. Je veux dire, ce monstre un peu moins laid, et qui portait la forme d’une femme assez bien parée. Non contente de combattre seule contre moi, comme je vous ai dit, elle entra toujours pour quelque chose dans les différents combats qu’il me fallut tour-à-tour livrer ou soutenir avec chacun des autres; et quand je croyais l’avoir absolument vaincue et mise hors de combat, aussitôt elle semblait renaître de sa défaite pour revenir à la charge avec plus de fureur que jamais, et le plus souvent sous une forme nouvelle. Vous savez que Dieu m’instruisit à l’occasion de ce songe, et que je compris par l’explication qu’il m’en donna, que l’orgueil était de tous mes ennemis celui que j’avais plus à craindre, ou du moins l’amour-propre figuré par cette coquette opiniâtre, d’autant plus à craindre qu’elle le paraissait moins.
Figure du monde. Penchant d’une montagne.
Je me rappelle un songe qui m’a beaucoup effrayée : le monde m’y fut représenté sous la forme du penchant d’une grande montagne, au bas de laquelle se trouvait un profond et vaste précipice. Toute la vallée, ou penchant de la montagne, était couverte de personnes de tout sexe, de tout âge et de toute condition, mêlées avec des démons avec lesquels il leur fallait combattre sans cesse. C’était une lutte et une agitation continuelles; presque toutes les personnes faisaient plus ou
__________________________
(240-244)
moins d’efforts pour arriver vers le sommet de la montagne, et les démons faisaient tous leurs efforts pour les attirer vers le bas: je fus moi-même obligée de lutter et de combattre.
Ce qui m’effrayait davantage, c’était le petit nombre de ceux qui avançaient vers son sommet, ou du moins qui tenaient ferme dans leurs postes, tandis qu’un nombre infini cédaient après quelques légers efforts; parvenus au bas de la vallée, ils étaient jetés de plein saut jusqu’au milieu du précipice, ce qui amusait beaucoup les démons qui les y avaient jetés. Alors, mon Père, les infortunés n’avaient plus ni force ni courage pour se défendre; je voyais qu’on leur mettait les fers aux mains et aux pieds; les démons les traitaient en esclaves, ou plutôt en animaux, ou marchaient sur leurs têtes et sur tous leurs corps comme sur de la paille ou du fumier.
Mais quelle transe pour moi, mon Père! quel redoublement de frayeurs lorsque j’y vis une de mes proches parentes! Hélas ! je ne connaissais que trop son attachement aux vices et aux maximes que l’évangile condamne autant que le monde les autorise. Ciel! elle allait y tomber comme tant d’autres, lorsque je criai miséricorde pour elle; je conjurai le ciel d’en avoir compassion, et aussitôt la main du Seigneur l’arrêta sur le bord de l’abîme. Dieu ne permit pas sa perte, et effectivement j’appris bientôt après que ma parente s’était convertie, ce dont j’ai beaucoup loué et remercié le Seigneur. Que de réflexions à faire, mon Père? et que ce songe, tout songe qu’il est, m’a paru conforme aux vérités de l’évangile! c’est aussi le sens que Dieu m’y a montré, comme vous le verrez bientôt; mais poursuivons, car nous ne sommes pas au bout de cette scène dangereuse et tragique.
La Sœur essaie de gravir la montagne, évite le précipice de l’enfer, et arrive enfin au sommet. Description de la montagne du repos et de la paix, et de celle de la victoire.
Pour m’échapper du péril qui m’environnait, je faisais de grands efforts toujours en combattant, pour gagner le côté du haut de la montagne, où j’espérais trouver sûreté et repos. Je marchais au travers de mille embuscades et mille pièges tendus sur mon passage, et par où les démons comptaient à chaque moment m’arrêter et s’emparer de moi; enfin, mon Père, j’arrive à un chemin étroit, au bout duquel se trouvait l’ouverture de l’enfer. Que de pas glissants et difficiles il me fallut franchir pour l’éviter! ll faut vous dire que ce spectacle affreux m’avait donné une telle horreur du monde et de ses dangers, que j’eusse presque autant aimé tomber tout de suite dans l’enfer, que de retourner dans cette guerre malheureuse, m’y rendre encore plus coupable, et mériter d’être punie davantage après ma mort. Que faire donc? Que devenir? Quel parti prendre ? Je tremblais dans l’attente de périr.
Pendant que je flotte dans cette cruelle situation, un oiseau semblable à une colombe, perché sur un arbre voisin, se fait entendre et me disait avec force: « Ma Sœur, ma Sœur, c’est ici qu’il faut du courage et de la résolution; vous ne pouvez sortir de là qu’en vous abandonnant à la miséricorde de Dieu, et en vous faisant violence. Voyez-vous cette montagne ? c’est la montagne du repos et de la paix, qui n’est habitée que par ceux qui ont vaincu leurs passions, le monde, et ses dangers. Voilà le but où vous devez tendre.»
Hélas! mon Père, c’était bien aussi mon plus grand désir; mais le moyen d’y arriver et d’échapper à ce mauvais pas où je me trouvais engagée ! Enfin je fis un effort sur moi-même, et je m’abandonnai pour toujours au sein paternel de la miséricorde de mon Dieu que j’implorais à mon secours. Aussitôt je me vis enlevée de terre, et transportée sur un lieu supérieur qui faisait partie de la belle montagne du repos de la paix, au sommet de laquelle je ne pus encore arriver que par bien des fatigues et des travaux.
Enfin j’y arrive et je commence à respirer et à me remettre de mes frayeurs. L’air y était sain et pur, tout y annonçait un printemps perpétuel et le vrai séjour du bonheur. Les habitants de cet heureux séjour étaient en bien petit nombre, mais ils me plurent infiniment par la pureté de leurs mœurs, la vivacité de leur foi, la douceur de leur caractère, leurs manières simples, honnêtes et prévenantes, enfin la droiture de leurs intentions et la sincérité de leur amour pour Dieu et le prochain. Tout occupé à louer et à bénir l’auteur de leur bien-être, ils ne paraissaient guère s’inquiéter de leurs corps, et ne pensaient au monde que pour en détester les maximes et en plaindre les malheureux esclaves.
Tout à côté s’élevait une autre montagne un peu moins haute, où le soleil dardait tous ses rayons les plus vifs; elle communiquait à la montagne du repos et de la paix, et c’était par là qu’il fallait passer pour y arriver. Toujours les armes à la main, ses habitants, forts, vigoureux et intrépides, paraissaient continuellement en guerre et en action; on me la nomma la montagne de la victoire, et on me dit qu’il fallait sans cesse y être occupé à combattre contre les vices pour les subjuguer et les détruire, et surtout qu’il
__________________________
(245-249)
fallait grandement se défier de la superbe. Voilà, me dit-on, en finissant, par où vous pouvez arriver au sommet du repos et de la paix.
Sur cela, mon Père, je m’éveillai, et Dieu me fit comprendre aussitôt que ce songe dont j’avais été si frappée, n’était pas un effet du hasard, mais d’une cause intelligente, et qu’il était rempli de justesse, de mystère et de vérités. J’ai donc vu, dans l’explication que Dieu m’en a donnée, que la colline qui servait de champ de bataille représentait au naturel le penchant de la nature corrompue, qui donne au démon tant d’avantage, pour entraîner les hommes dans l’abîme; ce qui fait qu’il faut tant de force, de résolution et de courage, et tant de travaux pour emporter le ciel. J’en ai conclu que je devais m’armer de constance et de fermeté plus que jamais contre mes mauvaises inclinations, et j’ai senti augmenter ma honte contre les suggestions du démon, les dangers et la corruption du monde, que je ne saurais plus envisager qu’avec horreur. C’est, je pense, ce que Dieu se proposait.
La Sœur poursuivie par des voleurs qui représentent les passions et les ennemis du salut. Heureux état de l’âme élevée au-dessus de la nature et des sens.
Une autre fois, mon Père, je songeais être poursuivie par des voleurs et des brigands, qui en voulaient tout à la fois à mon innocence et à ma vie; j’appris ensuite que ces brigands et ces voleurs imaginaires étaient pourtant la figure très véritable des passions différentes, des tentations et des occasions de péché, dont les unes poursuivent les âmes avec des intentions criminelles et meurtrières, tandis que les autres se placent en embuscade pour les attendre au passage et leur donner le coup de la mort.
Pour échapper à la poursuite de ces voleurs ou brigands qui m’effrayaient si fort, j’eus recours à Dieu, et je me sentis encore transportée sur la même montagne dont je vous ai parlé dans le songe précédent. Là, j’entendis les habitants s’écrier tous ensemble : « Réjouissons-nous! réjouissons-nous! » voici le Seigneur, voici le jour que le Seigneur a fait; plus d’ennemis, plus de combats, plus de tentations, plus de dangers, le temps des épreuves est passé, Dieu seul est pour toujours la récompense et la fin de nos travaux.»
J’ai compris, par l’explication de ces paroles que j’ai vues dans la lumière de la foi, que les voleurs et les brigands représentaient en général tous les ennemis du salut de l’homme, et que par la montagne du repos et de la paix on ne devait pas entendre tellement un certain état de perfection pour arriver au bonheur du ciel, qu’elle ne pût signifier aussi le bonheur même, qui est le vrai terme de nos souffrances et le lieu de notre repos éternel. Avouons cependant que l’état d’une âme parfaite ici-bas y a beaucoup de part. Je veux parler de cet heureux renoncement au monde et à soi-même, où tout s’anéantit pour faire hommage à l’excellence de l’être divin.
Dans cet heureux état d’anéantissement de la nature, l’âme s’élève au-dessus d’elle-même, parce qu’elle ne voit plus que Dieu auquel elle doit s’attacher exclusivement. Toutes les facultés se trouvent alors comme divinisées par cette union divine; ce qui la met au-dessus de toutes les attaques du démon, du monde et de la chair. Les revers d’ici-bas ne sont plus rien pour elle; à peine éprouve-t-elle les besoins du corps, qu’elle s’inquiète fort peu de satisfaire, si ce n’est les besoins qui sont indispensables; on dirait alors que le corps n’agit que machinalement : il travaille, il marche, il boit, il mange, il dort, etc. Mais l’âme ne participe guère à ces fonctions animales et purement naturelles, elle plane, pour ainsi dire, au-dessus de la chair et des sens, tant la grâce lui a donné d’empire sur eux.
Autres songes qui figurent les peines et les combats de la Sœur.
Dieu, mon Père, a bien voulu quelquefois, comme vous savez, me faire éprouver quelque chose d’approchant. Il arrive souvent, surtout après mes communions, que je ne tiens presque plus aux sens ni aux organes de la sensation. Je me trouve embarrassée pour répondre aux questions les plus simples; il faut souvent que Dieu me suggère lui-même les réponses que je dois faire, pour qu’il n’y paraisse pas trop. J’ai l’air d’une imbécile, ou, si vous aimez mieux, je ressemble à une personne qui, pour avoir fixé le soleil, conserve longtemps un certain éblouissement, qui l’empêche de fixer aucun autre objet : mon âme est dans le monde et dans mon corps sans y être, et c’est de cette situation qu’on regarde tout ce qui affecte les sens et la nature. On est sur la montagne du repos, on jouit de la paix en Dieu, et on fait toujours de nouvelles découvertes par le secours des lumières qu’il communique. Que sera-ce de le voir lui-même, et sans voile, et à découvert ! que sera-ce de le posséder sans obstacle et sans crainte de le perdre jamais !… Mais je reviens où j’en étais; c’est de là, mon Père, que sont parties la plupart des choses que je vous ai fait écrire… Reprenons la suite de mes songes (1).
(1) C’est ainsi que, toujours semblable à elle-même, la Sœur rentre, à toute occasion, dans l’ordre surnaturel qui est comme son élément. Sa grande âme s’enlève à tout propos, et nous enlève avec elle jusque dans le sein de la Divinité, qui l’inspire et la fait parler. Tout le reste ne lui paraît rien; elle tire parti de tout pour en revenir là; c’est son centre et son unique but : aussi, sur ce point, elle est toujours la même, et on peut dire qu’on la retrouve tout entière jusque dans ses songes.
__________________________
(250-254)
Autres songes qui figurent les peines et les combats de la Sœur.
Différentes fois je me suis vue en pays inconnus, tantôt tombée au fond d’un puits, tantôt exposée sur des planches étroites et très faibles qui me soutenaient à peine sur des abîmes où j’étais prête à tomber, et toujours il me fallait le secours d’en haut pour en sortir. Dernièrement je rêvais être poursuivie par un cavalier d’une taille et d’une figure épouvantable, il me regardait d’un air si terrible et si menaçant que j’en eus une défaillance; voyant qu’il n’avait pu m’atteindre, il partit avec fureur et parcourut tout le pays. Je connus dans ma dernière communion, que c’était l’annonce des efforts du démon contre nous et le petit ouvrage que nous méditons, et qu’il tâche et tâchera de faire échouer encore. Ne négligeons point cet avertissement, car, je vous le répète, nous pourrions nous en trouver mal. Mais, mon Père, voici un spectacle bien digne d’avoir place parmi mes songes effrayants.
Annonces de la fin du monde.
Une nuit qu’en dormant je me figurais être sur une montagne ou je venais d’arriver en fuyant encore le monstre, je remarquai d’abord un beau ciel et bien étoilé; mais bientôt après j’aperçus des signes épouvantables du côté de l’occident, je vis un espace immense parsemé de bières, de châsses, de têtes et d’os de morts, de chandeliers, de sentences funèbres; en un mot, tout cet espace était comme un grand drap mortuaire.
Du côté du midi parut l’archange saint Michel dans un aspect, et couvert d’une armure formidable; un glaive étincelant dans la main droite, il tenait de l’autre d’énormes balances qu’il laissait descendre vers la terre, et je compris que c’était l’appareil et les préparatifs du dernier jugement dont les temps approchent….
Dans un autre songe, où je me croyais encore sur la même montagne, je vis au firmament un grand arc-en-ciel horizontal, dont la circonférence allait aussi loin que ma vue pouvait s’étendre. Ensuite parurent dans le grand cercle des petits pigeons et des petites colombes qui volaient de côté et d’autre, sans jamais sortir de la ligne circulaire qui les renfermait. Après cela je vis des corbeaux et d’autres oiseaux de proie fondre sur les petits pigeons et les petites colombes, leur donnant la chasse et les dispersant; plusieurs se précipitèrent en terre, où ils furent déchirés par les oiseaux de proie, malgré les colombes argentées qui vinrent du ciel à leur défense. Le combat fut rude entre les corbeaux et les colombes aux ailes d’argent, il dura jusqu’à l’arrivée de saint Michel, qui détermina la victoire en faveur des pigeons et des colombes.’
Jésus-Christ souffrant et inconnu.
Une autre fois je vis à l’occident un grand tableau où était peinte la sainte face de notre Seigneur; elle paraissait vivante et couverte d’un sang vif qui coulait et ruisselait de son divin chef couronné d’épines. Ses yeux s’élevaient tristement vers le ciel, et j’en voyais tomber des larmes abondantes. Tandis que je le contemplais avec compassion et attendrissement, j’entendis une voix qui me dit: Tu vois le soleil éclipsé.
Songes qui regardent la révolution française, le schisme dans l’Église et ses terribles suites. Ordre de fuir les schismatiques.
Je dois aussi, mon Père, mettre au nombre de mes songes effrayants ceux qui avaient rapport à la triste révolution que j’étais chargée d’annoncer. Nous ne pouvons donc nous dispenser d’en ajouter quelques-uns des principaux à ceux dont nous avons déjà parlé dans les occasions où ils venaient plus à propos, et où il était comme indispensable de les faire entrer. Pour ceux-là, nous ne les rappellerons point, ou nous ne le ferons que très légèrement.
Je crus une nuit voir plusieurs ecclésiastiques revêtus de leurs habits sacerdotaux, ils avaient à leur tête un évêque aussi dans les fonctions de son ministère. Leur air sévère et hautain, leurs paroles dures, leurs regards menaçants semblaient exiger les honneurs et les respects de tous; ils forçaient les fidèles à les suivre, à les écouter et à leur obéir. Dieu m’ordonne de leur résister en face; ils ne sont plus, me dit-il, en droit de parler en mon nom, ni dignes de la soumission des fidèles, puisqu’ils ont trahi les intérêts de mon Église, et qu’ils ont été infidèles à la foi. C’est contre mon gré, et dans mon indignation, qu’ils exercent encore des fonctions dont ils ne sont plus dignes; loin de me déplaire, vous m’honorez en leur désobéissant; quelque chose qu’ils veulent exiger de vous, ne les écoutez pas, séparez-vous-en, ce que je fis comme bien d’autres. Le songe suivant est plus effrayant encore.
Il y a environ trente ou quarante années que la France me fut représentée comme un vaste désert, une affreuse solitude; chaque province était comme une lande où les passants pillaient et ravageaient tout ce qu’ils pouvaient rencontrer. Bientôt, au déplaisir des vrais fidèles, nos pasteurs et leurs vicaires, nos prédicateurs et nos directeurs, nos missionnaires disparurent, et de nouveaux ministres qu’on ne connaissait point en prirent la place, et
__________________________
(255-259)
prétendirent exercer les mêmes fonctions et avoir les mêmes droits. Insensiblement il se fit un si grand changement dans la façon de faire et de penser de mes concitoyens, que je ne pouvais qu’à peine reconnaître mon propre pays. Cependant il s’en fallait bien que ce changement fût total, je vis que la diversité des opinions y forma deux partis, ce qui occasionna des troubles et des désordres épouvantables de toutes parts. Mais voici ce qui m’effraya davantage, et m’épouvanta dans cette vision nocturne. Je vis au fond de cet affreux désert différents troupeaux de brebis mêlés avec des boucs et des chèvres, des singes, plusieurs autres espèces d’animaux hideux que je ne connaissais pas même; les bergers qui les conduisaient étaient autant de monstres plus effroyables encore de beaucoup; les démons, je pense, n’ont pas d’autres figures. Aussi, je vis des multitudes de peuples fuir leur approche, et se cacher avec crainte et précipitation pour ne pas être rangés parmi leurs troupeaux, dont ils craignaient jusqu’à la vue. Tout épouvantée moi-même, je demandai où étaient leurs pasteurs, les vrais conducteurs de ces peuples errants; il me fut répondu : Ils ont été forcés de fuir, ils sont en exil.
Rappelez-vous maintenant, mon Père, les visions quelconques par lesquelles je vous ai dit que Dieu m’avait tant de fois fait pressentir et comme toucher au doigt une persécution qui n’est aujourd’hui que trop réelle, quoiqu’on la regardât alors comme chimérique, et les annonces que j’en faisais comme de pures extravagances, de vraies illusions d’imagination. Rappelez-vous, dis-je, les différentes scènes effrayantes; par exemple la vigne saccagée par des brigands, les deux beaux arbres battus par l’arbre qui s’éleva tout à coup entre les deux; le dragon que je vis se détacher du nuage orageux pour dévorer tous ceux qui étaient dans la belle maison, et vous aurez tout ce qui, sur le même objet, a le plus troublé mon esprit et effrayé mon imagination. ll est bon de vous dire aussi que dans ces différents songes, qui avaient rapport à notre révolution, je me trouvais tantôt transportée de zèle pour la catholicité, et tantôt d’horreur pour le schisme et l’hérésie, que je prévoyais et que je prévois encore; fasse le ciel que nous en puissions être quittes pour la peur!
Mais après avoir parlé des songes de mauvais augure, il paraît convenable d’exposer maintenant ceux que j’appelle agréables, gracieux et consolants, car j’en ai eu de toutes les sortes. Ceux-ci du moins seront plus propres à égayer et consoler le lecteur, si toutefois il s’en trouve jamais qui veuille s’occuper de mes songes. Ce sera pour demain, s’il plaît à Dieu.
Songes gracieux.
Exposition générale des songes de la Sœur, et de leurs effets, qu’elle ne croit pas pouvoir être expliqués naturellement.
La joie d’une bonne conscience, les moyens de sanctification, le bonheur d’être tout à Dieu et de le posséder par l’amour et le désir, en attendant de le posséder par la réalité, les triomphes de la sainte Église, la gloire des saints, la personne adorable de J.-C., la vue de sa sainte Mère et de ses vrais amis, la fin de nos maux, voilà en abrégé, mon Père, quels ont été les objets les plus ordinaires de ce que j’appelle mes songes gracieux ou agréables, et même la plupart de mes visions et apparitions. De la même manière que la crainte du péché, de l’enfer et des jugements de Dieu, les troubles et les persécutions de l’Église m’en ont toujours occasionné de contraires et conformes aux impressions de terreur que portent naturellement les objets effrayants. Cette analogie entre les pensées de la nuit, si on peut parler ainsi, et celles du jour qui les avaient précédées, me paraît toute simple et toute naturelle. Et pourtant cela ne m’empêche pas de dire que ceux qui prétendaient n’avoir besoin que de ces dispositions naturelles de mon esprit ou de mon imagination, pour rendre raison de tout, je veux dire pour expliquer et mes révélations et mes songes, seraient, à mon avis, dans une erreur bien grossière qui leur ferait confondre l’effet avec la cause. Dieu, sans doute, peut tirer parti de ces dispositions qu’il a fait naître lui-même; mais j’ai toujours éprouvé, éveillée comme endormie, que ces dispositions ne pouvaient venir de moi, ni produire par elles-mêmes aucuns des effets qu’elles me font éprouver. Vouloir par conséquent expliquer mes songes comme mes révélations, en un mot, tout ce que j’ai vu en Dieu par mes dispositions naturelles, ou par la trempe de mon esprit ou de ma constitution physique, ce serait comme si on entreprenait de rendre raison de l’ordre merveilleux du monde par le mouvement de la nature, d’expliquer le flux et le reflux de la mer par l’agitation des flots, ou la fièvre par le frisson qu’elle fait éprouver. En tout cela, montrer l’effet ne fut jamais expliquer la cause, et jamais les causes secondes ne seront comprises qu’autant qu’on remontera à la cause première, sans laquelle les autres n’existeraient pas. Sans cela on n’a rien dit, quoiqu’on ait beaucoup parlé, ou, si vous aimez mieux, on a parlé philosophie
__________________________
(260-264)
tant qu’il vous plaira ; mais on n’a point parlé raison. Laissons donc disputer les philosophes , et venons à mes songes gracieux.
Gloire de saint François. Pauvreté et humilité, fondements de son ordre.
Étant encore sur cette haute montagne où je vous ai dit que j’avais vu l’appareil préparatoire du dernier jugement, je regardai entre le nord et le levant, et je vis une grande troupe de religieux de notre ordre qui marchaient glorieux et triomphants; à leur tête paraissait un personnage grave et vénérable, revêtu d’une robe éclatante et toute parsemée de pierres précieuses et de richesses immenses. Il portait en tête une couronne brillante, ses pieds et ses mains étaient percés; enfin, je le pris pour J.-C. lui-même, et j’allais me prosterner devant lui pour l’adorer. Prenez-y garde, me dit une voix forte, celui-ci n’est qu’un homme, et c’est votre père Saint-François….
Quoi ! répondis-je, notre père saint François! eh! comment serait-il aussi étincelant dans le ciel, celui qui fut toujours si humble sur la terre, lui qui chérissait tant l’abjection et la pauvreté ?… C’est justement, me répliquât-on, ce qui l’a rendu si glorieux, et ce qui doit aussi faire un jour la gloire de ses enfants, s’ils sont fidèles à marcher sur ses traces, parce que la pauvreté et l’humilité sont le testament qu’il leur a laissé; et l’esprit de son ordre consiste surtout dans la pratique de ces deux vertus, qui sont la base et le fondement de son édifice. Il faut donc les pratiquer pour être digne d’y être associé. Ce songe, mon Père, me donna beaucoup de consolation et de joie.
La Sœur se trouve en songe dans la petite maison de Nazareth. Touchante description qu’elle en fait. Leçon qu’elle reçoit.
Étant assez jeune encore, je songeai qu’errant seule dans une campagne déserte et solitaire, j’entrai comme par hasard dans un petit bois dont la situation paisible me paraissait très favorable à la méditation. C’est là que loin, du tumulte on est heureux, s’il y a du bonheur sur la terre, puisqu’on jouit de soi-même et de son Dieu, à la douce pensée duquel nous sommes continuellement rappelés par la vue si charmante de tous les objets qui nous environnent. C’était par un beau jour de printemps, l’air était pur et serein, le silence de cette agréable solitude n’était interrompu que par le chant des oiseaux perchés sur les arbres verdoyants qui ombrageaient ce paisible séjour. Que tout est beau dans la nature, me disais-je ! que sera-ce donc du séjour des bienheureux, si le séjour de notre exil est si attrayant! que sera-ce de celui de notre patrie! Et si Dieu est si bon, si libéral et si magnifique pour des coupables à qui il ne doit que des châtiments ici-bas, que fera-t-il donc pour ses amis, quand il voudra les récompenser en Dieu et dans toute l’étendue de sa libéralité, de sa magnificence et de son amour?
Ainsi je raisonnais en moi-même; et tout en raisonnant ainsi, je suivais entre de beaux arbres une petite avenue au bout de laquelle j’aperçus une maison retirée, ou plutôt construite seule au fond du bois, comme une espèce de petite grotte ou cabane, qui me plut beaucoup par son air et son agréable situation, et surtout par le grand silence qui y régnait, car on n’y entendait aucun bruit, si ce n’est celui que faisait parfois un ouvrier en travaillant….
J’entre dans cette maison pour m’informer du lieu où j’étais; je vis en entrant un bon et vénérable vieillard, qui travaillait à polir et à façonner des pièces et des planches de bois avec bien du soin et de l’attention…. À l’autre côté de l’appartement, je vis une jeune personne qui me parut être sa femme, et dont la douceur et la modestie égalaient la beauté; à côté d’elle paraissait un jeune homme d’environ dix à douze ans au plus, mais d’une figure si douce, si bonne et si agréable, qu’il suffisait de le voir un instant pour en être épris.
Aussi, mon Père, quelque intérêt que je prisse au bon vieillard, et surtout à sa jeune épouse qui me plaisait infiniment, je sentais dans mon cœur quelque chose de bien plus vif encore pour le jeune homme; mes yeux ne pouvaient le quitter que par de courts intervalles et dans des moments de distraction…..
Ils s’occupaient tous trois dans un silence paisible que n’interrompit pas même leur façon honnête de me recevoir. Je ne remarquai dans leur travail et leurs manières, ni vivacité, ni empressement, ni inquiétude, ni aucune espèce de gêne ou de contrainte; tout annonçait le contentement, la paix et le bonheur d’une âme qui jouit d’elle-même et ne s’inquiète de rien. Je ne savais quelquefois ce que je devais le plus admirer, ou des soins et des attentions des parents, ou de l’obéissance du fils qui faisait tout son possible pour y répondre par ses prévenances, en tâchant de leur plaire, et les services qu’il leur rendait à l’un et à l’autre. C’était une affection mutuelle, une tendresse réciproque, mais aussi respectueuse qu’elle paraissait vive et sincère. J’aurais passé mes jours à les voir; mais enfin il fallut terminer cet admirable spectacle : je pris donc congé de cette charmante famille; je sortis, quoiqu’à regret, de cette agréable cabane, et en partant je tournais encore les yeux sur mon jeune homme, emportant avec
__________________________
(265-269)
moi le désir bien formé de le revoir le plus tôt que je le pourrais, tant cette première entrevue m’avait causé de plaisir.
L’heureuse épouse! l’heureuse mère, que cette jeune personne, me disais-je en me retournant !…. Quel vénérable vieillard que le maître de cette chétive maison ! Quelle belle et sainte personne que sa jeune épouse! Mais, surtout, l’aimable enfant que ce beau jeune homme qui paraît bien leur appartenir, et qui montre si bien qu’il est leur fils par ses manières à leur égard! Quelle modestie, quelle simplicité dans leurs vêtements! quelle sobriété dans leurs repas! quel bel ordre, quelle propreté, quelle paix, quelle union dans cette demeure ! Comme tout y respire la décence et l’odeur de toutes les vertus! Faut-il avoir tant attendu à la connaître, cette aimable famille! Ah! si le bonheur n’y est pas, il n’y en a point sur la terre, ni dans le monde entier…
Pendant qu’en marchant seule je m’entretenais ainsi de cet agréable souvenir, j’aperçus un homme de bonne mine qui me parut être un habitant du lieu; je m’informai de lui ce que c’était que cette petite maison où j’étais entrée. Vous devriez la connaître, me répondit-il, ainsi que ceux qui l’habitent; vous sortez de l’école de la sagesse et des vertus. C’est l’école de Nazareth, c’est la maison où le Verbe incarné a passé trente années dans le travail, l’obéissance et la soumission. C’est, ajouta-t-il, cette vie cachée, humble et laborieuse de votre Dieu, qu’il veut que vous vous proposiez pour modèle, si Vous voulez lui plaire et travailler au succès de votre perfection. C’est ainsi que vous devez vous cacher au monde, pour ne vivre que de Dieu et en Dieu par J.-C. ; c’est enfin ce que vous marquait ce silence que vous avez remarqué en eux. Quand on est toujours, comme ils le sont, dans la vue et contemplation de Dieu présent, a-t-on besoin de se répandre au-dehors par l’attention aux choses extérieures et la conversation avec la créature? Ne trouve-t-on pas en soi la source du plus parfait bonheur? Méditez continuellement, et efforcez-vous d’imiter ce que vous avez vu.
La Sœur riche dans son sommeil, pauvre à son réveil ; figure du néant des choses humaines.
Une nuit, je me figurais parler à un colporteur qui me faisait l’étalage de sa marchandise avec une complaisance qui me frappait; ce qu’il y avait encore de plus agréable et de plus complaisant en lui, c’est qu’il me donnait tout ce qui paraissait me faire plaisir; il me suffisait de lui témoigner mon désir, pour qu’il me priât instamment de recevoir la pièce de marchandise qui m’avait plu. Surprise et enchantée de tant d’honnêteté, je ne savais comment lui en témoigner ma reconnaissance. Vous êtes, me dit-il, comme les personnes qui s’attachent avec dérèglement aux faux biens de la terre, et vous en êtes la figure très ressemblante; sachez donc qu’actuellement vous êtes endormie, et que bientôt vous serez, comme eux, dupe de votre illusion. Maintenant la fortune vous favorise, le réveil va vous enlever tout ce que vous possédez, de sorte qu’il ne vous en restera rien; et ce réveil qui va vous détromper est l’image de la mort de ceux qui avaient mis leur confiance dans les objets terrestres et dans les faux biens d’ici-bas.
À ces mots je m’éveille, et en m’éveillant je vois disparaître et s’évanouir comme de la fumée cette fortune mensongère qui m’avait amusée un instant. Je fis alors les plus sérieuses réflexions sur le vide et le néant des choses humaines. Je m’étais crue heureuse, me disais-je, que m’en reste-t-il maintenant? Heureux, ô mon Dieu, celui qui se confie en vous seul ! il n’est point trompé dans son attente; il vous trouve à la mort après vous avoir cherché pendant la vie; vous lui restez quand tout le reste a disparu; et vous lui restez, ô mon Dieu, pour faire son bonheur durable sans qu’il puisse craindre de vous perdre jamais!
Jésus-Christ paraît chargé de trésors immenses, que personne ne veut recevoir.
J’ai cru une fois voir, en dormant, J.-C. tenant dans ses deux mains des trésors immenses; il me regardait d’un air triste, je lui en demandai la cause. Ma fille, me dit-il en gémissant, je viens les mains remplies de présents, j’ai des richesses immenses que je destine à mes créatures, je viens pour les enrichir en les leur distribuant, et je ne trouve personne qui les demande, ni qui les désire, ni qui se rende digne de les recevoir. Je ne sais donc à qui communiquer mes dons, malgré le besoin qu’on en a. Juge de la peine que me cause une si coupable indifférence!
L’enfant Jésus entre les bras de Marie, avec une petite croix.
J’ai cru voir encore, dans une autre circonstance, la très Sainte Vierge tenant sur ses genoux l’Enfant Jésus, qui semblait s’amuser avec une petite croix un peu longue, qu’il tenait entre ses mains. À cette vue je me prosternai aux pieds de ma bonne mère, et lui demandai en grâce de me laisser un petit moment tenir son divin fils. Je le veux bien, me répondit-elle. Je tendais les bras pour le recevoir; mais au lieu de l’enfant elle ne me donnait que sa croix que je ne voulais point; ce qu’elle répéta à différentes reprises; et comme je me plaignis à elle-même qu’elle trompait mon espérance, Ma fille, me répondit-elle sérieusement, si vous voulez l’Enfant, il faut d’abord que vous receviez
__________________________
(270-274)
la croix qu’il vous présente par mes mains, vous ne pouvez posséder l’un sans l’autre. À ce moment passe notre Père S. François à la suite d’une bannière où il y avait un grand crucifix. Voilà, me dit la sainte Vierge, en me la montrant, voilà la procession que vous devez suivre sans la quitter jamais… Sur cela, je m’éveillai.
Jésus-Christ invite la Sœur à le suivre au Calvaire, et lui fait présent de sa Croix.
Quelques jours avant l’accident dont je vous ai parlé, et qui doit avoir des suites jusqu’à ma mort, je rêvai que j’assistais à une procession qu’on faisait pour les indulgences du grand jubilé. Pendant que nous marchions dans un chemin bien droit et bien commode, je jetai les yeux sur un chemin fort étroit et fort raboteux qui se trouvait à notre droite, j’y aperçus J.-C. même qui y portait sa croix vers la montagne du calvaire. Venez après moi, criait-il après la procession, suivez mes traces, c’est ici la station des grandes indulgences, venez tous m’aider à porter la croix que je porte pour tous. Voyant que personne ne voulait quitter la route facile pour le suivre par le chemin scabreux où il marchait, j’y courus après lui. Il se plaignit à moi de l’indifférence et de la dureté des hommes à son égard, et me parla des douleurs de sa passion de la manière la plus touchante.
Dans une antre circonstance de la même époque, j’entendis ses plaintes, et je le vis encore dans mon sommeil tout chargé et comme accablé de sa croix : c’était dans notre communauté. Il appelait toutes les religieuses à sa suite, j’y courus et il me refusa. Ce n’est pas vous, me dit-il, allez dire à vos Sœurs de venir; pour vous, restez dans votre cellule. Quel chagrin ! j’obéis en pleurant; mais après quelque temps il entra dans ma cellule avec madame la supérieure : Tiens, ma fille, me dit-il, ne t’afflige pas, voilà ta portion et ton partage. Les autres m’ont fui, je te laisse ma croix, ne la quitte jamais. Elle était ornée de différentes reliques de saints, et surtout de martyrs. Je me prosterne la face contre terre en la recevant, et J.-C. disparait…. Très peu de temps après le songe, madame l’Abbesse tomba malade de la maladie qui la conduisit au tombeau, et moi j’eus l’accident qui doit aussi m’y conduire et m’y accompagner. Dieu soit béni en tout.
La Sœur est conduite au fond d’un désert, et reçoit un petit livre à méditer.
Je me rappelle qu’une nuit je croyais faire voyage avec mon bon ange, sous la figure d’un beau jeune homme, tel apparemment que celui qui conduisait Tobie. Il me dit qu’il m’allait conduire où Dieu me voulait; chemin faisant, il ne m’entretenait que des moyens de devenir parfaite et d’accomplir en tout la volonté de Dieu. Nous trouvions en marchant des oratoires ou de petites chapelles particulières, où je voulais aller prier avec les autres : Passez cela, me disait-il, ce sont des brebis égarées, des vierges folles…. Il me conduisit donc au fond d’un désert. C’est ici, me dit-il alors, que Dieu vous appelle, et que vous devez faire votre demeure; sur cela, il me donna un petit livre et disparut. J’ouvre ce livre avec empressement, car il devait être ma méditation ordinaire; mais je fus bien surprise, en le feuilletant, de ne voir et de ne lire sur chaque page que ces deux mots : Dieu seul.
Cœur de l’âme fidèle, sanctuaire secret où s’enferme le divin Époux.
Après avoir longtemps admiré les petites fleurs blanches du jardin de l’époux et de l’épouse dont je vous ai parlé ailleurs, je vis dans un autre songe une église dont le sanctuaire était fermé à clef aussi bien que les portes. Une vierge très modeste et très humble parut sous la figure d’une religieuse; elle entra dans l’église, qu’elle referma en dedans; pénétra dans le sanctuaire, qu’elle referma pareillement sur elle. Dans le même instant, J.-C. se fait voir à elle sous la forme humaine, elle lui remet les clefs en lui disant: Mon Seigneur et mon époux, je vous livre l’entrée de mon cœur et de toutes mes puissances, et cela pour jamais. J.-C. reçut son présent avec amour et satisfaction, lui promettant d’être son partage pour l’éternité.
Sortie de cette église, j’observai sur le faîte la croix arborée avec tous les instruments de la passion du Sauveur; il y avait aux environs de l’église des régiments de soldats rangés en bataille, mais sans aucun mouvement, tandis qu’à deux pas je voyais autour des sentinelles dans une continuelle agitation, de peur que l’ennemi n’approchât de la garde. Voici le sens mystique de cette vision nocturne:
Le cœur de l’âme fidèle est le sanctuaire où le divin époux aime à se renfermer avec elle pour se rendre maître de toutes ses puissances, dont elle lui-confie la garde: 1° cette âme unie à J.-C. doit avoir d’abord détruit toutes ses passions par la pratique des exercices de la pénitence et de la mortification; 2° elle doit avoir fermé, par une attention continuelle sur elle-même toutes les portes et les avenues qui pourraient donner l’entrée à l’ennemi; 3° pendant que les sens intérieurs et extérieurs sont tranquilles, la vigilance, comme une sentinelle active et infatigable, doit toujours être en mouvement pour découvrir les ruses et prévenir les attaques de l’ennemi, par la mortification et les souffrances figurées par la croix et les instruments de la passion,
__________________________
(275-279)
en un mot, par la mort du vieil homme que Dieu me commanda un jour de faire mourir, en me disant qu’il fallait chasser bien loin le bouc émissaire, si je voulais lui plaire à l’avenir.
Apparition d’une jeune vierge qui reproche à la Sœur ses négligences et son peu d’amour-propre.
En voici un autre, mon Père, qui m’est arrivé il y a peu de temps, et qui m’a fait une impression aussi vive qu’agréable. Je songeais que dans ma cellule je voulais m’appliquer à Dieu, et n’y pouvais réussir, comme j’aurais désiré; je ne savais d’où pouvait venir cette difficulté. Pendant que j’y faisais des efforts inutiles, je vois entrer et venir à moi une jeune fille de quinze ans ou dix-huit tout au plus; je crus la reconnaître pour l’avoir déjà vue dans une autre circonstance qu’il serait trop long de rapporter. Cette jeune vierge, car elle en portait tous les traits, était à mon avis la plus belle personne qu’il fût possible de voir; une démarche noble et gracieuse sans affectation, des traits charmants, l’air de la simplicité et de la candeur que donne l’innocence, un visage riant et modeste, des yeux où pétillait le plus beau feu; enfin, que vous dirai-je encore? je ne sais quoi de si aimable, qu’il suffisait de la voir pour en être épris. Aussi, mon Père, je vous avoue que je n’ai pu m’en défendre, et que je l’aimai au premier aspect….
Elle m’aborde, me prend la main, et me fixant d’un air de bonté et d’intérêt plus éloquent que tout ce qu’on peut dire, je viens, ma bonne amie, me dit-elle, vous faire un petit reproche, et ensuite une proposition de la part de J.-C.; car c’est lui-même qui m’envoie vers vous. Que vous êtes heureuse, ma bonne amie, lui répliquai-je, de connaître J.-C. et de lui appartenir! Ah! soyez la bienvenue, puisque vous me venez voir de sa part; je vais, n’en doutez pas, vous écouter de tout mon cœur.
Voici donc ce qu’il vous reproche, me reprit-elle : vous ne l’aimez point assez, vous partagez votre cœur, et même vous lui êtes infidèle en bien des choses, vous vous exposez bien souvent à la privation de ses grâces et de ses faveurs, vous oubliez quelquefois combien vous lui êtes redevable. Ce qu’il vous demande par ma bouche, c’est de redoubler de ferveur, de vous étudier à lui plaire en tout, de ne point sortir de sa sainte présence, de l’avoir continuellement dans l’esprit et dans le cœur, de n’agir que par son impression, de ne vivre que pour lui; car, ma bonne amie, il vous a tout donné, il veut tout avoir. ll est jaloux de posséder votre cœur tout entier et sans partage; et croyez-moi, ma chère, un cœur tel que le vôtre n’est pas trop pour un maître tel que lui.
La persuasion coulait de ses lèvres, ses paroles avaient fait sur moi tant d’impression que je ne pensais qu’à m’avouer coupable; et ce qu’il est bon de remarquer, c’est que je n’éprouvais aucune peine aux réprimandes qu’elle me faisait; mais au contraire, j’y trouvais beaucoup de plaisir, plus même qu’aux compliments et aux éloges les plus flatteurs. J’aurais voulu passer ma vie à les entendre, parce qu’elle avait su m’inspirer pour elle le même amour qu’elle me témoignait. Ah! combien J.-C. reprend doucement ! Eh bien, lui dis-je en pleurant, tout ce que vous me dites est juste, c’est la vérité même, je le reconnais. Obtenez-moi donc d’être plus fidèle à l’avenir, et de profiter de votre charitable avertissement, et je vais y travailler de tout mon pouvoir pour l’amour de J.-C.
À ces mots, l’aimable vierge se jette dans mes bras, nous nous serrons étroitement; voilà, me dit-elle en m’embrassant, comme je veux vous unir à J.-C., car je suis son amour pour les hommes; je prends tous les moyens pour vous gagner à lui…. O mon Père, que j’étais heureuse!
Comme je lui avais demandé la manière de me rendre plus fidèle à J.-C, je la cherchais des yeux pour qu’elle m’éclairât davantage sur ce point, lorsque je l’aperçus à quelques pas prosternée, les mains jointes, dans l’adoration la plus profonde et l’oraison la plus fervente; ce que je pris pour le moyen qu’elle m’indiquait….
M’étant alors éveillée, je repassai les circonstances de ce songe frappant, et je les trouvai toutes conformes à mes besoins et à ma situation. Il y avait déjà quelques jours que je m’étais laissé aller à certaines dissipations qui m’avaient occasionné des paroles à tout le moins inutiles, quelques petites médisances, un peu d’humeur et autres fautes de cette nature, qui m’avaient tirée un peu de mon centre, je veux dire, de la présence de Dieu. J’avais eu de la lâcheté à renvoyer les distractions qui étaient survenues dans mes prières : ma dernière communion avait été moins fervente, et aussi Dieu ne m’y avait presque rien dit au cœur…. J’ai cru tout bonnement que c’était l’objet de l’ambassade que je reçus pendant mon sommeil, et je vous prie, mon Père, de me dire ce que vous en pensez.
Je vous ai déjà fait observer, ma fille, répondis-je à la Sœur, que Dieu peut se servir de la voie des songes pour donner aux hommes des avertissements salutaires. J’en vois dans les Saintes Écritures des preuves, qui ne permettent pas d’en douter; je vois d’ailleurs dans les vôtres des événements, des convenances, des probabilités si fortes,
__________________________
(280-284)
qu’il ne me paraît guère possible de s’y refuser… Mais, ma Sœur, vous m’avez fait entendre, si je me le rappelle bien, que ce n’était pas la première fois que vous aviez eu occasion de voir cette agréable personne dont vous venez de parler en si bonne part. Dites-moi donc maintenant, je vous prie, en quelle autre circonstance vous aviez déjà fait connaissance avec elle? car vous m’avez rendu curieux de la connaître moi-même davantage, et je pense qu’il y aurait beaucoup à gagner pour moi, et pour d’autres encore peut-être.
Cette envie d’en entendre parler, mon Père, est une preuve que vous la connaissez déjà, me répondit la Sœur; mais il est tard aujourd’hui, et la séance a été passablement longue, pour n’avoir parlé que de songes. Si j’entrais dans celui que vous me demandez, elle durerait au moins un quart d’heure de plus, et je craindrais que vous n’en fussiez incommodé; ainsi, mon Père, si vous le trouvez bon, nous finirons ici le récit de mes songes. Point du tout, ma Sœur, je veux au moins encore celui-là ce soir; s’il dure un quart d’heure, eh bien, ce sera un quart d’heure de plus, je puis même vous donner une bonne demi-heure; ainsi, si vous n’êtes point incommodée de parler, je ne le serai point d’entendre; mais si vous ne me satisfaites pas ce soir, ce sera pour demain, choisissez, car je ne vous tiens point quitte de la circonstance que je vous demande.—Mon Père, reprit la Sœur, ne doutez point de ma disposition à vous obéir; il suffit que cela vous oblige. Je vais donc continuer encore quelque temps, et vous ferez de tous mes récits l’usage qu’il vous plaira dans vos cahiers.
Jésus-Christ lui fait connaître le monde.
Environ le temps où vous êtes entré chez nous pour nous diriger, J.-C. m’apparut en songe, et me dit : Suivez-moi, je vais vous apprendre ce que c’est que le monde. Je le suis; et marchant tous les deux avec une rapidité étonnante, nous parcourons des pays immenses; bientôt nous arrivons dans des contrées les plus éloignées. Ce qu’il y avait de bien commode, c’est que nous voyions tout sans être aperçus de personne : partout J.-C. me faisait remarquer l’opposition de l’esprit et des maximes du monde avec ceux de l’Évangile. Vous voyez, me disait-il, que nous trouvons à chaque pas des gens empressés pour mille affaires temporelles; mais où sont ceux qui s’empressent pour l’affaire de leur salut ?…
Ici c’est une noce, là c’est une foire ou un marché, plus loin c’est un événement amusant ou tragique… Joignez-y quelques autres bagatelles de même nature; voilà ce qui forme le cercle de la vie humaine. Les entreprises coûteuses, les projets de fortune, les intrigues de cabinet occupent les gens de cour et les grands du monde; les attaques et les défenses, les sièges et les batailles occupent les gens de guerre; les formalités et les procès occupent les gens de barreau; le labourage, le soin des bestiaux occupent les gens de campagne; les études profondes, les grandes spéculations occupent les gens de lettres et les savants politiques : le commerce occupe les marchands; mais où sont, parmi tous ceux-là, ceux qui s’occupent, comme il faut, de leur conscience et de leur Dieu ? qui sont ceux qui font au moins une affaire principale et sérieuse de leur salut, qui est la première et la plus importante de toutes ?…
La puérilité conduit l’enfance, la dissipation conduit l’âge viril, l’intérêt conduit l’âge mûr, l’avarice conduit la vieillesse, et la foi ni la charité ne conduisent presque aucune époque de la vie. Les grands sont voués et comme vendus à la vanité, à l’orgueil et à la volupté; les petits le sont au murmure, à l’ignorance, à la crapule et à l’injustice. Où sont ceux qui se vouent à l’humilité, à la mortification et à la pratique des vertus ? On chante, on boit, on rit, ou dispute, on se réjouit, on s’attriste, mais toujours pour le temporel. Chacun cherche l’intérêt du corps, presque personne ne cherche celui de l’âme; on travaille beaucoup pour le temps, presque jamais pour l’éternité; on fait tout pour soi, rien pour Dieu : voilà le monde….
Vous voyez donc, continua J.-C., que tous ces gens-là ne m’appartiennent pas, ils sont tout à leurs passions, et non pas à moi; ils appartiennent au démon mon ennemi; ce n’est point ici mon royaume ni mes sujets; ils sont au contraire en guerre avec moi et les miens. De tous ceux que vous voyez, à peine s’en trouve-t-il qui pensent à moi et à mon Évangile, pour y conformer leur conduite; s’ils le font quelquefois, c’est si faiblement, que leur christianisme serait plutôt un opprobre pour moi qu’un hommage rendu à ma divinité. Combien n’y en a-t-il pas parmi eux qui vont jusqu’à rougir de mon nom devant les hommes, et qui, après quelques actes de religion rendus à la bienséance, courent bien vite dans les cercles mondains rétracter et les vœux de leur baptême, et les promesses qu’ils m’avaient faites aux pieds des autels ! Point de pureté d’intention dans les mariages, point de fidélité dans le commerce, point de vocation dans les états, point de justice parmi les hommes; voilà le monde. Faut-il s’étonner s’il est condamné dans l’Évangile, comme rempli de scandales, d’injustices et de péchés?..
__________________________
(285-289)
Il l’envoie prêcher la pénitence dans une grande ville. Elle obéit avec peine, et ne trouve plus J.-C. à son retour.
Tout en parlant ainsi, nous arrivâmes sur une haute montagne, d’où il était facile de découvrir tout le pays d’alentour; entre autres objets nous aperçûmes tout proche une grande et tumultueuse assemblée; c’était une foire qui se tenait près d’une ville très commerçante… Vous voyez cette ville et cette assemblée, me dit J.-C.; cette multitude d’hommes n’est occupée que d’affaires temporelles et de projets iniques pour la plupart. Le très grand nombre de ceux que vous voyez est plongé dans des habitudes de crimes, ce qui rend leur salut très difficile, et d’autant plus difficile que c’est la seule affaire dont ils ne s’occupent point, à laquelle ils ne pensent pas même. Quel
triste aveuglement ! Allez, ma fille, allez les trouver de ma part, dites-leur que, s’ils ne font pénitence, je les punirai de la manière la plus terrible; qu’une vie païenne, mondaine et libertine, est toujours suivie d’une mort funeste et d’une éternité de malheurs; dites-leur qu’ils se convertissent et cessent de pécher, pour ne pas mettre le comble à leur réprobation….
Je frémis à cet ordre, beaucoup moins par la crainte du danger auquel il m’exposait, que par la crainte de perdre celui qui me le donnait. Je n’osais lui faire part de mon embarras qu’il pénétrait sans doute; je le priai seulement de m’attendre au même endroit, où je me proposais de le rejoindre en peu. Je pars et cours de toutes mes forces ; arrivée à l’endroit convenable pour être à portée de me faire entendre de cette multitude, je leur criai le plus haut que je pus tout ce que j’avais ordre de leur dire; j’ajoutai que c’était J.-C. lui-même qui m’avait envoyée vers eux, et je les menaçai de sa colère s’ils n’obéissaient à ma voix, comme les Ninivites à celle de Jonas Quelques-uns m’écoutèrent avec attention et parurent touchés de mes paroles; mais le très grand nombre ne s’en mit pas en peine. J’en vis me tourner en dérision, d’autres s’emporter de colère contre moi, et je ne sais ce qui serait arrivé, si, pour me dérober à leur poursuite, je n’avais bien vite pris la fuite, pour aller retrouver mon guide à l’endroit où je l’avais quitté. Mais, ô désolation ! il n’y était plus, et ce que j’avais tant craint était arrivé, il avait disparu. Que faire ? que devenir dans un pays étranger qui déjà me regardait comme une ennemie, pour avoir voulu l’éclairer sur ses vrais intérêts?
Pendant qu’elle cherche J.-C. avec douleur, elle rencontre une âme désolée qu’elle tâche de consoler.
Pendant que, pour le trouver, je parcourais avec une inquiétude mortelle les champ et les campagnes voisines, l’appelant à haute voix et le demandant à tous ceux que je rencontrais, j’entendis tout à côté de moi, derrière un buisson, des cris lamentables, des plaintes touchantes; j’approchai de l’endroit, et je vis couchée par terre une fille d’une vingtaine d’années, qui se lamentait d’une manière à faire pitié; j’eus compassion d’elle, et je voulus la consoler. Ah ! me dit-elle en pleurant, il n’est plus de consolation pour moi, j’ai perdu la présence sensible de l’époux de mon âme, je succombe à ma peine; dites-moi ce qu’il est devenu, ou bien je vais mourir de douleur…
Sa triste situation commença à me faire oublier la mienne; il semblait qu’elle partageait mes souffrances par la ressemblance de nos peines; je me reconnus donc à son portrait; et sans vouloir encore me faire connaître à elle, j’entrepris de la consoler, moi qui en avais plus besoin qu’elle. Je lui dis entre autres choses que sa trop grande sensibilité n’était point fondée sur les règles de la vraie piété, qu’elle pouvait même déplaire h Dieu, qui demande plus de soumission à sa volonté. Sa présence sensible, disais-je, est une grâce qu’il ne doit à personne, et dont il faut savoir souffrir la privation quand il lui plaît, et loin de lui déplaire par-là, nous lui sommes beaucoup plus agréables par notre soumission, que si nous éprouvions cet amour de Dieu présent, cette sensibilité que la nature recherche sans cesse, et qui peut-être ne satisfait que l’amour propre…
Ainsi, ma bonne amie, lui disais-je, prenez garde de vous affliger à l’excès, l’excès en tout est nuisible. Croyez-moi, ma bonne, c’est Dieu qui vous éprouve; mais le temps de l’épreuve finira pour faire place à des moments plus heureux: la présence sensible de son amour ou de sa personne n’est point ce qu’il exige de nous; il veut le solide de la piété, qui consiste surtout dans l’obéissance et la soumission à sa volonté sainte….
Tout en parlant ainsi, je regardais de tous côtés pour tâcher de découvrir celui que je cherchais moi-même avec tant d’inquiétude, de crainte et de chagrin; tant il est vrai qu’il est bien plus facile de bien parler que de bien agir, de consoler les autres, que de se consoler soi-même; et cependant, mon Père, je sentais que j’avais reçu quelque consolation, en parlant ainsi à cette pauvre affligée; car je me disais intérieurement que j’avais peut-être bien plus besoin qu’elle des bons avis que je lui donnais, et que je devais me les appliquer, comme elle mêle fit elle-même comprendre en bien peu de mots, et comme pour me payer de l’acte charitable que j’avois exercé à son égard.
Elle continue de chercher J.-C., et elle arrive à la montagne du Calvaire, où elle trouve beaucoup de croix fort rudes et fort pesantes.
Enfin, je la quitte, et a quelque distance de là je trouve une haute mon
__________________________
(290-294)
montagne au bas de laquelle un homme était assis; je lui demande s’il n’a pas vu passer J.-C. : Oui, me répondit-il, il vient de gagner le haut de la montagne que vous voyez, et je crois bien qu’il s’y est arrêté pour vous attendre, car c’est là qu’il attend tous ses amis. À ces mots, je pars comme un éclair sans en demander davantage, et moi de courir si promptement, que j’arrivai en haut tout essoufflée; et après m’être arrêtée un instant, je cherchai partout, j’appelai à haute voix; mais je ne vis qu’une grande croix plantée droit au sommet de la montagne, et autour de cette croix quelques ouvriers qui travaillaient à en faire d’autres sur le même modèle; j’en vis dix ou douze toutes neuves de différentes grandeurs et de différents poids…
Mes bons amis, leur dis-je, en m’asseyant un peu pour me reposer, comment appelez-vous cette triste montagne? Vous devriez la connaître, me répondirent-ils, c’est la montagne du Calvaire, où vous devez faire votre demeure jusqu’à la mort. Eh! de grâce, pour qui faites-vous ces différentes croix? C’est pour vous-même. Je frémis, j’allai ensuite les essayer; mais je les trouvai si rudes et si pesantes, que je ne pouvais les soulever. Eh! mes amis, m’écriai-je, ne voyez-vous pas qu’il me sera impossible d’en porter jamais une seule ? Vous les porterez toutes à la fois, me répondit-on; mais elles auront beaucoup perdu de leur pesanteur et de leur rudesse; car elles ne sont pas encore finies, et cependant nous n’y ferons plus rien. Comme je ne compris point le sens de ces dernières paroles, je laissai ces ouvriers avec leur énigme pour m’occuper de la recherche de mon divin conducteur; car peu m’importait des croix, pourvu que je le trouvasse…
Elle découvre une grotte où elle trouve la jeune vierge dont elle a parlé, et qui polissait les croix, et lui demande son nom.
Je parcourais donc à ce dessein tous les coins et recoins du sommet de la montagne, et voilà que tout à coup j’entre dans une espèce de grotte ou espace ménagé entre des pierres, et j’aperçois dans l’enfoncement une jeune vierge d’une beauté ravissante, celle précisément, mon Père, qui vous a tant plu à vous-même la première fois que je vous en ai parlé. Aussi j’en fus ravie et enchantée dès le premier coup-d’œil, et je pense qu’il est impossible à un cœur de s’en défendre. Oui, c’étaient précisément le même port, la même taille, la même figure, les mêmes traits, le même air, le même parler, enfin la même personne que j’ai revue depuis, et dont il a été fait grande mention dans le songe précédent.
Ici, mon Père, le rabot à la main, elle était occupée à diminuer et à polir les croix que les ouvriers avaient faites, et dont la grotte était toute remplie. Après les avoir diminuées et polies, elle y répandait encore une certaine onction qui en faisait disparaître la rudesse, elle y travaillait avec une promptitude, une adresse et une grâce étonnante et merveilleuse. Toutes celles qui avaient passé sous sa main, étaient devenues douces et légères, je n’y voyais presque plus rien d’effrayant. À la place de l’horreur que j’avais naturellement pour les premières croix, je sentis naître une certaine ardeur pour celles-ci, et j’éprouvais que cette ardeur augmentait à mesure que je parlais avec la charmante ouvrière, au point qu’en finissant j’eusse eu le courage de les prendre et de les porter toutes à la fois.
J’étais surprise d’un changement si subit et si peu naturel, et peut-être en aurais-je toujours ignoré la cause, si je ne m’étais hasardée de demander le nom de cette aimable personne. Alors, pour me satisfaire, elle me regarda avec un visage riant et des yeux pleins du feu le plus pur ; et me montrant la croix qu’elle polissait, elle me dit gracieusement: « Je suis l’amour de celui qui l’a portée pour vous, et c’est pour votre amour et celui de tous les hommes que je travaille. J.-C. veut que tous ses enfants marchent sur ses traces en portant leur croix, parce que c’est la seule voie de la vie éternelle et du bonheur infini auquel il les appelle et qu’il leur a mérité; mais il veut qu’ils les portent sans en être accablés. Il veut enfin que ce soit par amour, et non par contrainte, qu’ils les portent, voilà pourquoi il me charge de les leur rendre plus douces et plus légères, et c’est pour moi une occupation bien agréable, puisqu’il m’est impossible de ne pas aimer ceux que J.-C. a tant aimés. »
Après ce discours, je m’éveillai remplie du désir de porter toutes les croix que me présenterait l’amour de J.-C., sans craindre désormais de les trouver jamais trop pesantes.
Voilà, mon Père, puisque vous vouliez absolument le savoir, les deux circonstances de mes songes, où j’ai vu cette aimable personne, cette charmante ouvrière à laquelle vous m’avez paru prendre tant d’intérêt. Mais puisque nous en sommes sur cet article, et que mon récit a un peu moins duré que je ne pensais, je finirai, si vous le voulez, par une vision que je me rappelle, et qui pourtant m’arriva, non pas dans le sommeil, comme les précédentes, mais dans mon oraison, il y a quatre ou cinq ans. La chose, à mon avis, mérite encore attention.
Vision de la Sœur pendant son oraison. L’arbre de l’amour.
Je me trouvai ravie dans une lumière
__________________________
(295-299)
où notre Seigneur m’apparut en forme humaine, il me conduisit dans un jardin vaste tout rempli d’arbres et de plantes de différentes espèces; j’y remarquai entre autres un arbre plus grand et plus beau, dont le fruit était gros et d’un aspect charmant, et le plus beau qu’il soit possible d’imaginer. Chacun des fruits de cet arbre était blanc d’un côté, et vermeil de l’autre; l’arbre et son fruit se nommaient l’arbre et le fruit de l’amour, l’arbre de vie, l’arbre du grand amour qui a opéré la rédemption du genre humain. Les autres arbres étaient, en comparaison, comme des sauvageons, qui ne portent que des fruits manqués et véreux…
J.-C. voulut bien m’expliquer le vrai sens de cette vision, en m’en faisant l’application à moi-même. « Combien de fois, me dit-il, faute de vous appuyer sur les mérites de ma passion, n’avez-vous pas porté de fruits véreux, gâtés et corrompus ? » À cette occasion, il me fit connaître que des millions d’âmes en étaient là, et ne produisaient pas des fruits solides et véritables, précisément parce qu’ils ne sont par leur disposition volontaire, que des sauvageons, qui ne sont point entés sur le bel arbre de l’amour de Dieu, ni sur les mérites de la passion du Sauveur, sans quoi pourtant tout ce qu’on peut faire est inutile pour le ciel. Mais c’est assez, mon Père, il est temps de terminer. Si vous faites usage de mes songes dans vos cahiers, les gens sensés et chrétiens qui les liront y trouveront des vérités bien solides sous une forme assez méprisable en elle-même; mais les lecteurs superficiels qui n’en pénétreront point l’écorce, ceux surtout qui n’y chercheront que les moyens de satisfaire une incrédule curiosité, ah ! je crains pour eux qu’ils n’en prennent occasion de mépriser tout ce que je vous ai dit. Priez pour moi.
Fin des songes.
——————–
RÉFLEXIONS DE L’AUTEUR.
M’étais-je trompé, lecteur, dans l’idée favorable que je me suis formée des songes que je viens de rapporter, et dans le jugement avantageux que j’en avais porté ailleurs ? C’est à vous maintenant d’en juger, et de nous dire si vous avez vu plus d’application morale, plus de justesse et de vérité dans aucune prédiction de ce genre que vous puissiez connaître.
Qu’on lise les romans spirituels où l’on se propose d’instruire l’esprit et de former le cœur aux vertus chrétiennes en amusant l’imagination du lecteur, et qu’on nous dise ensuite si on y a trouvé, avec une morale plus pure et plus sublime, une matière plus importante, un intérêt plus vif, un récit plus simple et plus naïf; enfin, plus de ce frappant qui enlève et transporte par l’enchaînement des faits agréables ou terribles. A-t-on jamais rien écrit de plus conforme à l’esprit de l’Évangile, ni de plus favorable à la perfection du chrétien? Par conséquent, quoi de plus juste et de plus réel? Quoi de plus ressemblant à l’inspiration proprement dite, que ce qui fait l’objet de ses différents songes, si on peut leur donner ce nom?
En effet, soit que l’Esprit-Saint ait agi sur l’esprit de cette sainte fille pendant son sommeil, ce qu’il a fait à l’égard de bien d’autres; soit, comme on pourrait le penser encore, que son cerveau eût encore conservé les traces des impulsions que Dieu y avait faites pendant le jour; ce qui paraîtra plus naturel, quoiqu’insuffisant, pour rendre raison de l’ordre admirable qui y règne, ainsi que du dessein qui s’y montre partout; de quelque manière que ces songes aient eu lieu, ils n’en sont ni moins surprenants en eux-mêmes, ni moins merveilleux par le naturel des récits, la simplicité comme la vérité des figures, et cet ensemble suivi si éloigné de l’inconséquence et de la bizarrerie des songes ordinaires.
Quoi de plus étonnant, encore un coup, quoi de plus inconcevable que de voir qu’une pauvre ignorante, couchée sur le grabat de sa cellule, ait encore, tout endormie qu’elle est, des idées plus justes, et plus morales, et plus sublimes que la plupart de nos beaux esprits dans leurs livres si vantés et composés avec tant d’art, d’étude et de secours ! et s’il m’est permis de me servir de cette expression, n’est-il pas singulier qu’une de ces bonnes âmes qu’on a tant méprisées, ait trouvé le moyen de mieux rêver en dormant, qu’ils ne le font d’ordinaire, quoique bien éveillés, au fond de leur cabinet ?
Il est donc, à mon avis, impossible de rendre raison de tout cela, sans avoir recours aux paroles déjà citées, et dont on trouve en elles seules l’accomplissement : Et erit in novissimis diebus, etc. Convaincus enfin, et comme accablés par les lumières contenues dans un ouvrage dont l’ensemble est admirable sous tous les rapports, écrions-nous du moins avec le Psalmiste: Que les
__________________________
(300-304)
voies de Dieu sont incompréhensibles, et qu’il est souverainement admirable dans ses saints!
Mirabilis Deus in sanctis suis. (Ps. 67, 36.)
———————————————-
DÉCLARATION
ET CERTIFICAT DES DEUX SUPÉRIEURES
De la Sœur de la Nativité.
Nous soussignées, religieuses de la communauté des Urbanistes de la ville de Fougères, attestons à qui il appartiendra, 1° que notre sœur dite de la Nativité avait, il y a bien des années, fait des annonces et prédictions touchant une secousse et un bouleversement qui devaient en peu commencer en France, et causer ensuite de grands troubles dans l’Église et dans les États; que, malgré le peu d’apparence qu’on en voyait alors, ce qu’en avait annoncé ladite Sœur avait paru si grand et si frappant au jugement de plusieurs bons ecclésiastiques, que le prêtre qui était en ce temps-là directeur de la maison, fut changé d’écrire, et qu’il écrivit en effet une rédaction que les contradictions et les méprises sur le compte de la Sœur l’avaient obligé de brûler comme malgré lui.
2° Que ladite Sœur de la Nativité avait, en 1790, chargé, de la part de Dieu, M. Genet, dernier directeur de notre maison, de ressusciter l’ouvrage qui avait été détruit; qu’elle lui avait, pour cet effet, communiqué des notes qu’il devait travailler dans un exil qu’elle lui annonçait comme prochain; que ledit M. Genet avait réellement tiré ces notes sous les yeux et la dictée de ladite Sœur, et qu’il les a rédigées depuis dans cet exil, en y joignant celles que nous lui avons fait passer nous-mêmes de la part et à la réquisition de ladite Sœur.
3° Nous attestons qu’après avoir attentivement pris lecture du recueil complet de la Vie et des Révélations de ladite Sœur, qu’il nous a présenté à son retour, nous n’y avons rien trouvé qui ne nous ait paru digne de foi et très conforme à la vérité des faits que nous connaissons, autant qu’il nous est possible d’en juger. En foi de quoi nous avons signé cet acte sans balancer, ajoutant même qu’il y a encore sur tout cela des circonstances particulières qu’il a omises, et qui ne seraient guère moins édifiantes dans la vie vraiment extraordinaire de cette chère et vénérable défunte, dont nous nous réservons de lui faire connaître la mort, avec le supplément qu’elle nous a chargées de lui remettre, et qui lui reste encore à rédiger.
4° Enfin nous attestons que sans vouloir prononcer sur les grandes choses que Dieu a fait voir à ladite Sœur, ni sur ses annonces qui ne sont que trop vérifiées, nous avons été très consolées, et même très affermies dans l’opinion favorable que nous en avions précédemment, par la lecture des suffrages très-avantageux des évêques, et autres lumières de la sainte Église que le rédacteur a consultés dans son exil.
À Fougères, le vingt-sixième jour de septembre mil huit cent deux de Jésus-Christ, et l’an dix de la république française.
Marie-Louise LEBRETON, dite en religion sœur de Sainte-Madeleine, ex-dépositaire de la communauté, et supérieure à l’époque de 1790, et jusqu’à celle de notre destruction.
Michelle-Pélagie BINEL, dite en religion Sœur des Séraphins, ex-Supérieure et dépositaire de la communauté à l’époque de 1790; sans aucun changement.
———————————————-
RECUEIL D’AUTORITÉS VIVANTES ET DE PIÈCES JUSTIFICATIVES, CONCERNANT LA VIE ET LES RÉVÉLATIONS DE LA SŒUR DE LA NATIVITÉ, RELIGIEUSE AU COUVENT DES URBANISTES DE LA VILLE DE FOUGÈRES, ÉVÊCHÉ DE RENNES, EN BRETAGNE.
—————————————-
AUX LECTEURS.
Charissimi, nolite omni Spiritui credere, sed probate spiritus si ex Deo sint. (Joan, 4, 1.)
Le Recueil qu’on vous présente a été lu et examiné en manuscrit par un grand nombre de juges compétents et très-éclairés, dont il serait trop long d’exposer en détail les jugements avantageux: que d’ailleurs la nature de cette production, vraiment extraordinaire, ne leur permettait guère de laisser publier, pour ne pas paraître prévenir en rien le jugement de l’Église sur un point qu’elle a seule le droit de décider.
Il suffira de vous dire qu’à peine sur six évêques ou davantage, à qui j’ai eu l’honneur de le présenter à Londres et dans les différents lieux de mon exil, depuis 1792 inclusivement (1); sur vingt ou trente vicaires-généraux et chanoines de différents diocèses, dix ou douze docteurs ou professeurs de théologie, en différentes universités; sur plusieurs auteurs, bien connus d’ouvrages estimés, en matière de religion, et pour le moins cent cinquante autres ecclésiastiques, vicaires, curés ou recteurs de différentes provinces, tant du clergé français que de celui d’Angleterre, tous également pieux et savants; à peine, dis-je, sur un si grand nombre, pourrait-on nommer cinq ou six individus qui ne lui eussent été favorables sous tous les rapports; et encore a-t-on de bonnes raisons de croire que ce petit nombre n’a suspendu son jugement que par prudence, et non par aucune mauvaise volonté; plutôt pour éclaircir les faits que pour les contredire ou combattre l’opinion prépondérante.
(1) Les évêques consultés et qui ont lu les cahiers contenant le recueil en question, sont entre autres, Mgr. l’archevêque d’Aix, aujourd’hui archevêque de Tours; Mgr. l’évêque de Tréguier, celui de Troyes, celui de Nantes, celui de Montpellier, celui de Lescar, etc., etc. Je ne fais point mention des laïcs en grand nombre et de toutes les classes, qui les ont lus avec beaucoup de profit et d’édification; car, quel qu’éclairés que soient plusieurs d’entre eux, ils ne peuvent être admis pour juges dans ces sortes de matières. Ainsi leurs éloges réitérés sont ici comptés pour rien.
__________________________
(305-309)
L’ouvrage a donc été universellement applaudi par les lecteurs de tous les ordres de l’Église, je pourrais ajouter, de toutes les classes de citoyens. On l’a unanimement jugé non-seulement bon et utile en lui-même, ce qui était le point principal, vu surtout que tous les vrais principes du dogme et de la morale y ont paru à couvert; mais encore je puis assurer que la très grande majorité des examinateurs et des juges a constamment penché à lui accorder l’inspiration proprement dite, qui leur a semblé incontestable : Digitus Dei est hic, ont-ils répété comme de concert; et, ce qui est bon de remarquer, cet aveu m’a été fait par des théologiens qui avaient, avant d’en rien lire, commencé par m’avouer leur répugnance, presqu’invincible, à admettre aucune espèce de nouvelle inspiration.
Ainsi, sans prétendre me prévaloir en rien de cette unanimité de sentiments en faveur d’une question qu’il ne m’appartient aucunement de décider, et que j’abandonne toute entière au tribunal où elle ressortit, je puis au moins en conclure que, sous tous les rapports, le recueil, tel qu’il est, a réuni incontestablement la pluralité des suffrages, dans l’examen qu’on en a fait jusqu’ici. À quoi je puis ajouter que, jusqu’ici, toutes les objections qu’on a faites se sont réduites au plus ou moins de défaut de goût qu’on a cru trouver dans ma rédaction, et sur lesquelles encore j’ai vu tant d’opposition dans les différentes manières d’en juger, qu’il m’a été comme impossible d’en rien conclure; à quelques opinions controversées dans les écoles, et à certains détails ou points particuliers qu’on avait assez souvent mal entendus, quelquefois même pris à contre-sens, comme il m’a été facile de le montrer.
Du reste, je le répète, on ferait un volume, s’il fallait recueillir ici tous les éloges qu’on m’en a adressés, tous les témoignages avantageux que j’en ai reçus de vive voix et par écrit, de la part des personnes les plus respectables et les plus capables d’en bien juger. Plusieurs des plus distingués parmi les lecteurs, des prélats eux-mêmes, en ont sollicité des copies, qu’ils ont fait relier proprement, pour les conserver, m’ont-ils dit, avec beaucoup de soin. Quelque longs que fussent mes douze cahiers, ils ont été ainsi écrits sept ou huit différentes fois à ma connaissance, et l’eussent été bien davantage encore, si, pour des raisons de prudence, je ne m’y étais formellement opposé ; ce qui n’a point empêché bien des copies tronquées qu’on en a tirées en cachette (1). L’ouvrage a même été traduit en anglais. Tous ont paru en désirer la publicité: plusieurs se sont offerts pour y souscrire et contribuer aux frais de l’impression; ce que j’ai toujours refusé, uniquement par la crainte de prévenir les moments marqués par la divine Providence.
(1) Ces différentes copies ont répandu l’ouvrage très au loin. Comme je n’en ai lu aucune, je les garantis d’autant moins, que j’ai su que quelques copistes se sont permis d’y faire les changements qu’ils ont jugés à propos , pour favoriser leurs opinions particulières touchant la politique ou autres objets.
Je souhaiterais de tout mon cœur m’en tenir là sur ce point; mais comme il pourra se trouver des lecteurs pour qui des témoignages dont je suis en quelque sorte le seul garant ne paraîtront pas devoir suffire, je vais tâcher de les satisfaire par quelque chose d’un peu moins général et de plus précis. Ce sera une liste de témoignages verbaux et d’extraits de lettres portant les noms des auteurs. J’y joindrai quelques lettres même imprimées sur les originaux, qui feront foi de tout ce que je viens d’avancer. Il est dans l’ordre après tout, il est juste de fournir à la bonne foi qui cherche à s’éclairer, des autorités suffisantes, des motifs sur lesquels elle puisse raisonnablement se déterminer. S’il pouvait s’en trouver qui fussent disposés à soupçonner la sincérité de mes citations, je les prierais seulement de faire attention que quand on me supposerait assez fourbe, il n’y aurait pas d’apparence que je fusse assez maladroit pour citer des noms aussi respectables, et mettre en jeu des personnages aussi connus, et à qui il serait aussi facile de me démentir.
Extraits de différentes lettres et déclarations verbales adressées au rédacteur.
Après les prélats dont on vient de parler, M. l’abbé Barruel était un des théologiens à qui je désirais le plus de communiquer mon manuscrit. À peine l’eut-il examiné, qu’il me pressa de lui en accorder une copie, qu’il fit tirer lui-même. Depuis ce temps, il n’a cessé de m’en témoigner sa reconnaissance de toutes les façons, ni de faire l’éloge de l’ouvrage, sans jamais se démentir.
« Plus je le lis, m’a-t-il dit et écrit souvent, plus je le trouve édifiant et admirable, et plus j’y découvre quelque chose de plus qu’humain. J’y vois mille choses que je n’avais vues nulle part: aussi me touche-t-il plus qu’aucun autre livre. J’y fais ma méditation la plus ordinaire, et j’espère que Dieu s’en servira pour ma conversion et mon avancement spirituel. Je vous prie de me recommander aux prières de votre bonne religieuse. » Plusieurs autres, et des évêques même, m’ont fait la même demande.
M. l’abbé Barruel continue en ces termes:
« On attaquera l’ouvrage de cette bonne âme, mais on ne l’anéantira pas: il est marqué à un coin qui le fera triompher de la critique. Faites-moi part de tout ce que vous pourrez apprendre de cette sainte fille. Tout ce qui la concerne m’intéressera toujours beaucoup. » Ce qu’il a répété, comme bien d’autres, à différentes personnes et en différentes occasions, sans jamais changer d’opinion sur ce point. Il a souvent dit, avec bien d’autres, que « cet ouvrage était capable de faire les plus heureuses impressions, et de produire dans les âmes les fruits les plus désirables de conversion, d’avancement et de salut. »
Tel a été constamment le jugement d’un auteur accoutumé à la critique des ouvrages et à la discussion des matières théologiques. Passons à d’autres.
M. Pons, curé de Mazamet, au diocèse de Lavaur, docteur et professeur de théologie, y a pris le même intérêt, et en a porté exactement le même jugement, après l’avoir lu avec beaucoup de soin. Voici en quels termes ce professeur, justement célèbre, commence le petit cahier des notes que je l’avais prié de me faire: « L’ouvrage de la religieuse de Fougères m’a paru contenir une théologie sublime, une morale douce, pure, des principes de conduite grands et lumineux; et quel que soit le jugement qu’on prononce sur son inspiration, je pense que la lecture en sera très utile aux fidèles, et leur donnera un grand goût pour la vertu. »
À cet éloge simple et précis, suivant sa manière de dire les choses, M. l’abbé Pons ajoute que : « Pour satisfaire à la demande du rédacteur, il va hasarder, sur tout l’ouvrage, quelques remarques qu’il ne croit point essentielles, et auxquelles il n’attache pas beaucoup d’importance. » Depuis ce temps, il a été un de ceux qui m’ont le plus pressé de faire imprimer l’ouvrage à Londres, pour pouvoir, disait-il, en emporter quelques exemplaires dans son pays.
M. Douglas, évêque de Londres, ne sachant point assez la langue française pour en bien juger par lui-même, se fit, en quelque sorte, remplacer par quelques-uns de ses prêtres, entre autres par le révérend M. Milner, attaché aux catholiques de Winchester; ce qui me procura avec ce célèbre écrivain une correspondance qui m’honorait beaucoup. Voici ce qu’il m’a écrit en différentes rencontres; je citerai ses propres expressions, que je traduirai ensuite, pour la commodité de ceux qui ne sont pas versés dans sa langue. Dans sa lettre en date du 13 septembre 1800, M. Milner me dit:
« …. The production upon the whole appears to me very wouderful for its sublimity, energy, copiouness, learning, orthodoxy and piety. Hence I have no doubt of its producing great spiritual profit to many souls, whenever you shall think proper to give it to the public. I remain,
« Dr. Sir.
« Your obliged servant
« John Milner. »
__________________________
(310-314)
Voici la-traduction:
…. Cette production me paraît, en général, très étonnante par sa sublimité, son énergie, l’abondance des idées et des choses, et la profondeur de théologie qui y règne, son orthodoxie et l’esprit de piété qu’elle respire. C’est pourquoi je ne doute aucunement qu’elle ne produise de très grands avantages et d’heureuses impressions sur bien des âmes, qui en feront leur profit quand vous jugerez à propos de la donner au public. Je demeure,
Mon cher Monsieur,
Votre très humble et obéissant serviteur.
Jean Milner.
Dans celle qu’il m’écrivit le 15 novembre suivant, il parle ainsi : « I cannot speak too highly of the sublimity and affecting piety of these revelations in general. »
C’est-à-dire,
« À prendre ces révélations en général, je ne saurais trop les élever, ni rien dire qui surpasse l’idée avantageuse que j’ai conçue de leur sublimité, ni de la tendre et affectueuse piété qui en fait comme le fond et le caractère distinctif. »
Le même auteur, écrivant à un prêtre anglais de ses amis et des miens, lui marque : « When you see our good friend M. G*., present my respectful compliments to him and tell him how desirous I was of seeing him when I was the other day at Sommerstown. It is impossible that you, or any gother person should have a greater veneration for the revelations of his spiritual daughter, than I have; or be more anxious to see them in print, for the edification of the good, and the conversion of the wicked. »
C’est-à-dire,
« Si vous avez, ou quand vous aurez occasion de voir notre bon ami M. G*., présentez-lui mes civilités ou compliments respectueux. Dites-lui combien je désirais de le voir la dernière fois que je passai à Sommerstown. Il est impossible que vous, ou qui que ce soit, puisse avoir une plus grande vénération que la mienne pour les révélations de sa fille spirituelle. Personne ne désire avec plus d’empressement que moi de les voir imprimées, pour la consolation et l’édification des bons, comme pour la conversion des méchants. »
M. Rayment, autre prêtre anglais, très distingué par ses connaissances théologiques, dans la province d’York, s’est donné la peine de traduire l’ouvrage en anglais, et m’a assuré qu’il ne donnerait pas sa traduction pour une bibliothèque. M. Hodgson , vicaire-général de Mgr. Douglas, a nommé le recueil une théologie infuse : tlieologiu infusia. Je pourrais en dire autant du révérend Dom Charoc, prieur des religieux bénédictins anglais, et frère de Mgr. l’évêque de Bath; de M. Lolimer, bénédictin anglais; du révérend père abbé de la Trappe, qui l’a fait copier pour ses religieux, et d’un grand nombre d’autres hommes de ce mérite, qui en ont fait le même cas, et en ont tiré au moins quelques fragments pour leur usage particulier.
Le R. P. Bruning, jésuite anglais, semble encore renchérir sur tout ce que nous avons vu. Non-seulement il m’atteste, comme bien d’autres l’ont fait, qu’il n’a jamais rien lu de plus important, ni de plus instructif; mais il va jusqu’à dire que si tous les bons livres qu’on a jamais écrits, sans en excepter aucun, étaient perdus, on pourrait les retrouver tous, et avec avantage, dans celui-ci tout seul : « May I add on the whole, were scripture no more and all the most valuable traces of instructive moral, doctrinal and theological science no more to be met with in other books; they might be all recovered in this one, and with interest beyond. »
C’en est assez, je pense, pour persuader à tout esprit qui se paye de raison, que je ne suis pas le seul de mon opinion, concernant l’ouvrage dont il s’agit, et que ce n’est pas sur mes faibles lumières, ni d’après mon jugement particulier, qui ne doit être compté pour rien, que je me suis déterminé à le donner au public (1). Sans vouloir donc multiplier des citations dont la liste deviendrait ennuyeuse par la répétition des mêmes éloges et des mêmes idées, j’ai cru qu’il suffirait d’ajouter en leur entier quelques-unes des lettres qui m’ont été adressées à ce sujet par des personnages assez marquants pour mériter qu’on y fasse attention.
(1) La dernière fois que je vis Mgr. l’évêque de Tréguier, avant sa mort, il me reprocha de ne pas proposer la souscription tandis qu’il y avait des Français en Angleterre.
Lettre d’un prêtre fiançais, réfugié à Paderborn en Westphalie, adressée au rédacteur.
(Imprimée sur l’original.)
Monsieur,
Vous serez surpris, sans doute, de recevoir une lettre d’un inconnu; mais l’intéressant ouvrage dont vous êtes le rédacteur, est plus que suffisant pour m’inspirer la confiance avec laquelle je m’adresse directement à vous-même. Ayant eu l’avantage de lire quelques cahiers des révélations de la Sœur de la Nativité, sans espérance d’avoir les autres dans le pays que j’habite, j’ose me flatter que vous voudrez bien favoriser le désir ardent que j’ai de posséder l’ouvrage entier. Je ne veux pas cependant vous être à charge, en sollicitant auprès de vous un exemplaire, que peut-être vous ne pourriez me procurer c’est pourquoi je fais prier la révérende Mère Augustin, trapiste, réfugiée près de Londres, de vouloir bien faire transcrire, s’il est possible, ledit ouvrage, en offrant le paiement de ce qui sera demandé, quoique je ne sois pas riche, comme la plupart des prêtres exilés. Mais de peur que cette digne religieuse ne puisse satisfaire mes vœux, ni même se procurer aisément un exemplaire, je vous prie instamment de lui en faciliter les moyens; et dans le cas où elle ne pourrait trouver des personnes propres à transcrire, je vous demande en grâce de vous employer vous-même à cette bonne œuvre, et je vous ferai passer ce qu’il faudrait payer à cet effet.
Du reste, Monsieur, ce qui me porte à cette démarche n’est pas une curiosité déplacée, bien moins encore l’esprit de critique, mais le désir sincère de m’édifier. Et si, comme je le crois prudent, il ne faut le communiquer qu’à un bien petit nombre de personnes choisies et parfaitement connues, je puis vous promettre d’être à cet égard de la plus scrupuleuse réserve. Je voudrais être à portée de vous donner des assurances plus positives encore; mais je ne puis que vous exposer la pureté de mes motifs religieux, et ce que je suis : prêtre français du diocèse de Rouen, expatrié pour la foi catholique, réfugié à Paderborn en Westphalie, depuis près de huit ans, où je suis employé pour les affaires ecclésiastiques des étrangers, et confesseur d’une communauté de carmélites françaises. J’espère, cependant, et votre zèle à procurer le bien auquel vous avez tant de part m’inspire la confiance, que vous voudrez bien accomplir mes vœux. Dans cette douce attente, j’ai l’honneur d’être avec respect et vénération ,
Monsieur, votre très-humble et très-obéissant serviteur,
J.-F. Vallée,
Prêtre français, chez les
Dames Bénédictines de
Gokirchen, à Paderborn.
Paderborn , en Westphalie , 6 juillet 1801.
Seconde lettre du même.
(Imprimée sur l’original.)
Monsieur,
J’ai tout lieu de croire que ma lettre vous ayant été remise, la réponse dont vous avez daigné m’honorer a été interceptée; c’est pourquoi je prends encore la liberté de vous écrire aujourd’hui pour vous prier d’accéder à ma demande, autant néanmoins qu’il vous est possible; car, malgré l’extrême désir que j’ai de posséder le précieux ouvrage dont il s’agit, je ne voudrais pas vous engager à violer les règles d’une sage discrétion. Je sens que la prudence doit présider à la manifestation d’une chose de cette nature, et qu’il
__________________________
(315-319)
faut user d’une grande réserve pour ne pas empêcher ou diminuer le bien qui doit résulter de cet ouvrage dans les desseins de la divine Providence. Mais vous êtes plus à portée que personne de juger sainement du pour et du contre; et puisque la communication que vous avez faite, du moins à quelques personnes, dudit ouvrage, semble annoncer que le temps est venu de le confier à ceux à qui il peut être utile, je vous réitère mes instances, afin que vous ayez la bonté de prêter, si vous le pouvez, un exemplaire correct aux personnes qui vous remettront ou feront remettre la présente. Je n’ose vous prier de faire faire vous-même la transcription et la correction de l’ouvrage, en vous assurant le remboursé de tout ce qui coûtera, ainsi que l’envoi sûr du manuscrit, par le canal de la respectable famille de Spencer, comme il est marqué aux personnes priées de la transcription.
Je vous ajoute seulement que vous pouvez être certain que je suivrai religieusement les règles que vous aurez la bonté de me prescrire, et qu’il me semble que j’ai des intentions droites en vous renouvelant ma pétition. Si vous daignez l’accueillir favorablement, vous me ferez le plus grand plaisir; et en vous en témoignant d’avance ma sincère reconnaissance, j’ai l’honneur d’être avec tous les sentiments de respect et de vénération,
Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur,
J.-F. Vallée,
Prêtre français, chez les Dames Bénédictines de Gokirchen, à Paderborn, en Westphalie.
Paderborn, 25 août 1801.
Lettre de M. l’abbé de Cugnac, vicaire-général du diocèse d’Aire, adressée, de la part de son évêque, au rédacteur du recueil.
(Imprimée sur l’original.)
Paderborn, le 16 juillet 1801.
Mgr. I’évêque d’Aire, Monsieur, avait vu, l’année dernière, dans une lettre écrite d’Angleterre, le compte avantageux que l’on rendait d’un manuscrit qui traite des visions d’une religieuse de Fougères. L’éloge qui, suivant cette lettre, avait été donné à l’ouvrage par quelques évêques, ainsi que par le savant et judicieux abbé Barruel, fit naître à Monseigneur le désir de connaître un écrit qui, suivant ces témoignages, ne renfermait pas uniquement des choses extraordinaires et faites pour piquer une vaine curiosité, mais qui offrait des traités entiers, aussi touchants que sublimes, des grands mystères et de la sainte morale de notre adorable religion.
Aussi apprit-il avec joie que le R. P. abbé de la Trappe avait apporté d’Angleterre cet ouvrage intéressant, et déjà recommandé par l’autorité de personnes respectables. Il s’est empressé de le demander au R. P. abbé, qui lui a prêté la partie qu’il avait alors fait mettre au net; c’est-à-dire, la moitié seulement du 2′ volume. Ce peu, pris dans le milieu de l’ouvrage, n’a pu, comme vous voyez, mettre encore Monseigneur à portée d’asseoir un jugement sur l’ensemble; mais la lecture de cette petite partie a convaincu Monseigneur qu’un tel ouvrage, soit par l’importance des matières qu’il traite, soit par la forme nouvelle dans laquelle il est rédigé, soit par l’autorité imposante sur laquelle on appuie tout ce qu’on y avance, méritait une attention particulière, exigeait qu’il fût lu avec réflexion, et qu’il ne suffisait pas d’en prendre une lecture unique et rapide, comme on fait de ces livres dont tout l’intérêt consiste dans la nouveauté et le merveilleux.
Monseigneur a donc désiré en faire prendre copie sur l’exemplaire du R. P. abbé; mais celui-ci n’a pas voulu le permettre, dans la crainte de manquer à la confiance qui lui avait livré ce manuscrit pour s’en procurer une copie. Cette délicatesse peut être respectable; mais Monseigneur est persuadé que les ouvrages de ce genre sont faits pour être entre les mains des évêques, avant toute autre classe de fidèles; et puisque cet écrit est déjà connu, et a été lu ici par plusieurs personnages de divers caractères et de divers états, avant Monseigneur, et même depuis la demande qu’il avait faite au R. P. abbé de lui en procurer la lecture, il croit pouvoir, il croit même devoir posséder un exemplaire de cet écrit, afin d’être à portée de le lire, de le relire, de le méditer avec toute l’attention et la réflexion qu’il mérite, et de redresser, dans l’occasion, les jugements que pourraient en porter des personnages qui ne sont rien moins que théologiens.
Mgr. l’évêque d’Aire vous prie donc, Monsieur, de l’autoriser, d’une manière à lever tous les scrupules du R. P. abbé de la Trappe, à prendre une copie sur l’exemplaire que celui-ci a apporté de Londres.
Monseigneur n’indique ce moyen que comme le plus facile et le moins coûteux; car il préférerait s’il était possible, et si les frais n’étaient pas trop considérables, de tenir de vous-même une copie plus correcte que celle du R. P. abbé, où les fautes sont multipliées, et quelquefois de nature à changer le sens ou à n’en présenter aucun. Monseigneur mettrait un grand prix à en avoir une lisible, revue et corrigée par l’auteur, ou, pour parler sans doute plus juste, par le rédacteur. Il n’insiste cependant pas sur cet article, parce qu’il est arrêté par la crainte, 1° que cela ne vous occasionnât trop de peine et de perte de temps; 2° que les frais, soit de l’écriture, soit du port, ne fussent trop coûteux. Il vous prie de lui envoyer d’abord, le plus tôt possible, l’autorisation qu’il vous demande, et de lui donner, dans votre réponse, un aperçu de ce que coûterait une copie et le port jusqu’à Hambourg. Mais la première de toutes les conditions est que ces soins ne soient pas trop gênants pour vous. Monseigneur désirerait que vous puissiez lui donner une notice des faits les plus particuliers à la sainte fille Sœur de la Nativité, et aux révélations qu’elle a reçues. Il s’attend bien à trouver dans le corps de l’ouvrage, et surtout dans sa vie, les traits généraux qui la feront connaître; mais si vous en saviez quelques-uns qui la caractérisassent encore mieux, et s’ils étaient de nature à pouvoir ajouter quelque degré d’authenticité aux révélations de la sainte religieuse et à l’autorité de l’ouvrage qui les rapporte, Monseigneur les apprendrait de vous, Monsieur, avec un grand intérêt, et n’en ferait que l’usage que vous jugeriez à propos.
Ne pourriez-vous pas aussi lui assigner, à peu près l’époque où la sœur de la Nativité avait connu que devrait paraître dans le public l’ouvrage que vous avez rédigé. Une religieuse arrivée de Londres nous assure qu’il n’est pas si secret dans cette ville, et qu’elle en a entendu lire plusieurs lambeaux.
Monseigneur désirerait savoir l’époque précise de la mort de la sainte Fille, qu’on a dit ici être, arrivée il n’y a pas encore un an. Si vous avez pu apprendre les circonstances qui l’ont précédée, accompagnée et suivie, ainsi que les communications qu’elle pourrait avoir eues de la volonté de Dieu depuis que vous avez fini l’ouvrage de sa Vie et de ses Révélations, et surtout au moment de sa mort, vous obligeriez Monseigneur de vouloir bien lui en faire part; et généralement tout ce qui regarde la sainte servante de Dieu, ses visions, l’ouvrage qui les rapporte, et le respectable prêtre qui l’a rédigé, est pour Monseigneur d’un grand intérêt, qu’il se flatte que vous voudrez bien satisfaire autant que vous le pourrez. — Il me charge de vous assurer des sentiments de sa plus véritable estime.
Je suis avec une haute considération et un grand désir de vous connaître,
Monsieur,
Votre très humble et très obéissant serviteur,
L’Abbé De Cugnac,
Vicaire général d’Aire , au collège
de Paderborn en Westphalie.
__________________________
(320-324)
Lettre de M. Martin, vicaire général de Lisieux, à M. l’abbé Guillot, qui lui avait fait passer les dix-huit cahiers contenant la première rédaction de l’ouvrage, en le priant de lui en dire son sentiment. M. Martin était alors à la tête des prêtres français qu’on avait transférés à la maison commune de Heading, et qu’il avait d’abord été chargé de présider au château de Winchester.
(Imprimée sur l’original.)
Monsieur,
Les dix-huit cahiers que je vous renvoie m’ont été communiqués par mademoiselle Magnarama. J’aurais désiré que l’auteur eût commencé par rapporter littéralement les notes de la Sœur de la Nativité, bien ou mal écrites, non que je doute de leur authenticité, ni de la fidélité du rédacteur. Quant à l’ouvrage considéré en lui-même, à l’exception de quelques descriptions et de quelques images qui me paraissent un peu trop poétiques pour un pareil sujet, je le trouve d’une bonté et d’une beauté également ravissantes. En général, il est très propre à éclairer l’esprit, à élever l’âme, la toucher et la persuader. Il donne en particulier les idées les plus magnifiques des attributs divins et de l’Église catholique. Sans entrer dans le détail des différentes matières qu’il renferme, il n’en est aucune qui n’y soit présentée d’une manière neuve, frappante, et extrêmement intéressante. En un mot, c’est, selon moi, un fonds riche et abondant, où l’on peut puiser non seulement de quoi s’édifier personnellement en le lisant et en le méditant, mais encore de quoi contribuer à l’utilité spirituelle du prochain.
Voilà, Monsieur, mon aperçu d’après la lecture rapide de ces cahiers qui m’ont été communiqués. Il serait à souhaiter que cet écrit fût imprimé, pour la plus grande gloire de Dieu et le bien d’un grand nombre d’âmes.
Je suis, avec une respectueuse considération,
Monsieur,
Votre très humble et très obéissant serviteur,
Martin, vic. gén.
Reading, 21 avril 1802.
Je me permettrai une réflexion sur cette lettre : c’est que ce n’était point la Sœur de la Nativité qui m’avait fourni des notes, comme M. Martin semble le supposer; c’était moi, au contraire, qui avais fait des notes sur ce qu’elle m’avait dit. Ces notes, je les avais faites uniquement pour aider ma mémoire, afin de ne rien omettre d’essentiel, ni pour l’ordre, ni pour le fond des choses. Ces notes, très insuffisantes en elles-mêmes, eussent été absolument inintelligibles pour les lecteurs.
Ainsi, pour le dire en passant et par occasion, je ne pouvais produire les notes premières, que pourtant plusieurs ont paru désirer, sans nuire à la cause commune, et même à l’intention de la personne qui me chargeait de la rédiger et de l’interpréter après l’avoir bien entendue, et non pas de la copier, moins encore de produire au public ce qui n’eût été qu’une énigme pour lui. C’était, après tout, son sens plutôt que ses mots, que je devais rendre.
Quant à l’autre reproche, qui tombe sur le style de la rédaction, je suis bien éloigné de n’y croire aucun défaut; mais enfin, tout ceci est une pure affaire de goût, sur lequel d’ailleurs j’ai tant vu de contradictions parmi les lecteurs des cahiers, que je n’ai pas cru devoir y faire beaucoup de changements dans ma dernière rédaction.
AVIS DE L’ÉDITEUR.
Le quatrième volume répondra parfaitement au désir de M. Martin, puisqu’il est imprimé textuellement et sans aucun changement sur la copie dictée par la Sœur elle-même, avec l’ordre et les titres qu’elle a aussi elle-même établis.
——————————————————
OBSERVATIONS
Sur la Vie et les Révélations de la Sœur dite de la Nativité, religieuse converse au couvent des Urbanistes de Fougères; suivies de sa vie intérieure, écrite d’après elle-même par le dépositaire de ses révélations, et rédigées à Londres, et dans les différents lieux de son exil, 1800.
« Confiteor tibi, Pater, Domine cœli et terræ, quià abscondisti hœc à sapientibus et prudentibus, et revelasti ea parvulis. (Math. 11, 25; Luc. 10, 21.) Quæ stulta sunt mundi elegit Deus ut confundat sapientes. (1 Cor. 1, 27. )
Tel est le sort de la vérité sur la terre, elle marche partout accompagnée de l’erreur, dont quelquefois elle ne paraît éloignée que d’un pas, et souvent dont même on a peine à la distinguer. Vérité d’expérience dont le monde physique et moral, dont la religion elle-même nous fournissent tant de preuves, qu’il serait inutile de s’y arrêter. Mais si Dieu, pour des raisons toujours adorables, a permis que le bon grain fût mêlé d’ivraie dans son champ il nous a donné des signes certains pour discerner l’un de l’autre, et sa bonté ne peut permettre que l’âme droite soit exposée à prendre le faux pour le vrai, et surtout qu’elle devienne inévitablement le jouet de l’erreur : probate spiritus si ex Deo sint.
Oui, tel est l’ordre et le dessein de sa providence, elle vient au secours de l’humaine faiblesse, mais sans jamais nuire au mérite de la foi. Par une conduite admirable, Dieu ne donne à chaque chose que le degré d’évidence qui suffit à ses desseins, et dans ce degré d’évidence il y a toujours assez pour satisfaire et rassurer l’âme juste, qui cherche la vérité de bonne foi, comme il y a toujours assez pour scandaliser, aveugler et endurcir celui qui veut l’être. Qui quœrit legem, replebitur ab eâ, et qui insidiosè agit scandalisabitur in eâ. (Eccl. 32, 19). « Il y a dans la religion, dit Pascal, assez de
__________________________
(325-329)
» lumières pour ceux qui ne désirent que de voir, et assez d’obscurité pour ceux qui ont une disposition contraire. Il y a assez de clarté pour éclairer les élus, et assez d’obscurité pour les humilier. Il y a assez d’obscurité pour aveugler les réprouvés, et assez de clarté pour les condamner et les rendre inexcusables. » (Pensées, ch. 18, p. 97.)
L’Église de J.-C., et c’est la remarque de ses historiens (par exemple, M. de Bercastel), n’a jamais été ébranlée par aucune secousse tant soit peu violente, qui n’ait été auparavant annoncée par quelques saints personnages, dont les vertus soutenues par la grâce, et les annonces confirmées par l’événement, ont toujours formé un contraste remarquable avec la conduite licencieuse et le langage imposteur des fourbes qui tant de fois ont trompé l’univers. Quoniam multi pseudoprophetœ exierunt in mundum.
C’est, nous osons le dire, un secours que dans ces circonstances critiques la bonté divine doit à la foi de ses enfants persécutés ou sur le point de l’être. La secousse qu’elle vient d’éprouver, et qu’elle éprouve encore, cette Église, n’était assurément ni moins étonnante dans son principe, ni moins violente dans ses exécutions, ni moins désastreuse dans ses suites, qu’aucune de celles qui l’ont précédée. Aussi le ciel, qui a permis ce dernier fléau, comme il a permis tous les autres, n’a-t-il pas manqué de venir encore ici au secours de ses élus, en leur fournissant par avance, et du courage contre la violence, et des préservatifs contre le scandale présent et à venir, par des avertissements bien circonstanciés sur les détails particuliers que la politique humaine la plus raffinée ne pourrait en aucune sorte prévoir ni annoncer.
Dans le nombre de ces personnes qui, à différentes époques, en ont parlé d’une manière qui semble à tout le moins tenir de l’inspiration, il en est une, entre autres, dont les récits, de beaucoup antérieurs à l’événement, ont depuis longtemps fixé l’attention de tous ceux qui en ont eu connaissance, et ont paru à des esprits judicieux et solides être de nature à soutenir tous les genres d’épreuves convenables, et montrer les vrais caractères qui commandent le respect.
Dépositaire de ses confidences et chargé de les transmettre au temps prescrit, c’est dans une terre étrangère, comme elle l’avait annoncé, que je me suis adressé aux principaux chefs de l’église, suivant la recommandation qu’elle m’en faisait alors, et sur laquelle elle avait tant insisté….
L’ouvrage donc a été lu et examiné par un grand nombre de juges compétents et très éclairés dont il serait trop long de détailler ici les suffrages. Plusieurs d’eux m’ont assuré qu’ils l’avaient lu avec le plus grand plaisir et la plus grande édification, et qu’ils en avaient été touchés plus que d’aucun autre livre ou production quelconque. Plusieurs m’en ont demandé copie, l’ont écrit ou fait écrire pour leur servir de méditation ordinaire; d’autres en ont pris des extraits, et tous ont paru en désirer la publication, quoique la nature de cette production extraordinaire ne leur ait pas permis d’y ajouter la sanction de leur autorité en laissant publier leurs noms à la suite des jugements favorables qu’ils en ont portés, et des éloges réitérés qu’ils en ont fait de vive voix et par écrit. On ne peut assurément qu’applaudir à cette sage circonspection, qui craint de prévenir en rien les décisions de l’Église dans les points sur lesquels elle a seule le droit de prononcer, et nous ne pouvons mieux faire que de nous régler sur ce modèle qui nous est tracé par les membres les plus distingués de cette Église, dont le jugement paraît aussi sain que leur attachement à la foi est inébranlable, et leur conduite exemplaire est digne d’admiration sous tous les rapports.
En conséquence, quoique le très grand nombre des examinateurs, parmi les évêques eux-mêmes, ait paru pencher à reconnaître l’inspiration divine et le doigt de Dieu dans ce recueil, digitus Dei est hic, comme ils l’ont tant de fois répété, et que, ce qu’il est bon d’observer, cet aveu m’ait été fait par des prélats et autres docteurs qui avaient commencé par me confesser leur répugnance presque invincible à admettre toute espèce de nouvelle inspiration; quoique ceux d’entre eux, qui y ont paru les moins favorables, n’aient jamais apporté que des raisons qui prouvent assez qu’au fond ils ne pensaient pas différemment, et qu’ils objectaient plutôt pour éclaircir que pour contester, cependant, pour ne rien prévenir sur ce point délicat, j’en abandonne aussi le jugement au public, en attendant que l’Église ait parlé, si jamais elle le fait: Probate spiritus si ex Deo sint.
Je me borne donc à l’approbation universelle, et sans aucune restriction, qu’on a donnée à la bonté de l’ouvrage en lui-même, qui a été jugé capable de faire les plus heureuses impressions, et de produire dans les âmes les fruits les plus désirables de conversion, d’avancement et de salut. C’est là, à mon avis, le seul point dont il importe au public d’être bien assuré, vu surtout que du côté du dogme, comme des principes de morale, tout y a paru hors
__________________________
(330-334)
d’atteinte et dans la plus rigoureuse exactitude. « L’ouvrage de la religieuse de Fougères, m’écrivait dernièrement un célèbre docteur et professeur de théologie (1), m’a paru contenir une théologie sublime, une morale douce et pure, des principes de conduite grands et lumineux, et quelquefois le jugement qu’on prononce sur son inspiration; je pense que la lecture en sera très utile aux fidèles et leur donnera un grand goût pour la vertu. »
(1) M. l’abbé Pons, curé de Mazamet, diocèse de Lavaur.
Le jugement d’un docteur particulier n’est que l’expression de celui de tous les autres, et il m’a été répété a différentes fois et de différentes manières par les théologiens les plus versés dans ces sortes de matières (1); il est devenu comme le cri public de tous les ecclésiastiques, anglais comme français, qui en ont pris lecture. Qu’on se rappelle ici les autorités respectables que j’ai citées dans le recueil précédent.
(1) Entre autres par M. l’abbé Barruel.
Cette universalité de suffrages, cette réunion d’opinions sur le point capital me donne une juste confiance qu’une production tant désirée pourrait bien un jour, suivant l’annonce qu’elle en fait, contribuer en quelque chose à la gloire de Dieu et au salut des âmes pour qui elle paraît destinée. Puisse l’événement répondre à notre attente, et notre espoir n’être pas trompé!
Il serait donc, encore un coup, fort inutile d’entrer ici dans une longue dissertation sur le degré de foi que l’on doit donner à l’inspiration de cette fille extraordinaire (1), sur les raisons qu’on peut apporter pour ou contre, comme sur le plus ou le moins de probabilité de ces raisons. L’Esprit-Saint, qu’on en croit l’auteur, éclairera mieux que personne sur tous ces points les âmes de bonne volonté qui liront, non par curiosité pour avoir lu, moins encore pour trouver à critiquer, mais dans le dessein de s’instruire, de s’édifier, et de profiter. Oui, nous osons l’espérer, la simple lecture de l’ouvrage, faite avec la droiture et la pureté d’intention convenable, fera plus pour de tels lecteurs que tout ce qu’on en pourrait dire; et ceux que cette lecture n’aura pas persuadés le seraient encore moins par des preuves qu’ils ne manqueraient pas de contester et d’affaiblir de toutes les manières. Car dans ce genre, et surtout dans le siècle où nous vivons, il serait impossible de convaincre ceux qui sont bien décidés à ne rien admettre de nouveau en fait de révélations et de prophéties particulières.
(1) La certitude d’une révélation particulière ne peut jamais produire une foi catholique qui demande une définition, mais bien une foi particulière pour l’âme où elle se trouve; c’est la doctrine de tous les théologiens, fondée sur l’écrit et l’exemple de plusieurs saints de l’ancienne et de la nouvelle loi. Abraham est loué pour avoir cru à l’inspiration divine particulière. Le père de saint Jean-Baptiste fut puni pour n’avoir pas ajouté foi à la parole d’un ange, et nous voyons que Jésus-Christ ressuscité reprend fortement ses disciples pour n’avoir pas cru au témoignage des saintes femmes qui l’avaient vu après sa résurrection. Stulti et tardi corde ad credendum ! (Luc, 24, 25).
Un chrétien raisonnable et fidèle doit pourtant considérer que ces anciennes prophéties en annoncent de nouvelles jusqu’aux derniers temps de l’Église. C’est une promesse que Dieu lui a faite, et le don de prophétie lui fut accordé comme celui des miracles, pour un temps illimité. Ce serait donc à tout le moins faire injure aux premières que de rejeter les autres sans examen. La puissance divine n’est liée dans aucun temps : tout ce qu’elle a pu autrefois, elle le peut encore; et certes, nous ne voyons pas pourquoi, quand les mêmes circonstances reviennent, la divine Providence ne renouvellerait pas les prophéties et les prodiges des premiers temps, lorsque sous nos yeux elle renouvelle d’une manière si étonnante toute la constance des premiers confesseurs et tout le courage et l’intrépidité des premiers martyrs de la foi. Mais il y a des esprits si prévenus, qu’ils ont prit irrévocablement leur parti sur tout cela; il serait impossible de les détromper, et peut-être dangereux de l’entreprendre; il vaut mieux les laisser abonder dans leur sens.
Quoi qu’il en soit, si l’œuvre en question vient de Dieu, il peut absolument se passer de l’approbation des hommes et il se soutiendra malgré tout ce qu’on pourrait faire pour l’anéantir; car qui peut effacer les caractères ineffaçables que le doigt du Seigneur imprime sur tout ce qu’il fait? Qui peut mettre obstacle à sa volonté décidée? C’est donc sur lui seul qu’il faut s’en reposer, et c’est à quoi je suis bien décidé, sans vouloir commander le jugement de personne, ni m’inquiéter beaucoup d’opinions arbitraires qu’il paraît d’ailleurs si difficile de concilier entre elles: In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus charitas; dit un Père de l’Église, Saint-Augustin.
Il est vrai, et c’est une objection qu’on me fera sans doute, qu’en bien des endroits mes réflexions décèlent ma façon de penser sur l’article, et que le titre même de l’ouvrage, ainsi que l’épigraphe, etc., montrent assez que je n’y suis rien moins qu’indifférent, et que je regarde l’inspiration de la religieuse comme bien certaine.
Je ne veux point le dissimuler; eh! pourquoi, après tout, ne jouirais-je
__________________________
(335-339)
point de la liberté que m’ont accordée tous ses juges, et que je laisse moi-même à chaque lecteur, d’en penser ce qu’il voudra ? Partout, je l’avoue, j’ai parlé d’après la persuasion intime où m’ont mis des relations où d’autres ne se sont pas trouvés à cet égard; mais comme il est possible que je me sois trompé, et que je me trompe en cela, je ne vois pas en quoi cette persuasion, qui m’est particulière comme à bien d’autres plus habiles, et sans laquelle je n’aurais jamais entrepris une pareille tâche, puisse imposer au lecteur l’obligation de penser comme moi, s’il ne le juge pas à propos, et s’il n’en voit pas de raisons suffisantes dans ce qu’il aura lu. En tout genre chacun a sa façon de penser et de prendre les choses, et il est tout naturel que chacun soit persuadé à raison des motifs qu’il en a.
Ainsi, en donnant les récits de la Sœur pour le résultat de ses révélations, et sous le coup-d’œil de l’inspiration divine, je ne prétends pas plus déterminer le jugement du public sur cette question que je ne prétends prévenir celui de l’Église sur la sainteté de cette bonne âme, et la canoniser d’avance, quand je la qualifie de Sainte Fille. Ces expressions, on le sait, ne doivent point se prendre à la rigueur. Ce qu’il y a de bien sûr, c’est que je ne suis pas le seul de mon avis sur le point en question, et qu’il s’en faut de beaucoup que l’avis opposé ait le même nombre de suffrages. À peine peut-on dire qu’il y ait eu quelques avis opposés parmi les examinateurs.
On me reprochera peut-être de la diffusion, trop de longueur surtout dans les préambules, des répétitions, etc. À cela voici ma réponse, je désire qu’elle puisse satisfaire tous les esprits : 1° Je ne doute aucunement que ma rédaction ne soit remplie de défauts, c’est à peu près tout ce qui m’en appartient ; 2° il faut bien se mettre dans l’esprit qu’il ne s’agit point ici d’un ouvrage fait pour amuser l’esprit par des dissertations curieuses et savantes, composées selon les règles du goût. C’est une espèce de traité dogmatique et moral, où l’on suppose, où l’on croit que Dieu lui-même instruit les hommes par des vérités solides, mises à la portée de tous et disposées de manière à être saisies de tous, à les précautionner contre les erreurs et les scandales des derniers temps, qui approchent et qui ne sont peut-être pas si loin de nous qu’on pourrait se l’imaginer; une nouvelle Apocalypse, si on peut le dire, dans laquelle, à l’occasion de la révolution française, J.-C. révèle, dévoile à une âme privilégiée, et pour le bien de tous, les préludes et les suites du règne de son plus grand ennemi, et toute la série des persécutions et des fléaux qui doivent agiter son Église jusqu’aux derniers temps de sa durée; voilà le cadre qui nous y est présenté.
Or, on sent assez qu’un ouvrage de cette nature ne peut rien avoir de commun avec un roman spirituel, fait uniquement pour des savants, ni avec les règles académiques, auxquelles je n’ai ni le talent, ni la prétention de me conformer. Quand Dieu fait tant que de parler aux hommes, c’est leurs besoins qu’il consulte, et non pas leurs caprices, leurs plaisirs ou leurs goûts. Il leur manifeste sa volonté de la manière qu’il le veut et qui leur est la plus utile, sans qu’ils aient droit d’y trouver à redire, ni d’y vouloir rien changer.
Au reste, si on veut y faire attention, on conviendra sans peine, comme plusieurs l’ont fait, que jamais livre peut-être n’eut plus besoin de préliminaires pour être bien compris, et que, loin de m’en faire un crime, le lecteur curieux de s’instruire du fond de la chose, ne peut que me savoir gré de lui avoir mis sous les yeux le seul moyen d’en bien juger.
Outre la vie de la Sœur, qui, quelque abrégée qu’elle fût, devait nécessairement occuper un certain espace, outre les circonstances également inévitables des premiers écrits qui furent faits il y a plus de trente ans, j’avais, pour la tranquilliser, à discuter et à résoudre toutes les difficultés de la Sœur, ou plutôt toutes les objections et les chicanes par où le démon tâcha de la déconcerter et de la détourner de son projet, comme on le verra.
Il fallait abréger tout cela, dira-t-on? Fort bien. Aussi l’a-t-on fait autant qu’on l’a cru possible; mais aussi il fallait prendre garde de trop abréger, et on en conviendra si on veut un moment se mettre à ma place et voir la chose comme il convenait de l’envisager. Car, enfin, ou je devais taire les objections de la Sœur, ou de son ennemi, ce qui eût été une infidélité impardonnable; ou je devais, en les rapportant, rapporter aussi avec la même exactitude les réponses qu’on y a faites, et les raisons au moins principales par où l’esprit de la Sœur fut tranquillisé. Elle ne sera pas vraisemblablement la seule âme à qui les mêmes objections seront suggérées, et qui pourraient y être arrêtées, comme il a paru par les réflexions qu’on m’a faites, et qui n’en étaient que les répétitions; les raisons qui l’ont décidée pourraient peut-être aussi les décider, comme
__________________________
(340-344)
il est arrivé plus d’une fois à ma connaissance.
Aussi de bons juges ont-ils regardé tous ces préambules comme la pierre essentielle et fondamentale de tout l’édifice. Ils en ont fait cas à proportion qu’ils en ont fait de l’ouvrage même. Je conviendrai toutefois qu’il faut en tout éviter une longueur excessive et fatigante, tout ce qui serait inutile ou superflu; mais ce n’est pas par le nombre des pages, c’est par les choses qu’elles renferment qu’il en faut juger. Un discours très long peut être encore trop court, comme un très court peut être encore trop long. Indépendamment de la manière, le vrai est toujours de raconter les choses comme elles se sont passées, et non autrement. Au reste, dans un ouvrage comme celui-ci, je ne vois pas comment une seconde ou une troisième raison, quand elle est bonne, pourrait nuire à la première qu’on aura donnée. C’est un exemple que Dieu lui-même nous fournit en mille endroits des Saintes écritures, où les mêmes vérités nous sont présentées si souvent et de tant de manières différentes.
Ce n’est pas tout, et je ne puis finir cette discussion avant d’avoir expliqué une bonne fois, pour ne plus y revenir, de quelle manière se sont prises les notes qui forment le recueil, et de quelle manière j’en ai fait la rédaction. Par cet exposé simple et naïf, je préviendrai mille questions qu’on pourrait faire, et mille fausses conséquences qu’on pourrait tirer; je rendrai la justice que je dois à la vérité que Dieu connaît, et je mettrai tous les supérieurs ecclésiastiques et toutes les personnes bien intentionnées à portée de juger sainement sur un point aussi essentiel à la chose. C’est le but que je me suis toujours proposé.
Je le déclare donc, il s’en faut de beaucoup que les récits qui composent ce recueil, m’aient été dictés de mot à mot comme le thème d’un écolier. Tout mon soin, comme celui de la Sœur, était de me faire entrer dans son sens, plutôt que dans ses expressions, qui très souvent n’étaient pas françaises. Vous direz toujours mieux que moi, pourvu que vous me compreniez, me disait-elle fréquemment: c’est donc à quoi spécialement nous nous sommes appliqués tous les deux dans toute la suite de nos entretiens! et elle m’a témoigné plus d’une fois que j’y réussissais, au point que personne, sans même en excepter M. Audouin, ne l’avait pas si bien comprise. Ce que je répète uniquement pour rassurer un peu, s’il se peut, les âmes timides qui affectent de trembler à chaque pas que je me sois écarté du vrai sens. Il ne faut ici ni prévention, ni terreur panique, ni trop de timidité. Si c’est l’ouvrage de Dieu, soyons sûrs que sa Providence aura pourvu à tout.
Il est vrai cependant qu’en bien des choses j’eus beaucoup à écrire sous la dictée de la Sœur, si on peut le dire. Outre les expressions qu’elle employait comme de la part de Dieu, et dont elle m’enjoignait de me servir, j’eus à écrire une très grande partie, et le plus qu’il me fut possible, de tous ces grands détails touchant les attributs divins, la création, l’Église, le purgatoire, l’enfer, la fin du monde, le sort des petits enfants, notre révolution, et toutes les visions par où Dieu lui en avait montré les causes et les effets…. J’écrivais donc, parce que je sens parfaitement qu’en tout cela, ni la bonne volonté, ni les mots ne pouvaient suppléer aux grandes choses qu’elle me disait, et je ne me fiais point assez à ma mémoire pour oser me promettre de ne rien omettre d’essentiel. Il me fallait donc écrire; mais, loin d’avoir amplifié ces endroits-là même, comme on pourrait peut-être se l’imaginer, on verrait, si l’on avait entendu la Sœur elle-même, que je n’ai guère fait que prendre le fond et la quintessence de ce qu’elle me disait.
J’ai encore plus quintessencié ce qu’elle m’a fait écrire dans la suite par madame la supérieure (1), parce que celle-ci ne voulant prendre sur elle que la peine, était obligée d’écrire tout ce que la Sœur disait pour se bien faire entendre à elle, et me mettre à portée de la bien apprécier dans ma rédaction: ce qui emportait nécessairement bien des mots qu’il m’a fallu abréger. Mais les détails de la Sœur, quoiqu’un peu longs quelquefois, m’ont toujours paru si intéressants pour le fond des choses, et quelquefois même pour la manière, qu’en bien des points je craindrais plutôt d’avoir fait trop que trop peu de retranchements. Quoi qu’il en soit, voici en général de quelle manière tout s’est passé, surtout par rapport aux détails qui paraissaient demander moins de précision, dans les premières notes que j’ai tirées moi-même.
(1) N’est-ce pas un coup de la Providence que je n’aie pas été le seul à prendre les premières notes? Dieu l’a permis sans doute pour fournir au moins un témoin de plus à la vérité fondamentale d’un ouvrage qu’il prévoyait devoir être attaqué par la base même. Voilà de quoi lever les doutes de la bonne foi; cela suffit, et la bonté de Dieu ne doit rien de plus.
La Sœur parlait quelquefois assez longtemps sans que je fisse autre chose que de l’écouter avec attention comme elle me le recommandait. Ensuite, après six ou huit minutes passées de la sorte, c’est-à-dire, après que le sujet avait été suffisamment développé à sa manière, alors, ou je la priais d’arrêter, ou elle me demandait si je l’avais bien
__________________________
(345-349)
comprise: Voilà, mon Père, me disait-elle, ce que Dieu me fait voir, afin que vous en preniez le fond. Sur cela, j’écrivais huit ou dix lignes en notes abrégées, que je lisais ensuite lentement à la Sœur, qui m’écoutait avec beaucoup de soin; elle me faisait sur-le-champ ses réflexions: Bon, bon, mon Père, me disait-elle ordinairement, vous y êtes bien, vous avez mieux parlé que je n’avais fait; mais surtout je vois que vous êtes dans le vrai sens de la lumière qui m’éclaire et me conduit… Tenez-vous y bien, et n’en sortez pas quand vous travaillerez sur vos notes….
Quelquefois il lui est arrivé de me dire que je n’y étais pas encore tout à fait, et qu’elle voyait quelque différence entre le vrai sens et ma façon de rendre la chose; mais je ne me rappelle pas qu’elle m’ait jamais dit que j’eusse été dans un sens directement opposé au sien. Quoi qu’il en soit, tout était corrigé souvent par le changement d’un seul terme, et je ne lâchais prise qu’après qu’elle m’avait approuvé, en me disant que j’étais dans le vrai sens que Dieu lui faisait voir. Elle m’a dit aussi, dans certains moments, que ce qu’elle voyait était exactement dans le même sens que ce que j’avais dit tel jour à tel endroit de mon instruction sur tel sujet, et que j’aurais pu profiter des mêmes idées dans ma rédaction, etc.…
Ainsi, tout consistait entre la Sœur et moi dans un certain commerce de pensées de son côté, et d’expressions du mien; dans une pareille correspondance, je ne devais pas, je n’aurais pas voulu penser sans elle, et il me semblait assez souvent qu’elle n’eut pu que très difficilement exprimer ses pensées sans moi. Qu’on le prenne comme on voudra, Dieu probablement avait ses raisons d’en ordonner ainsi, ne fût-ce que pour humilier l’un et l’autre. Pourtant il lui suggérait quelquefois les expressions mêmes, et alors il n’y avait plus aucunes recherches à faire, il fallait s’en tenir au terme prescrit, qui était toujours le plus propre et le meilleur qu’on pût employer. Souvent elle avait l’idée sans l’expression; mais ce qui a de quoi surprendre, c’est qu’il arrivait quelquefois qu’elle avait l’expression et l’idée sans en avoir la convenance. Voilà bien exactement comment se sont tirées les premières notes que quelques lecteurs ont paru désirer; mais il est bien évident qu’il serait fort inutile de les produire, quand elles existeraient encore; et la raison, c’est qu’il serait impossible de les lire, et plus encore d’y voir une certaine suite, qui ne peut se trouver que dans la rédaction. Il serait donc encore bien plus facile d’y supposer tout ce qu’on voudrait, pour ne rien croire de ce qu’on ne pourrait pas même déchiffrer. Bien certainement ces feuilles détachées et sans suite, ces abréviations indéchiffrables ne pourraient fournir aucune espèce de preuve, et la demande opiniâtre qu’on en ferait pourrait paraître l’effet d’une précaution plus mal intentionnée que judicieuse.
Maintenant on doit bien s’imaginer que la rédaction a dû se faire dans le même esprit et la même crainte de m’écarter du plan et des vraies idées de la Sœur; mais si, en rédigeant, j’ai quelquefois puisé dans les principes de la théologie, ou même dans mon propre fond, de quoi remplacer ce qu’elle m’avait dit et que je n’avais pu écrire, en un mot, de quoi donner à ses idées la juste étendue et le développement nécessaire qu’elle me chargeait elle-même de leur donner, en suivant toujours le même sens, je crois n’avoir fait en cela que remplir ma tâche, loin de m’en écarter; et quand tout cela ne serait pas compris dans l’idée même de rédaction, je suis sûr, à n’en pas douter, que tout cela était compris dans l’idée de la personne qui me chargeait de la rédiger. Ainsi le recueil, tel qu’il est, présente les vraies pensées de la Sœur prises dans leur ordre naturel, et présentées dans leur vrai point de vue, autant du moins qu’il m’a été possible; les premières notes ne feraient que les défigurer.
Il y a donc, en fait de style et de rédaction, trois choses à considérer dans le recueil: 1° les expressions qu’on attribue à Dieu lui-même, ou qui sont employées comme venant de la part de J.-C.; 2° les expressions de la Sœur, auxquelles je joins tout ce que je lui ai lu, et qu’elle a approuvé; 3° tout ce qui est de moi, je veux dire tout ce que j’ai cru nécessaire pour donner à l’ensemble un certain ordre et une certaine étendue dans le même sens ; mais tout cela se trouve tellement lié dans l’ouvrage, qu’en bien des choses j’aurais peine moi-même à en faire le discernement, et je pense qu’il serait encore plus facile à tout autre de s’y méprendre. Ceux donc qui ont remarqué et objecté que c’était partout le même style et la même tournure, n’ont pas fait en cela une grande découverte, et on ne voit pas quelle induction défavorable on pourrait en tirer. C’est partout le même style, cela est tout naturel et ne pourrait guère arriver autrement; parce qu’en effet c’est partout le même esprit qui parle par le même organe; c’est partout le même homme qui écrit, et il n’y avait pas plus de raison de changer de style que de changer de main.
__________________________
(350-354)
Le point serait donc, pour dire quelque chose, de montrer que je n’eusse pas exactement saisi ni rendu ses idées, qu’en bien des rencontres je me fusse écarté de ses vues et de son dessein. Tout cela, sans contredit, est très possible; mais pour le montrer il faudrait d’abord l’avoir entendu soi-même : il faudrait, en second lieu, prouver qu’on l’aurait mieux comprise que je n’ai pu le faire; jusque-là le bon sens décide qu’on doit s’en tenir à mon témoignage comme à celui de la Sœur, parce que toute la présomption est en faveur de celui qui non-seulement a été le seul à l’entendre, mais encore qui a été à portée d’elle, et chargé par elle-même de l’interpréter et de la faire parler à la postérité. On n’a donc d’autre voie de récuser son témoignage que de montrer qu’il lui prête un langage contradictoire, opposé aux divins oracles, aux lois et décisions de l’Église; indigne enfin de celui qui la fait parler. Voilà, je crois, ce que doit naturellement penser l’homme de bon sens qui désirera de s’instruire et non d’incidenter.
Il s’ensuivra presque, dira-t-on peut-être, que vous eussiez été inspiré vous-même, ou du moins que vous eussiez reçu une espèce d’infaillibilité pour cette rédaction, aussi bien que pour vos réponses à la Religieuse…. Il s’en suivra tout ce qu’on voudra : car je ne veux entrer ni dans les raisonnements qu’on peut faire, ni dans les conséquences qu’on peut tirer. Je déclare seulement que, loin d’y avoir aucune espèce de droit, je me reconnais absolument indigne de pareilles faveurs; mais aussi, j’ajouterai avec la même candeur et la même naïveté, qu’au pis-aller, si une fois on suppose que le ciel les ait accordées à cette bonne âme pour le bien de l’Église, pourquoi, pour les mêmes raisons, ne pourrait-on pas supposer qu’il eût aussi gratuitement accordé quelque assistance, en particulier, au chétif travail de celui qu’il a appelé à la seconder? Il me semble au moins y voir quelque convenance; et quand je réfléchis que les instruments les plus vils, les plus faibles et les plus méprisables en eux-mêmes, sont précisément ceux dont Dieu se sert d’ordinaire en pareil cas, ceux qu’il préfère à tous les autres, il me paraît alors qu’on pourrait bien le croire de moi plus que de personne. C’est le seul titre que j’aie à la chose, titre qu’on aurait grand tort de me contester, et qu’on ne s’avisera pas même de m’envier. Voilà toute ma réponse sur cet objet.
Je n’ignore pas, d’ailleurs, qu’annoncer un ouvrage comme inspiré de Dieu, ou du moins comme le résultat des confidences d’une âme que le ciel instruit et favorise, c’est comme s’engagera soutenir tout ce que ce titre a d’imposant. Comme il n’y a point, et qu’il ne peut y avoir d’autorité plus sainte que celle de Dieu, ni de sanction plus sacrée que celle qui résulte de cette autorité, il n’y en a point aussi sur laquelle on ait droit d’exiger des preuves plus rigoureuses avant de se rendre : il n’y en a point même sur laquelle on doive être plus en garde contre la surprise; c’est très probablement à quoi l’on ne manquera pas, on doit bien s’y attendre, et l’on s’y attend effectivement, surtout de la part d’une certaine classe de lecteurs, qui, sans avoir beaucoup de religion peut-être, n’en affecteront pas moins de croire la cause de Dieu compromise par une production de cette espèce, et qui porteront même l’aveuglement jusqu’à se persuader de combattre pour la raison et la foi, tandis qu’ils ne défendront que les intérêts de l’irréligion et des passions, que l’ouvrage attaque et détruit de toutes les manières.
La première condition qu’on exigera, sans doute, avant de croire à cette inspiration, ce sera une information juridique, ou procédure canonique, qui en constate la réalité. C’est du moins la demande qu’on m’a faite. A cela je réponds que jamais, en pareil cas, on n’a usé d’un pareil expédient, qui ne pourrait rien prouver, puisque ce qui se passe entre l’âme et Dieu ne peut être du ressort du témoignage extérieur, ni de la relation des sens corporels. Ainsi cette cérémonie serait fort inutile; jamais les hommes inspirés n’ont apporté d’autre authenticité de la vérité de leurs paroles que leurs paroles mêmes, ni d’autre garant de leurs prophéties que leur accomplissement. Il semble, en effet, que c’est à quoi Dieu lui-même réduit toute la preuve qu’on est en droit d’exiger. Propheta qui vaticinatus est pacem, cùm venerit verbum ejus, scietur propheta quem misit Dominus in veritate. (Jérém. 28. ) Qu’on examine maintenant, et qu’on compare ce qui est annoncé avec ce que nous avons vu et ce que nous voyons, je ne crois pas qu’il soit possible de mieux prouver le point en question.
Quant à l’assurance qu’on demandera encore, que les annonces en question m’aient été faites avant mon départ, je ne pourrais guère ici apporter que le témoignage des examinateurs à qui je me suis adressé dans le premier lieu de mon exil, et qui pourraient attester qu’ils ont lu à Jersey ces mêmes annonces dès le commencement de 1792; il fallait donc qu’elles eussent été faites auparavant. Quant au reste, si la Providence ne permet pas que je retrouve vivantes, ni la Sœur, ni aucune des personnes qui avaient
__________________________
(355-359)
connaissance des faits mentionnés, il y a tout à présumer que vous n’aurez sur ce point rien de plus certain que mon témoignage, qui sera toujours tel que je l’ai déposé. Ce sera à vous de voir s’il est digne, ou non, de votre attention, sans vous attendre, pour prendre un parti, à une nouvelle révélation, une révélation personnelle que Dieu ne vous doit point, et que très vraisemblablement il ne vous accordera pas.
Resterez-vous donc, par cela même, sans aucun motif capable de vous déterminer, comme si tout dût dépendre d’une circonstance purement accessoire, tout à fait étrangère à la vérité des choses, et qui ne peut y apporter aucun changement ? Détrompez-vous, lecteur, et soyez persuadé que Dieu, qui a plus d’un moyen d’affermir son œuvre, y aura pourvu, en suppléant au défaut d’authenticité extrinsèque, par des preuves tirées de la chose elle-même. Oui, j’ose l’assurer, si j’en ai une juste idée, c’est dans l’ouvrage même qu’on trouvera ces preuves indépendantes de toutes les formalités extérieures, ces preuves qu’on ne peut altérer ni contrefaire; je pourrais dire cette empreinte de la Divinité, toujours suffisante pour fixer un esprit juste, une âme droite, qui cherche la vérité de bonne foi, et ne veut se déterminer que sur des motifs raisonnables de crédibilité. Rationabile obsequium vestrum. (Rom. 12, 1.)
Nous l’avons déjà dit, tout livre qui s’annonce sous l’enseigne périlleuse de l’inspiration, doit au moins, sous peine de mépris public, fournir au soutien des preuves que la saine raison puisse avouer. Rien de plus équitable que la demande qu’on en fait : aussi, je le répète, j’ose assurer qu’on sera satisfait de ce côté-là, par la lecture de l’ouvrage même, surtout si, au lieu de s’arrêter à quelques détails isolés, à quelques circonstances minutieuses et purement accessoires, sur lesquelles les objections et les réponses ne finiraient jamais, on le considère dans les circonstances et sous le point de vue où il doit être envisagé. Si, le bandeau sur les yeux, on examine d’où partent ces grandes choses qu’on y dit, et le terme où elles aboutissent, quel est le caractère de la personne qui parle, la trempe de sa vertu, le ton qu’elle prend, le cadre qu’elle présente, la variété et l’élévation des objets qu’elle embrasse, la manière dont elle les traite, et surtout le but qu’elle s’y propose, paraîtra-t-il alors naturel et raisonnable? paraîtra-t-il possible de supposer qu’une telle production pût être le résultat des conceptions incohérentes, nécessairement incohérentes, faibles, incertaines, et souvent contradictoires, d’une ignorante abandonnée à elle-même, et ne pouvant trouver en elle-même aucun moyen suffisant, aucune cause proportionnée à un pareil effet; car enfin il ne s’agit pas de faire des suppositions en l’air, ni de payer de mots insignifiants.
Quand cette bonne âme serait aussi ambitieuse qu’elle est modeste et timide; quand elle serait aussi artificieuse qu’elle est humble et éloignée de toute duplicité; enfin, quand il serait possible d’allier ensemble, et dans la même personne, des qualités et dispositions aussi inconciliables et aussi évidemment contradictoires que le sont celles qu’il faudrait lui supposer, je demande si cet assemblage bizarre, dont peut-être on n’a jamais vu d’exemple, lui donnerait des connaissances qu’elle ne peut avoir, et une profondeur théologique absolument au-dessus de sa portée. Qu’on réponde; suffit-il d’avoir la volonté de tromper le public pour y réussir à ce point? Dieu peut-il le permettre, et en a-t-on quelque preuve? Qu’on cherche parmi les imposteurs et les fourbes dont le monde a été dupe, quelqu’un qui, sans autres moyens humains, ait produit dans le même genre un ouvrage qu’on puisse comparer à celui-ci, et une suite de preuves qui puissent entrer en parallèle… Ce qu’il y a de certain, c’est que je n’en connais point, et que les examinateurs m’ont avoué plus d’une fois l’impossibilité de le trouver. Ces imposteurs, j’en conviens, se sont cependant donnés pour les envoyés de Dieu. Jusque-là rien de plus facile, et tout est égal de part et d’autre; mais quelles preuves nous ont-ils laissées de leur mission? Voilà précisément le point qui décide et qu’il faudrait examiner, sans quoi nous serions dupes de trompeuses apparences en admettant un parallèle qui ne peut jamais se soutenir.
Aura-t-on recours, pour expliquer la chose, à un cœur tendre et échauffé par le suc de l’amour divin, à une imagination vive et exaltée par la méditation profonde des grandes vérités de la religion ?… Mais y a-t-on bien réfléchi, quand on m’a fait une pareille supposition ? Ou cette exaltation vient des forces de la nature, ou elle vient de Dieu, ou elle vient du démon: pas de milieu. Si elle vient des seules forces de de la nature, nous en soutenons l’insuffisance par les raisons déjà données. Si c’est l’ouvrage de Dieu qui l’excite et la conduit, c’est à peu près la supposition que nous faisons nous-mêmes. Si elle vient du démon, nous prions ceux qui le pensent de nous dire: 1° comment Dieu, qui n’a jamais permis que l’erreur ait prévalu sur la vérité pour l’obscurcir au point de ne laisser aucune ressource à la bonne foi, ait pu
__________________________
(360-364)
permettre que cette bonne âme ait été constamment, et sans aucune faute de sa part, dupe d’une illusion damnable et le jouet d’un ennemi aussi cruel que subtil; ne serait-ce point le cas de lui dire ici avec un savant théologien: Seigneur, si je suis dans l’erreur, c’est vous qui m’y avez mise; oui, mon illusion vient de vous, puisque vous l’avez permise, sachant que par moi-même je ne pouvais y échapper : Domine, si error est, à te decepti sumus.
2° Nous le prions de nous dire comment le démon, qui a tant d’intérêt à nous tromper et à nous retenir dans les pièges où il nous a fait tomber, a pris ici précisément tout le contre-pied de sa marche ordinaire, en nous indiquant les moyens les plus sûrs de découvrir les pièges, de nous préserver de ses embûches et de toute la noirceur et la subtilité de ses desseins. Ne serait-ce pas là travailler à détruire son ouvrage et à renverser son propre empire, comme le dit J.-C. aux Pharisiens incrédules : Si Satanas Satanum ejecit adversùs se divisus est, quomodò ergò stabit regnum ejus ? ( Matth. 12, 26.) Encore une fois, c’est à eux à nous expliquer tout cela. Pour moi, j’avoue que cette explication serait absolument au-dessus de ma portée. De pareilles découvertes demandent un effort de génie qui n’est ni de mon genre, ni de mon pouvoir. Mais ce qui achève de montrer l’invraisemblance ou plutôt l’impossibilité d’une opinion qui n’a pas paru admissible ni dans elle-même, ni dans ses suites, qui seraient horribles, comme on a dû le sentir, c’est la réflexion qu’on peut faire sur les différentes positions où s’est trouvée la Sœur, et les différentes affections qu’elle a éprouvées, et qui toutes paraissent incompatibles avec cette exaltation du cœur ou de l’imagination, qu’on voudrait lui supposer.
Car, 1° dès le commencement de sa vie intérieure, la Sœur nous atteste, et cela d’après J.-C. lui-même, qu’elle n’avait que deux ans et demi, quelques jours de plus, lorsqu’elle fut favorisée de sa première vision. Or, on ne dira pas qu’à cet âge son entendement, ni aucune de ses facultés intellectuelles aient été naturellement susceptibles d’élévation ou d’exaltation, puisqu’elles n’existaient pas encore et qu’il s’agissait plutôt de les former que de les exalter. L’enfant, à cet âge, n’a qu’une idée confuse de sa propre existence, il ne soupçonne pas même celle de Dieu : on en conviendra facilement.
2° Elle nous atteste qu’en bien des choses elle parle sans s’entendre, et se voit même comme forcée, d’employer des expressions dont elle ne comprend pas le sens, quoique toujours les meilleures. Je demande encore si l’exaltation a jamais produit un pareil effet.
3° Elle nous déclare que plusieurs fois elle a essayé si par elle-même elle n’eût pas pu se procurer de pareilles affections, en tâchant de monter son cœur ou son imagination, sans que ses efforts aient abouti qu’à lui prouver son impuissance.
4° Dieu lui a fait perdre tout à coup la mémoire des choses qu’elle devait oublier, tandis que les choses oubliées depuis longtemps lui sont revenue par ordre au moment de les faire écrire, comme on verra.
Qu’on joigne à tout cela la manière admirable dont elle parle de l’opération de Dieu sur les facultés de l’âme humaine, comme de la manière de la discerner des vains efforts par où le démon s’efforce quelquefois de la contrefaire, et qu’on nous dise en quoi tout cela peut différer d’une inspiration proprement dite, et sur quoi pourraient se fonder ceux qui s’obstineraient encore à ne voir en tout cela que l’effet d’une imagination exaltée ou d’un cœur saintement dupe de sa piété? Il est bon, il est louable, il est nécessaire même d’être en garde contre l’illusion; mais il ne faut pas, sous ce prétexte, donner dans un pyrrhonisme déraisonnable, qui repousse la vérité quand elle se présente et se fait sentir: pyrrhonisme souvent ridicule, dont les subtilités, pour ne pas dire les chicanes, ne satisferont personne, et sont très propres à indisposer l’esprit juste et droit qui n’y voit guères qu’un certain fond de mauvaise foi, toujours hideuse aux yeux de l’équité.
Il faut donc également peser le pour et le contre; et n’allez pas, par la crainte d’être trop crédule sur un point, donner dans l’excès opposé, en embrassant une supposition plus invraisemblable de beaucoup, dont il serait impossible de se tirer, et qui demanderait encore plus de crédulité que le parti contraire.
Aussi, le très grand nombre des examinateurs ont été tellement frappés de toutes ces considérations, qu’ils ont pensé, comme moi, que l’ouvrage, pris dans son ensemble, présentait une preuve de l’assistance divine, infiniment plus forte que ne le seraient toutes les attestations et les authenticités qu’on pourrait lui donner; car quel poids l’autorité des hommes peut-elle ajouter à celle de Dieu, quand elle se manifeste? Ils ont donc cru, comme moi, 1° qu’on ne pouvait sérieusement comparer la manière frappante et circonstanciée avec laquelle la Sœur avait annoncé notre révolution et ses suites, plus de
__________________________
(365-369)
vingt ans avant qu’il y en eût aucune apparence, avec les conjectures générales et toujours hasardées, que la politique humaine en avait pu faire sur quelques indices tirés ou du déficit des finances, ou du progrès de l’irréligion et de l’immoralité. 2° Ils ont cru, comme moi, qu’on ne pouvait sérieusement supposer qu’une ignorante parlant d’elle-même, ou d’après quelques citations sans suite, des saintes Écritures, qu’elle aurait entendues et méditées à loisir, eût pu donner, sans le secours d’en haut, une suite d’applications aussi justes et aussi heureuses des textes qu’elle n’a pas même lus, et cela sans tomber dans aucun écart, dont les plus habiles commentateurs ne sont pas toujours exempts, et que ce serait trop accorder à une fille, quelque savante d’ailleurs qu’on pût la supposer. Son ouvrage, ont-ils dit, serait le plus étonnant qui eût encore paru dans ce genre.
3° Enfin ils ont cru comme moi qu’avoir prédit et annoncé tant de choses, et aussi longtemps avant l’événement, était un titre suffisant pour être crue sur les événements qu’elle annonce encore par la même connaissance, n’étant pas plus difficile d’y avoir vu l’avenir dans le présent, que d’y avoir vu le présent dans le passé… Or, jugeant d’ailleurs de l’ouvrage par son ensemble, non pas par quelques détails isolés, ils ont pensé, comme moi, que la manière unique et lumineuse dont tant de matières différentes, et toutes aussi épineuses que sublimes, étaient traitées par cette ignorante, pouvait bien former un motif suffisant de croire à son inspiration, indépendamment de toute autre considération; et plusieurs d’eux n’ont pas craint d’avancer qu’on ne pouvait sans témérité s’opiniâtrer à la rejeter. En un mot, ils ont vu dans le recueil, ou l’œuvre de Dieu, ou une énigme.
Et en effet, si les révélations de sainte Brigitte ont été regardées comme véritables par plusieurs grands papes (1) et tout un concile, pour avoir annoncé avant l’événement la punition des Grecs par les Turcs, ne peut-on pas bien regarder comme vraie l’annonce vérifiée d’un autre événement du même genre et de la même importance? Et si on a cru devoir recourir à l’assistance divine pour rendre raison des ouvrages des Madeleine de Pazzi, des Catherine de Sienne, des Thérèse, des Gertrude, etc., malgré l’éducation soignée qu’elles avaient reçue pour la plupart, comment supposer qu’une pauvre ignorante ait pu produire quelque chose de plus admirable encore, sans le secours d’en-haut ?… Énigme inexplicable, et ils se sont, comme moi, accordés à le regarder comme une nouvelle Apocalypse, et l’auteur comme une personne extraordinairement suscitée de Dieu pour annoncer aux hommes le sort de l’Église jusqu’aux derniers temps de sa durée, et les précautionner contre les erreurs et les scandales de ces derniers temps. C’est aussi à peu près le titre que je lui avais donné en premier lieu.
(1) Grégoire XI, Urbain VI, le concile de Constance, et plusieurs autres papes, cardinaux et évêques.
Je dirai plus encore, et cela est allé au point que celui d’entre eux qui y avait paru constamment le moins favorable, et qui avant tout, avait commencé par y témoigner plus d’opposition, n’a pu s’empêcher d’y reconnaître un concours spécial, une grâce toute particulière, par où il supposait que Dieu aurait élevé l’entendement et toutes les facultés intellectuelles de cette bonne fille jusqu’à un degré supérieur à la portée et aux forces de l’esprit humain; et cela pour ne pas avouer l’inspiration proprement dite. Mais ne pourrait-on point demander si ce ne serait pas avouer à peu près la même chose en termes un peu différents? Plusieurs, du moins, l’ont cru et dit sans façon; et je pense, comme eux, que, dans cette supposition, la distinction entre la Sœur et les hommes vraiment inspirés serait un peu métaphysique. On sent assez, d’ailleurs, que ce ne serait que reculer la difficulté et non pas la résoudre, que d’attribuer à toute autre qu’à cette sainte fille l’ouvrage dont il s’agit. Car enfin, tout autre, son directeur, par exemple, n’aura pas plus qu’elle en sa disposition ce concours spécial, cette grâce particulière de Dieu, qu’on est forcé d’y reconnaître. Ah! quand il eût pu réussir à ce point par lui-même, serait-ce bien une raison pour le supposer? Je conçois qu’on peut aimer et pratiquer la vertu pour elle-même; mais le crime, c’est autre chose, et je ne pense pas que cela se soit encore jamais vu. Or, j’ignore absolument quelle espèce d’intérêt ce directeur aurait pu trouver dans la fabrique d’une fourberie digne de l’animadversion de toutes les lois, et dont il peut assurer que, grâces à Dieu, il ne se sent pas capable. Il s’agirait donc uniquement de voir lequel, de la Sœur ou de moi, on aimerait mieux supposer avoir été inspiré; qu’on choisisse.
Ainsi s’est déjà vérifiée à la lettre, et dans le lieu de mon exil, cette annonce de la Sœur, que son ouvrage devait occasionner des combats d’opinions entre les savants. Mais tout ce que l’on peut conclure de cette opposition de sentiments sur le seul point de l’inspiration,
__________________________
(370-374)
c’est, à mon avis, cette vérité fondamentale, que Dieu a suffisamment suppléé d’un côté à ce qui manque de l’autre : je veux dire qu’il a fortement appuyé par des raisons intrinsèques et tirées du fond des choses, un ouvrage qu’il prévoyait devoir manquer de toute espèce d’autorisation. Loin de me plaindre de qui que ce soit, loin de trouver à redire à cette conduite de la divine Providence, je la trouve au contraire très digne de celui dont les ouvrages se soutiennent toujours par eux-mêmes, sans avoir besoin ni des recommandations, ni d’aucuns des moyens humains.
Au reste, qu’on me permette de le répéter en finissant : Je ne saurais goûter l’avis de celui des examinateurs qui me dit que toutes les fois que Dieu ne poussait pas l’évidence des preuves jusqu’au point où elle peut aller, c’est qu’il ne voulait pas que nous crussions (1). La généralité de cette proposition me l’a rendue suspecte, et même dangereuse, sous bien des rapports qu’il n’est pas besoin de détailler ici; car combien de choses que nous devons croire et dont pourtant l’évidence n’est pas poussée aussi loin qu’on pourrait aller!
(1) Et encore, qu’il faut des preuves plus fortes pour un fait miraculeux que pour un autre fait; qu’il est impossible de le prouver, parce qu’il faudrait une preuve de même nature, etc., etc. Les suites de toutes ces assertions sont horribles.
J’ai toujours, cru qu’en fait de motifs de crédibilité, du moins en genre de foi particulière, il pouvait y avoir du plus ou du moins, et que le degré d’évidence et de certitude qui suffit à la sagesse divine devait suffire à la sagesse humaine. La raison est toujours ingrate et insolente quand elle ose demander à son auteur plus qu’il ne veut lui accorder. C’est ce que j’ai déjà prouvé, pour peu qu’il paroisse bien certainement un effet qu’on ne puisse attribuer à aucune autre cause qu’à Dieu, sans tomber dans un labyrinthe d’inconvénients dont on ne peut se tirer. Tout est prouvé par là. Dieu peut avoir ses raisons de n’aller pas plus loin, c’est à nous de nous y tenir. Il montre alors un de ses doigts à l’œil intelligent et docile; ce qui est assez pour y reconnaître la main toute entière, et pour y respecter le cachet de son autorité: Digitus Dei est hic. Un seul rayon échappé du nuage suffît pour indiquer le soleil, sans qu’il soit nécessaire qu’il paraisse dans tout son éclat et dans toute sa splendeur.
Mais avec tout cela, dira-t-on encore, les impies n’en croiront jamais rien. Les impies ! Bon Dieu ! quels gens me nommez-vous là?…. Mais sont-ils faits pour croire quelque chose en ce genre, et un pareil ouvrage est-il fait pour eux?… Croient-ils seulement qu’il y ait un Dieu, les impies ? Faudra-t-il que Dieu ne fasse plus de miracles, parce qu’il ne plaît pas aux impies d’y croire ni de les recevoir ?…. et attendrons nous, pour nous déterminer, à voir les révélations d’une pauvre fille ignorante et, qui pis est, religieuse, suivies et accréditées parmi des hommes qui n’ont encore jamais pu croire aux miracles ni à la résurrection de J.-C.?
Non, vous ne vous y attendrez pas, lecteur judicieux et chrétien; je vous ferais injure de le penser. Tout m’est un sûr garant que vous laisserez l’impie prendre son parti, et que vous prendrez le vôtre. Joignant la prudence à la simplicité, suivant le conseil de l’Évangile, vous accorderez à la lecture de ces récits le degré de croyance proportionné à l’impression que vous en aurez reçue, et toujours subordonné à l’autorité vivante qui a seule le droit de régler votre foi. Voilà la marche que vous tiendrez, sans vouloir prévenir ni commander le jugement d’autrui.
Vous craignez de donner dans l’erreur : vous avez raison. C’est aussi parce que je le crains pour vous et pour moi, qu’en attendant la décision du tribunal infaillible, je voudrais pouvoir répondre par avance à tous les faux raisonnements par où on a toujours combattu l’œuvre de Dieu, et par où je prévois qu’on doit encore attaquer celui-ci. C’est parce que je cherche votre plus grand intérêt que je vous adresse, en finissant, cet avis important de l’Esprit Saint : Heureux celui qui lit et qui entend les paroles de cette prophétie, et qui observe fidèlement ce qui y est écrit, parce que le temps est court, et que nous touchons à l’accomplissement. Beatus qui legit et audit verba prophetiœ hujus, et servat ea quœ in ea scripta sunt; tempus enim propè est. (Apoc, 1, 3. )
Pour tout résumé :
J’ai entendu la personne extraordinaire dont j’ai lieu de croire que Dieu se sert pour vous instruire, et dont je vous offre les confidences et les récits : j’ai cru la comprendre assez pour ne point m’en écarter. Elle m’a déclaré que Dieu me chargeait de cette tâche; j’y ai travaillé de mon mieux, et comme devant en rendre compte. Enfin, j’ai consulté les pasteurs de l’Église suivant que j’étais chargé de le faire; et pour ne manquer à rien à votre égard, je viens de vous exposer les suffrages que j’ai fidèlement recueillis. C’est à vous maintenant
__________________________
(375-379)
de voir et d’examiner quel jugement vous devez en porter, et quelle conduite vous devez tenir: car cette conduite de Dieu n’est pas sans dessein, et très vraisemblablement les suites en seront plus importantes pour vous qu’on ne saurait se l’imaginer.
FIN.
________________________________________
LES HUIT DERNIÈRES ANNÉES
DE LA SŒUR DE LA NATIVITÉ.
Religieuse Urbaniste de Fougères,
Pour servir de Supplément à ses Vit et Révélations.
(Par le même rédacteur, 18o3.)
« Deus docuisti me à juventute mea, et nunc pronunciabo mirabilia tua. » (Ps. 70. 18. )
QUALIS VITA, TALIS MORS.
——————————–
INTRODUCTION.
On a vu dans les notes additionnelles par lesquelles j’ai terminé le recueil des Vie et Révélations de la Sœur dite de la Nativité, que la mort de cette sainte fille, dont j’avais écrit la vie jusqu’à mon départ, m’avait été annoncée à Londres vers la fin de 1800, ou au commencement de 1801, par une lettre qu’une personne de Saint-James, en Normandie, en écrivit au curé de la même ville, résidant alors à Chelsé, près la capitale d’Angleterre.
Il y avait alors plusieurs années que je ne recevais plus aucune nouvelle des religieuses de la communauté de Fougères, dont j’avais été chargé. Ce silence inquiétant, après tant de lettres de ma part, me faisait craindre surtout que les deux qui étaient entrées dans le secret de la Sœur n’eussent été ajoutées au nombre de celles dont j’avais appris la mort depuis mon départ et que, par-là, je n’eusse été, pour toujours, privé du témoignage des deux personnes qui seules pouvaient bien attester au public et la vérité des faits que j’avais avancés dans le recueil, et tout ce qui, de leur consentement et à leurs prières, s’était passé entre la Sœur et moi.
Ma crainte était d’autant mieux fondée, que la santé de ces deux religieuses m’avait toujours paru très faible avant même qu’elles eussent eu à dévorer des contretemps et des chagrins qui ne pouvaient que l’affaiblir encore, et vraisemblablement la détruire tout à fait. Dans cette position il ne me restait, en priant pour elles, qu’à attendre en paix que Dieu lui-même eût suppléé de quelque manière à ce moyen le plus naturel d’authentiquer une cause que j’avais toujours crue la sienne, et surtout depuis que des suffrages si avantageux et en si grand nombre m’avaient si fortement confirmé dans ma première opinion.
Enfin, vers la fin de février 1802, je reçus de madame la Supérieure la lettre suivante, qui me fit comprendre que Dieu, dont la providence veille sans cesse à tous les événements et aux moindres détails de son œuvre, avait sans doute eu ses raisons de me conserver les religieuses les plus instruites de toute l’affaire, et surtout les deux témoins que les lecteurs de l’ouvrage avaient jugés les plus essentiels. Voici le précis de cette lettre, qui fut lue, et même copiée par un bon nombre entre les admirateurs du recueil:
Fougères, 29 janvier 1802.
« Monsieur,
Je viens enfin de recevoir de vos nouvelles positives par un de vos confrères qui arrive du pays que vous habitez, et qui s’est chargé de vous faire passer des nôtres comme vous le désirez. Je saisis avec empressement cette occasion de vous écrire par main sûre, et j’en aurais cherché plus tôt, si je n’avais craint de vous annoncer la mort d’une personne à laquelle je sais que vous vous intéressez d’une manière toute particulière; je veux parler de la pauvre Sœur de la Nativité.
» Cette sainte fille est décédée le propre jour de l’Assomption 1798, à midi. Elle eut sa connaissance jusqu’au dernier moment, et bien des choses me font croire qu’elle eut révélation du jour et de l’heure de sa mort. Les dernières semaines de sa vie Dieu lui ordonna de dire, de sa
__________________________
(380-384)
part, à plusieurs personnes, des choses particulières touchant leurs consciences, et ces personnes en ont bien profité. Elle m’en a dit aussi à moi-même, avec une connaissance la plus intime et qui ne pouvait venir que de Dieu. Vous ne sauriez imaginer l’impression qu’elle me fit. Elle me prédit en particulier plusieurs choses dont une partie s’est déjà accomplie à la lettre et me fait espérer le reste dans son temps. Je puis vous assurer que ce qu’elle m’a dit m’a donné une grande satisfaction et paix dans l’âme.
» Avant de rester malade elle avait beaucoup fait écrire. Les derniers jours de sa maladie elle demanda avec empressement tous ses papiers qu’elle avait mis aux mains d’un ecclésiastique que Dieu lui avait indiqué pour la conduire dans ses voies extraordinaires. Ce monsieur avait promis de vous les faire passer, et faute d’occasion sûre, il les avait toujours gardés. Elle les envoya, en dernier lieu, par une séculière à son confesseur. Je ne sais lequel les a fait courir sans être travaillés et mis en meilleur ordre. Ce qu’il y a » de sûr, c’est qu’ils ont été lus tels qu’ils sont par un grand nombre de personnes, et même de différentes provinces. Par-là ces derniers écrits se sont répandus très loin, aussi bien que le bruit de sa sainteté.
» Aussi m’a-t-on beaucoup demandé quelque chose des petits effets qui lui ont appartenu. Pensant que vous seriez aussi bien aise d’en avoir, je vous ai gardé son alliance avec laquelle elle est morte. Je ne vous l’envoie point, de peur qu’elle ne se perde; mais sitôt que j’aurai l’honneur et le plaisir de vous revoir, je vous la remettrai, avec quelques autres choses de ce genre qui pourraient vous faire plaisir (1).
(1) Madame la Supérieure y a ajouté son voile de communion, avec un peu de ses cheveux, etc. J’ai reçu aussi d’ailleurs un petit livre de piété dont elle se servait pour instruire ses neveux pendant le séjour qu’elle a fait chez son frère, comme nous le dirons : c’est un petit volume assez vieux, contenant les épîtres et évangiles de l’année, en français, avec des prières. Je garderai le tout précieusement.
» Je vous prie aussi de me procurer son ouvrage et le vôtre, s’il est possible ; nos sœurs espèrent aussi la même faveur. S’il est imprimé, et que l’Église permette de le lire, vous ferez bien d’en apporter beaucoup d’exemplaires en repassant ici; il y aura sûrement bien du crédit. Revenez le plus tôt possible, nous le désirons tous….
» P. S. J’oubliais de vous marquer que la Sœur me dit bien des fois, dans ses derniers moments, qu’elle mourait avec la peine de ne pouvoir dire à personne des choses bien consolantes pour l’Église.
» J’ai l’honneur d’être, etc. »
Cette lettre, qui paraissait venir à l’appui de celle de Normandie, ne pouvait arriver plus à propos pour défendre le recueil et me soutenir moi-même contre une espèce de cabale qui commençait à éclater dans le lieu de mon exil. Parmi le grand nombre des admirateurs des cahiers, il se trouva à Londres, quelques personnes qui ne prirent pas la chose du même côté. Après des objections générales qui apparemment n’eurent pas tout le succès qu’on s’en était promis, on tâcha de faire naître des doutes sur la sincérité de mes rapports; on alla jusqu’à dire que la sœur de la Nativité n’était qu’un personnage supposé, à qui je faisais dire tout ce qu’il me plaisait; que, pour amuser le loisir de ma retraite, j’avais composé un roman spirituel en me servant du nom d’une religieuse qui peut-être n’avait jamais existé.
La supposition était aussi maladroite que l’eût été le piège que j’aurais tendu à la crédulité du public; et comme il n’eût fallu qu’un petit voyage en France pour découvrir la fraude du piège, on eût dû penser aussi que le même voyage, avec une vérification locale, pouvait suffire pour justifier ma conduite et me venger pleinement de l’accusation. Aussi cette accusation parut trop révoltante pour mériter aucun crédit auprès des personnes sensées et honnêtes; mais aussi je dois avouer qu’il s’éleva alors un adversaire de l’ouvrage qui, sans mauvais dessein et croyant bien faire (1), parut mettre à sa propagation un obstacle tout autrement sérieux, et que je ne dois pas passer sous silence, pour les raisons qu’on verra.
(1) Croyant bien faire. Il faut que la vérité soit combattue, parce qu’elle doit être éprouvée. Des ouvrages de ce genre ne peuvent être reçus sans examen, et j’avoue que les supérieurs, surtout ne sauraient trop y faire attention.
M. L’abbé de Fajole, vicaire général du diocèse de Rennes, avait été un des premiers à lire mes cahiers. J’avais eu l’honneur de les lui présenter (c’était alors ma première rédaction) dans l’île de Jersey, en 1792 ; à quelques remarques près, il avait trouvé tout admirable; il m’avait même exhorté à les conserver pour la suite des temps; mais il a paru depuis qu’il avait totalement changé d’avis sur cet article, sans qu’on puisse bien deviner pourquoi.
Vers la fin de 1799, M. l’Abbé partit
__________________________
(385-389)
de Scarborow, où il avait été transporté, pour se rendre à Londres; à son arrivée dans cette capitale, je crus l’obliger en lui offrant le recueil manuscrit des suffrages des prélats et autres théologiens que j’avais consultés sur le lieu, pendant le séjour que j’y avais fait. Je ne m’attendais guère à ce qui arriva, et jamais peut-être surprise ne fut plus grande que celle où je me trouvai, lorsque j’entendis M. l’abbé de Fajole me déclarer que, d’après ses réflexions, ses recherches et les avis qu’il avait reçus, etc., il avait absolument changé d’opinion sur le point en question ; que j’avais eu grand tort de montrer à personne des cahiers qu’il m’avait ordonné de tenir cachés; que jamais ils ne seraient agréés de l’évêque de Rennes, tandis qu’il en serait vicaire-général ; enfin, qu’il fallait les jeter au feu, ce qu’il me répéta et me fit conseiller par un prêtre de mes amis que j’avais consulté.
Je me contentai de répondre à l’un et à l’autre que je me donnerais bien de garde d’obéir à un ordre qui ne me paraissait fondé sur aucun motif capable de m’y déterminer; que je respectais trop les lumières et l’autorité de ceux qui en avaient jugé autrement, et qui méritaient bien aussi d’être écoutés; que M. de Fajole n’avait jamais eu le droit de me défendre de communiquer un ouvrage dont les évêques seuls sont les juges nés, et que je m’étais chargé de leur montrer ; je n’avais donc pu donner la promesse qu’on supposait que j’avais donnée, sans me rendre infidèle à ma parole et trahir la cause et le dépôt qu’on m’avait confiés. Telles furent dès lors mes résolutions et mes réponses, qui furent considérablement fortifiées par les avis des docteurs consultés qui avaient lu la production de la Sœur.
Il faut l’avouer cependant, je reçus beaucoup de peine et de chagrin de ce contre-temps auquel je ne m’étais point attendu, et ce fut sans doute pour me fortifier encore et me tirer d’embarras, que la divine Providence permit que je reçus, précisément à cette époque, les lettres dont j’ai rendu compte, et qui m’apprenaient ce que je devais penser des préjugés défavorables ou des fausses nouvelles sur lesquelles on s’était sans doute appuyé.
J’admirais en moi-même la conduite de cette Providence vraiment admirable à l’égard de ceux qui s’abandonnent à ses soins. Quel serait donc le sort de la pauvre sœur de la Nativité, me disais-je ? Faudrait-il donc qu’elle fût toujours brûlée par l’avis d’un seul homme contre tous? Celui qui le premier avait réduit en cendre sa production, se repentit vivement de sa précipitation et de l’avis de son confrère; pourrais-je bien, moi, sur l’avis d’un seul homme, m’exposer encore à la même peine, après l’accomplissement, trop visible, de tout ce qu’elle avait annoncé? Il n’en sera rien, je l’espère, ou du moins l’Église seule en décidera, car c’est à elle seule que j’en appelle. Ainsi je raisonnais en moi-même, et je me sentais toujours plus fortifié par la lecture de ces mêmes cahiers dont on exigeait le sacrifice. Il me suffisait d’y jeter les yeux un moment, pour sentir quelque chose qui me disait intérieurement : Prends-y bien garde, ceci n’est pas fait pour être brûlé… Je pris donc le parti bien ferme et bien décidé d’attendre tout le succès de cette entreprise de celui seul qui m’en a toujours paru l’auteur.
Croira-t-on bien maintenant que la sœur de la Nativité avait eu une connaissance anticipée de tout ce que nous venons de dire, et qu’elle l’avait annoncé près de trois ans avant l’événement, jusqu’à nommer, en toutes lettres, le principal acteur, qu’elle n’avait pourtant jamais ni vu ni connu? Elle avait fait écrire par deux religieuses, en 1797, l’avertissement qu’elle en avait reçu. Cet écrit fut adressé à M. Leroi, doyen de la Pellerine, diocèse du Maine, alors son directeur, qui me l’a remis en 1802, et qui a été aussi surpris que moi-même quand il a entendu de ma bouche le récit qui lui en donnait l’explication. Nous parlerons, dans la suite, de cet écrit, qui achève de me persuader que j’avais raison de tenir ferme contre un ordre qui m’aurait occasionné bien des repentirs, si j’avais eu la simplicité de m’y conformer.
Voilà assurément un coup de la façon de cette fille extraordinaire, ou plutôt de celui qui s’est servi d’elle pour notre avantage. C’est ainsi, quand il veut, qu’il déjoue tout ce qui s’oppose à ses desseins et à son œuvre, en communiquant à ceux qu’il fait parler des lumières auxquelles la politique humaine ne peut atteindre, auxquelles même elle ne peut rien répliquer. Qu’une pauvre fille, absolument étrangère à tout ce qui se passe dans le monde, une pauvre ignorante qui ne pense plus qu’à se préparer à la mort, sache pourtant ce qui se passe, ou plutôt doit se passer de relatif à son ouvrage, au-delà des mers et dans un royaume éloigné où elle n’a aucune relation; qu’elle soit avertie du jugement qu’en portera un homme qu’elle nomme sans le connaître, et qui se trouve à Londres ou à Scarborow; qu’elle l’annonce des années avant, sans crainte d’en être démentie, et que
__________________________
(390-394)
l’événement réponde à l’avertissement qu’elle en reçoit, lecteur, qu’en pensez-vous? Comment l’incrédulité s’en tirera-t-elle? et aurons-nous tort de regarder cette circonstance comme une nouvelle preuve qui achève de démontrer la vérité de son inspiration ?….
Arrivé à Fougères vers le commencement d’août 1802, je commençai par lire et faire lire l’ouvrage en question à tout ce qui restait de religieuses Urbanistes, et après cette lecture elles me donnèrent, sur tous les faits y mentionnés l’attestation qu’on y a lue. Elles me remirent ensuite deux gros cahiers de supplément qui nous restent encore à rédiger, et que la Sœur avait fait écrire pour m’être remis à mon retour.
Avant d’en venir là, il m’a paru à propos de présenter les dernières années de l’auteur, pour la satisfaction de tous ceux qui s’y intéressent, et plus encore pour l’édification du public. Je le ferai le plus brièvement possible, parlant toujours d’après le témoignage bien notifié des personnes qui ont vécu ou eu quelque relation particulière avec elle, des religieuses qui l’ont assistée dans ses derniers moments, et de la respectable famille au sein de laquelle elle a fini sa carrière. Il n’est pas besoin d’avertir que je n’en écris sous leurs yeux qu’après avoir été sur les lieux et avoir exactement recueilli et confronté leurs voix sur chaque objet. Cela posé, voici le plan que je me trace pour marcher avec plus d’ordre.
PLAN.
Les religieuses urbanistes demeurèrent environ deux ans dans leur communauté, après que j’en eus été chassé. Après leur sortie, la Sœur de la Nativité resta un peu plus d’un an dans la ville de Fougères; de là elle fut transportée chez son frère, à la Chapelle-Janson, où elle demeura un peu moins de deux ans; enfin elle fut ramenée à Fougères, où elle vécut encore trois ans et quelques mois. C’est dans ces quatre circonstances que nous allons maintenant la suivre et la considérer, pour présenter le résultat des huit dernières années de sa vie, qui se sont écoulées depuis l’époque de mon départ jusqu’au jour de la mi-août 1798, époque de sa mort. Le tableau fidèle qui résultera de ce plan tout naturel, n’offrira presque rien d’intéressant à ceux qui ne jugent des personnes que par les événements ; mais il intéressera à coup sûr tous ceux qui jugent des événements par les personnes qui en sont le sujet.
PREMIÈRE ÉPOQUE.
La Sœur encore dans la communauté.
Ce fut, comme je l’ai dit ailleurs, entre l’Ascension et la Pentecôte 1790, que j’avais été obligé de fuir mes religieuses en sortant de leur maison, et ce fut le 27 septembre 1792 qu’elles en furent elles-mêmes chassées, pour être décostumées l’année d’après. Pendant les deux ans que la Sœur passa encore dans sa communauté, elle ne parut en rien différente d’elle-même, si ce n’est peut-être par un redoublement de l’esprit intérieur, du recueillement, du silence et de la soumission, qui fait l’âme de l’état religieux, et qui faisait comme le fond de son caractère particulier.
Après les faveurs dont le ciel l’avait comblée, après surtout la connaissance qu’il lui avait donnée des choses qu’il cachait au reste des mortels, on peut bien avancer que personne n’eut moins lieu qu’elle d’être surpris des événements qui se passait alors, comme de ceux qu’elle prévoyait encore, qu’elle annonçait sans cesse, et qu’elle avait annoncés depuis si longtemps: aussi n’en parut-elle ni surprise ni ébranlée. Bien différentes de ces âmes aussi faciles à scandaliser qu’elles sont faibles dans la foi, ou plutôt qui ne sont prêtes à murmurer de tout ce qui les contrarie, que parce qu’elles ne voient jamais l’ensemble des choses et n’entrent jamais dans les grands desseins d’une Providence qu’elles devraient adorer. La Sœur de la Nativité était bien au-dessus de ces petites vues humaines qui se bornent à l’égoïsme et rapportent tout à l’intérêt personnel.
Celui qui règle le monde et tient en main la chaîne des grands événements qui en composent l’histoire, lui avait montré, dès l’enfance, la révolution française dans ses causes les plus secrètes, dans ses effets les plus terribles, et dans ses suites les plus éloignées. C’était de ce point de vue, qu’embrassait sa grande âme, que la Sœur envisageait tout ce qui se passait et se préparait encore autour d’elle. Aussi peut-être n’a-t-on jamais vu une âme plus humble, plus pénitente, plus soumise, ni plus résignée à tout ce qu’il plaisait à Dieu d’ordonner ou de permettre. Elle n’en parlait jamais qu’avec cette crainte vraiment religieuse, qui rapportant tout à une cause surnaturelle, redoute jusqu’à l’ombre du murmure ou de l’insubordination. Disons mieux, elle en parlait beaucoup à Dieu, presque jamais aux hommes; ou si quelquefois elle s’y voyait forcée, elle le faisait toujours avec le plus grand respect, la plus grande circonspection. Frappée plus qu’aucun autre de cette
__________________________
(395-399)
idée si vraie, que nos maux ne sont presque jamais que la suite et la punition de nos crimes, elle ne voyait ceux qu’elle pleurait sans interruption, que comme les coups salutaires d’un Dieu qui recherchait en trente millions de coupables l’oubli et le mépris de ses saintes lois. Dans cette persuasion, elle ne se regardait elle-même que comme une victime dévouée à la colère céleste, dont elle eût voulu seule épuiser tous les traits pour en exempter ses frères.
Les âmes vulgaires et sans vertus n’attendent de ressources, quand le malheur les poursuit, que d’une mort qu’ils en regardent comme le terme; et la fausse et trompeuse philosophie se fait encore honneur de ce mépris brutal et insensé d’une vie qu’elle n’a plus le courage de supporter. II n’en est pas ainsi des vrais serviteurs de Dieu; pleins des leçons sublimes qu’ils ont puisées à l’école de leur divin maître, ils s’élèvent, par la foi, jusqu’à l’amour des souffrances que la nature abhorre, et ce n’est que par les motifs les plus purs qu’ils savent mépriser la mort.
Telle parut la Sœur de la Nativité dans tout le cours de sa vie, et cette disposition sublime où elle avait toujours vécu, on peut, on doit même croire qu’elle ne fit que s’accroître et s’épurer aux approches de sa fin. Loin de se plaindre de ce que le ciel lui faisait souffrir, elle lui demandait toujours de nouvelles souffrances, comme des grâces plus signalées que toutes les faveurs qu’elle en avait reçues. Comme cette autre héroïne chrétienne qui mérite bien de lui être comparée, puisqu’elle fut aussi le prodige de son siècle, notre sainte contemporaine demandait à son divin époux beaucoup moins de mourir pour finir ses maux, que de vivre encore pour souffrir toujours davantage ; beaucoup moins de quitter la terre pour se réunir à lui, que d’y rester encore pour mériter toujours plus un tel bonheur : Non mori, sed pati.
Qu’on ne prenne point ceci comme la pieuse exagération d’un écrivain panégyriste; ici ses propres ouvrages font foi et méritent d’en être crus. Tant de fois cette humble pénitente, cette digne fille de saint François, avait demandé des souffrances à son Dieu, qu’on ne peut douter que toutes celles qui ont rempli et terminé sa vie, n’aient été l’effet de sa prière et de ses désirs ardents. Ce n’est que dans le creuset de la tribulation que s’épure et se perfectionne la vertu du juste; c’est là que son cœur prend cette forme heureuse qui le rend si agréable aux yeux de son Dieu. Le disciple de J.-C. doit ressembler en tout à son maître; sa prédestination est toute fondée sur cette ressemblance; et comme il n’a de droit au ciel que par la croix de son Rédempteur, c’est aussi sur la croix que doit se consommer le grand œuvre de sa rédemption.
Vérité fondamentale du christianisme que la Sœur avait parfaitement comprise. C’est tout ce qu’elle ambitionnait, à quoi elle s’attendait, ce qu’elle demandait avec instance, et ce qu’elle a éprouvé jusqu’à la fin d’une vie qui ne fut qu’une suite de souffrances et de croix; au point que tout ce qu’on va voir n’est que la perfection de ce grand œuvre, et ne fait qu’enchérir sur tout ce qu’on a vu. Une réflexion qu’on ne doit pas oublier ici, c’est que le Dieu qui lui avait accordé tant de souffrances, et qui, surtout vers la fin de sa vie, l’exposait à tant de privations, tant de contradictions et tant d’épreuves, l’avait aussi toujours consolée et soutenue par des faveurs si extraordinaires, et surtout lui avait ménagé pour la fin des consolations si surprenantes et si inattendues, qu’elle en était elle-même dans l’admiration et pénétrée de la plus vive reconnaissance, comme elle l’a avoué plus d’une fois, au rapport de sa Supérieure et des autres religieuses qui vivaient avec elle. Je cite ici les propres termes des lettres qu’on m’en a écrites à différents temps. Malgré les obstacles que des scènes toujours plus orageuses semblaient mettre à l’exécution de son projet, la Sœur ne le perdit jamais de vue. Mieux persuadée que personne, que Dieu, quand il le veut, sait tirer parti de tout pour venir à ses fins; appuyée sur les soins d’une Providence qui veille aux moindres détails de son œuvre, elle ne fut point, ou faiblement, troublée par des contre-temps qui auraient déconcerté tout autre qu’elle.
Non seulement le ciel lui avait fait connaître en gros et en détail les grands événements qu’elle annonçait depuis si longtemps, et que la politique humaine ne pouvait prévoir, il lui avait encore découvert en particulier les différents moyens dont le démon devait faire usage pour tâcher de faire tout échouer, en se servant tantôt de la ruse, et tantôt de la force ouverte; quelquefois de la précipitation, bien ou mal intentionnée, de certaines gens, et sans doute aussi de l’imprudence et de l’inhabileté du rédacteur lui-même; mais aussi il lui avait laissé apercevoir, de sa part, une volonté supérieure à tout, qui peut tirer parti de tout; qui, par des contre-marches que son ennemi ignore, sait déjouer ses pièges les plus adroitement tendus, et prendre le démon lui-même dans ses propres filets.
C’était d’après ces lumières intérieures
__________________________
(400-404)
qu’elle travaillait sans cesse à la réussite d’une entreprise dont rien ne pouvait plus la détourner depuis l’époque où elle crut être bien sûre de la volonté de Dieu. Elle avait profité de tous mes moments libres, tandis que je fus auprès d’elle, pour me bien faire entrer dans ses vues, en m’exposant son plan et ses moyens pour l’exécuter. À peine eut-elle appris que j’étais en sûreté avec ses notes, et que je m’en occupais au-delà des mers, comme elle me l’avait prédit d’abord, qu’elle profita de tous les moments qu’elle passa encore dans la communauté, et de la bonne volonté des deux religieuses qu’elle avait mises dans son secret, pour me faire passer successivement les écrits dont la rédaction fournit toute la seconde partie de son ouvrage, comme on le sait. Tous ces cahiers me furent remis chacun dans son temps, à l’exception d’un seul qui manque au recueil, sans qu’on puisse savoir ce qu’il est devenu.
Ce cahier perdu, dont je ne puis faire usage, contenait, entre autres choses, un trait assez frappant, et que je crois devoir rappeler, à cause de la connaissance particulière qu’en ont les religieuses, et le souvenir plus marqué de celle qui l’avait écrit.
La Sœur y racontait qu’à une certaine époque de sa vie, Dieu lui avait fait voir le diocèse de Rennes, avec son clergé, sous la forme d’un beau verger planté d’arbres fertiles de différentes tailles et grandeurs. Elle y remarqua, entre autres, deux vieux arbres, très voisins l’un de l’autre, qui lui paraissaient courbés sous le poids de leurs fruits autant que sous celui des années. Elle les admirait tous les deux, lorsqu’un même coup de vent les déracina tout à coup sous ses yeux, et les renversa par terre, à son grand déplaisir.
Vraisemblablement elle ignorait alors le sens de cette vision; mais bientôt après, un événement frappant vint lui en donner l’explication; ce fut la mort de deux anciens prêtres du même diocèse de Rennes, dont l’un avait été longtemps directeur des Urbanistes de Fougères. Ils avaient toujours été très amis, et presque toujours unis par les travaux de leur ministère. C’étaient MM. Duclos et Pothin. Ils moururent, comme subitement, le même jour; le premier était recteur de la paroisse de Parigné, à deux lieux de Fougères; le second, ancien directeur des dames Hospitalières, ex-recteur de la chapelle Saint-Aubert, qui n’en est guère plus éloignée. La Sœur elle-même vit dans cet événement l’accomplissement de la vision rapportée, et dont elle avait plus d’une fois parlé à ses Sœurs. Je passe sous silence tout ce qui ne me paraît appuyé que sur des réminiscences trop faibles pour mériter du crédit.
SECONDE ÉPOQUE.
La Sœur hors de la Communauté.
Ainsi s’étaient passées les deux premières années depuis ma sortie, qui furent les deux avant celle de la Sœur. La prière, la méditation, le recueillement, la pénitence, avaient partagé tous les moments que ses dictées lui avaient encore laissés, et sa résignation parfaite lui laissait assez de liberté pour pouvoir envisager, avec toute la tranquillité que la religion fournit aux âmes que le ciel éprouve, la séparation inévitable dont les religieuses étaient menacées depuis si longtemps, et qu’elle leur avait fait prévoir depuis bien plus longtemps encore.
Enfin, il arriva le jour fatal et trop mémorable où, d’après le plan et les décrets de l’assemblée constituante, la deuxième ou troisième législation donna à l’Europe entière, et à tout le monde chrétien, un spectacle aussi déchirant pour les âmes pieuses qu’il fut agréable à tous les ennemis de l’ordre, de la justice, de la religion et de l’humanité, celui de plus de cent mille religieuses arrachées à leurs cellules et forcées de rentrer dans un monde auquel elles avaient dit un éternel adieu. Quel coup! Je dis qu’un tel spectacle fut agréable aux hommes que j’ai dépeints; mais, pour peu qu’on y fasse attention, on conviendra qu’au fond leur triomphe ne devait pas leur paraitre bien glorieux à eux-mêmes, et que leur âme, si elle conservait encore quelque idée du vrai, n’avait guère lieu de s’en applaudir intérieurement.
Depuis longtemps les gens de cette trempe s’étaient flattés du succès le plus complet sur les vœux religieux. Ils s’étaient efforcés, de toutes les manières, de montrer les cloîtres et monastères comme autant de prisons publiques et de maisons de force, remplies de victimes malheureuses d’un zèle indiscret et d’une tyrannie superstitieuse, aussi contraires, disaient-ils, au bien de la société qu’aux vœux de la nature. Ils avaient, en conséquence, écrit et tâché de persuader que, pour peu qu’on eût seulement entrouvert ces retraites forcées, on eût vu les religieuses s’en échapper à grands flots. Quel contretemps donc et quel secret dépit, lorsque, après avoir inutilement tenté tous les moyens, ils se virent obligés d’avoir recours à une violence également honteuse et outrée, pour obtenir ce que ni la persuasion ni les promesses n’avaient jamais pu gagner ! Qu’on dise de
__________________________
(405-409)
quel côté se trouve la victoire ou la défaite, et lequel des deux partis eut lieu de triompher!
Dès 1790, les municipalités leur avaient signifié le vœu de l’assemblée pour leur rendre une liberté qu’on les supposait regretter amèrement. Supposition calomnieuse; aussi la proposition qu’on leur fit fut universellement prise et reçue comme une insulte, et la réponse générale des religieuses de France fut si négative et si ferme, qu’elle les vengea pleinement de la calomnie, et fit avouer aux plus politiques de l’assemblée que les religieuses n’étaient pas ce qu’on avait cru, et que leur constance, jointe à la résistance des prêtres réfractaires au serment, et à la constitution civile du clergé, pouvait tôt ou tard porter un coup mortel à toutes les opérations du jour, et renverser tout le plan de la révolution. En conséquence, n’espérant plus rien d’ailleurs par rapport aux religieuses ni aux prêtres, on arrêta de s’en tenir aux voies de rigueur, seul moyen de réussir et d’en triompher.
Ce fut donc le 27 septembre 1792 que cet arrêté destructif eut son exécution pour les religieuses urbanistes de Fougères. À la première annonce qu’on leur en avait faite, elles avaient toutes, animées surtout par l’avis de la Sœur de la Nativité, qui parlait de la part de Dieu, protesté de leur répugnance invincible à obtempérer jamais à une loi aussi contraire à leurs vœux et à leurs dispositions; et, au moment de l’exécution, elles allèrent toutes, jeunes et vieilles, se ranger au chœur, chacune à sa place accoutumée, priant qu’on les tuât plutôt au lieu où elles désiraient de mourir. Les enragés eux-mêmes en furent touchés jusqu’aux larmes; les gens envoyés leur répondirent qu’on ne leur ferait aucun mal; mais qu’on allait, de gré ou de force, les conduire toutes aux voitures qui les attendaient dans la cour pour les conduire à leur destination. Alors ce ne fut plus dans le chœur que soupirs, larmes, sanglots, cris et gémissements. Chacune, devenue timide, comme on peut bien se l’imaginer, une religieuse surtout peut l’être pour moins, ne craignit rien tant que de se voir saisie, et peut-être brutalisée par des hommes qu’aucune considération ne peut arrêter; il fallut donc se décider et prendre le parti d’obéir à la force.
Elles se lèvent plus mortes que vives, et à l’appel, comme à l’exemple de leur supérieure, elles allaient en sanglotant joindre les voitures. Tout ceci s’était passé dans l’intérieur de la maison, de sorte que la foule des personnes qui remplissaient la cour n’en avait rien vu ni entendu. Il convenait à la gloire de J.-C. que les témoins de l’enlèvement de ses épouses le fussent aussi de la violence qu’on faisait à leurs vrais sentiments. Arrivées à la porte cochère par où on les fit sortir, la Sœur de la Nativité qui suivait en silence, se retourna vers les gardes et les municipaux en leur demandant, de la part de Dieu, permission de parler : il se fit un grand silence autour d’elle; alors, la Sœur les regardant, leur dit à haute et intelligible voix, parlant au nom de toutes les religieuses : « Messieurs, Dieu me charge de vous notifier que nous choisirions de mourir plutôt que d’enfreindre notre clôture, ni aucun de nos saints engagements; mais puisqu’il nous faut enfin vous obéir extérieurement, nous protestons contre la violence qu’on nous fait, et nous vous déclarons que nous en prenons le Ciel à témoin. » Tous l’entendirent, plusieurs pleurèrent, et personne ne répliqua.
Après ces courtes, mais énergiques paroles, prononcées de ce ton ferme et décidé que, malgré son âge, la Sœur savait prendre au besoin, elle repousse le bras qu’on lui offre, et entre dans la voiture qui devait la conduire chez M. Binel de la Jannière, qui, sur sa réputation, avait demandé et obtenu de la loger chez lui avec ses deux sœurs, religieuses de la même communauté. Madame la supérieure fut conduite chez M. Bochin, son beau-frère, et les autres, ou chez leurs parents, ou chez quelques citoyens qui voulurent bien s’en charger en attendant qu’un nouvel ordre eût décidé de leur sort; car, avant tout arrangement, on avait jugé à propos de les tirer provisoirement de chez elles, pour les mettre sur le pavé. Avant que la générosité de la nation eût avisé aux moyens de pourvoir à leur subsistance, on pensa qu’il convenait de leur ôter le toit, le pain, et bientôt après jusqu’à leurs habits. Excellent moyen pour couper pied à toutes les difficultés.
Arrivées à la maison de M. Binel, les trois religieuses furent conduites par la famille, réjouie et éplorée tout à la fois, à l’appartement qui leur était destiné. Là, prosternées devant un crucifix exposé exprès sur une table, elles prièrent longtemps, et avec beaucoup de larmes et de sanglots, le Dieu sauveur d’agréer le sacrifice qu’il exigeait d’elles, et qu’elles unissaient à celui qu’il fit lui-même sur la croix pour le salut du genre humain. Tous ceux qui furent témoins d’une scène aussi frappante en furent touchés et attendris jusqu’à mêler leurs larmes à celles qu’ils voyaient répandre. Toute la ville en fut dans le trouble; tous les bons cœurs y
__________________________
(410-414)
furent sensibles, toutes les âmes pieuses en ressentirent de la consternation et de la douleur. Hommage dû à l’héroïsme de la vertu qu’on opprime. Cette impression parut si juste et si naturelle, qu’elle fut approuvée par le silence momentané des méchants eux-mêmes, qui parurent en quelque façon la partager.
La voilà donc enfin, cette âme si religieuse, cette fille si extraordinaire, tirée de cette chère solitude pour laquelle elle avait tant soupiré ! La voilà, comme toutes ses sœurs, chassée et exclue pour toujours d’une maison pour laquelle, dès l’enfance, Dieu lui avait donné un goût si décidé, un attrait si vif, une vocation si bien marquée! Elle est donc accomplie sur elle-même cette prédiction pour laquelle elle avait eu tant à souffrir! Comme Jérémie, la Sœur de la Nativité est aujourd’hui victime des malheurs qu’elle avait annoncés. Incrédules, quelles preuves, après cela, demandez-vous de son inspiration?
Quand Dieu permet que ses prédestinés soient exposés à des épreuves extraordinaires, il leur destine en même temps des grâces proportionnées et capables, à tout le moins, de contrebalancer la tentation. Il le doit à la faiblesse de sa créature, à la crainte qu’elle a de lui déplaire, plus encore à la fidélité de sa promesse, et à cette bonté essentielle qui ne peut permettre que personne soit tenté au-dessus de ses forces. C’est la doctrine de saint Paul: Fidelis est Deus qui non patietur vos tentari suprà id quod poteslis. (1 Cor. 10,13.) Il ira plus loin, dit-il, surtout à l’égard de ses élus, car il tirera parti de la tentation même pour les faire vaincre le tentateur, et de l’épreuve pour les faire avancer dans la perfection de leur état : sed faciet eum tentatione proventum. (Ibid.) C’est ce qu’ont éprouvé tous les saints à proportion de leur fidélité à la grâce; c’est aussi ce qu’éprouva la Sœur de la Nativité dans tous les instants de sa vie, mais surtout dans les circonstances les plus critiques pour sa vertu, et les plus orageuses pour sa constance, suivant l’aveu qu’elle en a fait plus d’une fois, comme on l’a vu.
Eh! comment Dieu pourrait-il, je ne dis pas abandonner, mais négliger une âme aussi soumise à tous ses ordres, aussi fidèle à tous ses devoirs, aussi constante dans la pratique de toutes les vertus? une âme qui sait soutenir l’épreuve avec autant de courage, et se montre aussi ferme dans le comble des adversités et des disgrâces, qu’elle fut humble et craintive au comble des faveurs; disons mieux encore, une âme qui regarda toujours les faveurs comme des épreuves, et les épreuves comme des faveurs. Telle parut toujours cette véritable femme forte, et jamais elle ne le parut mieux qu’aux dernières années d’une vie qui ne fut qu’une preuve continuelle de ce que nous avançons.
Bien éloignée de ces religieuses relâchées, tièdes et imparfaites, de ces épouses qu’on pourrait nommer infidèles et adultères, qui eussent regardé l’état où on les réduisait comme une dispense tacite de leurs premiers engagements, la Sœur de la Nativité n’y vit au contraire, pour elle et les autres, qu’une raison plus pressante, un motif plus impérieux de s’y rendre plus fidèle que jamais; elle crut qu’une religieuse sortie de son cloître par le malheur des temps doit être plus active que jamais à s’acquitter de ses vœux et statuts, autant que les circonstances peuvent le lui permettre. N’étant plus défendue par les murs qui la séparaient du monde, elle doit les remplacer par sa circonspection, redoubler la garde de ses sens en raison et à proportion des scandales et des dangers qui l’environnent, pour ne pas s’exposer à prostituer à l’esprit du monde un cœur consacré à J.-C., et qui ne doit brûler que pour lui. Enfin, quoique âgée de plus de soixante-cinq ans, elle crut que la vigilance la plus exacte pouvait seule la défendre de la contagion du mauvais exemple et de la corruption des mœurs.
Ce fut pour se conformer à ces grands principes de la morale chrétienne, à ces règles de la vie monastique qu’elle avait puisées autant à l’école de J.-C. que dans la pratique de ses devoirs, que la Sœur de la Nativité, non contente de le répéter aux autres à chaque instant, s’appliqua de toutes les manières à remplacer intérieurement et extérieurement la solitude dont on venait de la priver. Elle s’enferma dans une petite mansarde d’où elle ne sortait que quand il n’y avait pas moyen de faire autrement. Cette étroite chambre, dont elle fit sa cellule, lui tint dès lors lieu de celle qu’elle avait quittée, et devint pour ainsi dire son tombeau, puisque c’est là qu’elle vint mourir, peu d’années après, comme nous le dirons. C’est là que, revêtue et enveloppée des restes de ses pauvres habits de religion, elle partageait tout son temps entre la prière, la méditation, la lecture des livres de piété, les avis qu’on venait lui demander, et les petits services qu’elle pouvait rendre par ailleurs à ses sœurs ou à la pieuse famille qui lui fournissait sa nourriture et son logement.
« Tu crains de n’avoir pas où loger,
__________________________
(415-419)
lui avait dit autrefois J.-C., en lui annonçant sa sortie, viens dans mon cœur et je te tiendrai lieu de tout…. Je suis tout à celui pour qui tout n’est rien, et qui abandonne tout pour me trouver; ma providence ne délaisse jamais celui qui ne met qu’en moi sa confiance, etc. » Faut-il s’étonner si la Sœur était si résignée, et même si contente dans son nouvel état? Faut-il s’étonner si elle croyait ne manquer de rien où tant d’autres auraient cru manquer de tout; si elle se trouvait importunée des moindres attentions qu’on prenait de tout ce qui la concernait? À l’entendre, on faisait toujours trop pour elle, et jamais elle ne paraissait tant à son aise qu’avec les personnes qui n’en faisaient aucun cas. Tout ce qui avait l’air d’égards lui faisait de la peine; le moindre compliment la mortifiait, et la plus sûre manière d’avoir la préférence dans son amitié était de paraître la mépriser; on la connaissait assez pour employer à son égard un moyen si peu en usage à l’égard des autres.
À l’exemple, et sur les traces de tant de saints qui, pour apaiser la colère de Dieu, autant que pour prévenir leur propre faiblesse, ont redoublé leurs pénitences et leurs austérités dans les temps d’épreuves et de persécutions où l’Église se trouvait exposée, la Sœur de la Nativité entra dans les mêmes vues, et se sentit toujours animée du même esprit. Il y avait longtemps qu’elle priait et travaillait à prévenir les malheurs qu’elle avait prédits; on peut dire même que toute sa vie y avait été employée; mais au moment où elle en vit l’accomplissement se réaliser sur elle-même, elle résolut plus que jamais d’y sacrifier le reste de ses jours, en dévouant son esprit à l’humilité, son cœur à la douleur, et tout son corps à la souffrance, sans jamais se plaindre de rien.
En sortant de sa communauté, elle entreprit, par l’ordre de Dieu, qui exigeait l’agrément de sa supérieure, un an de jeûne au pain et à l’eau, et elle y persévéra, quelque chose qu’on pût dire ou faire pour l’en empêcher. Il fallait la tromper pour mettre un peu de beurre dans la soupe qu’on lui permit et qu’on l’obligeait de prendre, qui, d’ailleurs, n’était composée que d’eau avec un peu de légume et de sel. Quand elle s’apercevait de la tromperie, elle s’en plaignait en disant qu’on voulait la gâter et qu’elle en craignait les suites. Elles étaient peut-être plus à craindre pour nous qu’on ne penserait. Qui sait ce que nous ne devons pas à une vie aussi mortifiée ? C’est d’ordinaire à cause des âmes de ce caractère que Dieu fait grâce à tant d’autres, aux villes, aux royaumes, au monde entier. Serait-ce trop dire, serait-ce témérité, d’avancer que celle-ci a vraisemblablement plus contribué que toute autre à nous obtenir enfin ces temps plus heureux dont elle n’a pas joui, mais qu’elle nous avait annoncés tant de fois de la part du ciel ?…Si le ciel lui avait accordé tant de connaissances pour nous, n’aura-t-il rien accordé en notre faveur aux larmes, aux prières et aux pénitences continuelles d’une âme qui lui était si agréable, et pour qui les maux de l’Église et de sa patrie étaient un fardeau plus accablant que celui des années joint à toutes ses infirmités?
Quelque sérieuse et réfléchie qu’elle ait toujours été, elle savait cependant se prêter aux circonstances, comme on l’a déjà vu; elle compatissait au besoin des autres, et sa vertu n’était guère sévère que pour elle-même. Sans être jamais dissipée, ses récréations étaient quelquefois très amusantes pour les âmes pieuses avec qui elle vivait. Il est vrai que dans ses conversations elle rappelait tout à ses grandes idées de Dieu et de la vertu; mais, comme elle avait naturellement l’esprit aussi juste que son cœur était bon et vertueux, elle mettait dans tout ce qu’elle disait une justesse et une droiture qui excitaient le plus vif intérêt. Quoiqu’elle fût un peu longue dans sa manière de narrer, on voulait toujours l’entendre jusqu’au bout, et on lui en demandait d’ordinaire beaucoup plus qu’elle ne voulait en dire.
Depuis la sortie des religieuses, ses entretiens ne roulaient guère que sur la manière dont une religieuse devait se comporter dans le monde pour y mettre son salut et ses vœux en sûreté, et cette inquiétude ne finit qu’avec sa vie. Mille fois elle leur répéta que ce serait à la conduite qu’elles tiendraient après leur expulsion, que J.-C. reconnaîtrait un jour ses vraies épouses de celles qui n’en auraient eu que l’habit. Elle revenait sans cesse à cette matière, qu’elle tournait en mille façons, surtout à l’approche de leur décostumation, qui arriva le 14 septembre 1793, elle ne cessait d’en parler, ni de prescrire aux religieuses la manière dont elles devraient se vêtir. Ce n’est pas qu’elle ignorât que ce n’est ni le lieu ni l’habit qui fait la religieuse; mais elle prétendait qu’une religieuse décostumée doit encore, autant qu’il est en elle, paraître ce qu’elle est, et éviter, avec tout le soin possible, toute manière de se mettre qui pourrait la faire confondre avec les personnes du monde.
Un jour, entre autres, elle passa plus d’une bonne beure à leur paraphraser, à sa manière, la parabole des vierges
__________________________
(420-424)
folles et des vierges sages, et leur dit sur cela des choses étonnantes et frappantes au dernier point. Une autre fois, elle dit à madame la supérieure qu’il surviendrait bientôt un aheurt dont elle recevrait bien du chagrin; ce qui fut vérifié par certaines défections parmi les religieuses mêmes. Elle lui répéta souvent qu’elle aurait bien des peines de corps et d’esprit; mais que Dieu lui réservait aussi bien des consolations. Elle fit, en d’autres circonstances, des annonces semblables à bien d’autres personnes qui en ont senti la vérité.
TROISIÈME ÉPOQUE.
La Sœur chez son frère.
Peu de temps après que les religieuses eurent été expulsées de leur communauté, elles furent contraintes, par une loi, de quitter leur costume religieux; ensuite parut bientôt une autre loi qui les obligea de rentrer dans leurs familles et d’habiter le lieu de leur naissance. Ainsi la Sœur de la Nativité, forcée d’obéir, comme les autres, à ce nouvel ordre, se sépara avec douleur des deux religieuses qui, en sortant de leur communauté, s’étaient retirées avec elle dans la maison de leur frère, à Fougères, et quitta avec regret la respectable famille de M. Binel, pour se rendre chez Guillaume le Royer, son frère, qui tenait alors la ferme de Montigny, située dans la Chapelle-Janson, assez près du bourg de la Pellerine, paroisse du Maine. On l’y conduisit; mais elle versa bien des larmes en quittant ses Sœurs, qu’on devait bientôt renfermer, comme elle leur avait fait prévoir. Elle leur avoua même que cette séparation lui coûtait autant, pour le moins, que leur sortie de la communauté. On apercevra sans doute les desseins de Dieu dans cette translation de la Sœur dans son pays natal, quand on aura vu les services qu’elle rendit à son propre frère, et de quelle utilité elle fut à sa famille dans une circonstance aussi critique, dans un temps aussi orageux.
Les troublés affreux qui avaient commencé l’année précédente et ne s’apaisèrent que l’année d’après, étaient alors presque à leur comble à Fougères, comme dans presque toutes les autres villes. C’était alors le règne de la terreur : réquisitions, otages, dénonciations, proscriptions, emprisonnements, exécutions, toutes les lois de sang, tous les arrêtés inhumains étaient à l’ordre du jour; dix, douze, quinze, et jusqu’à dix-neuf citoyens, passaient journellement sous l’affreux instrument de mort dont le nom seul fait encore frémir l’humanité. Il suffisait d’avoir quelque possession, d’être attaché à ses principes, ou d’avoir quelque ennemi secret, pour être dénoncé, et il suffisait d’être dénoncé pour être coupable : de là à la guillotine il n’y avait qu’un pas.
Y a-t-il lieu d’être surpris que de pareilles horreurs aient occasionné des insurrections en tant de provinces? Fougères en devint le théâtre malheureux, comme bien d’autres villes. Elle fut successivement prise et reprise par les Vendéens, par les Bleus et par les Chouans : on fut même, plus d’une fois, sur le point de l’incendier. On y voyait flotter tantôt le pavillon blanc, et tantôt le tricolore; on y entendait crier tantôt Vive le Roi ! et tantôt Vivent les Sans-Culottes! et le tout, suivant le succès du moment pour chaque parti: en un mot, on y voyait toutes les horreurs des guerres civiles. Le sang humain y ruisselait de toutes parts. En quelques endroits surtout, les rues y furent tellement jonchées de cadavres qu’il était impossible d’y passer sans les fouler aux pieds.
Le mal qui depuis longtemps avait gagné tous les ordres s’était propagé dans les campagnes, où il se commettait continuellement des atrocités qu’on a peine à décrire. Les prêtres des deux partis étaient réciproquement en butte aux coups du parti qui leur était opposé. Ceux du bon parti surtout étaient d’autant plus exposés qu’ayant contre eux la force dominante, ils étaient les seuls dont le peuple requérait le ministère : aussi les deux partis les cherchaient jour et nuit, mais avec des intentions bien différentes (1).
(1) Les bons prêtres étaient obligés de se tenir cachés sous terre, au milieu des champs ou des landes, d’où ils ne sortaient que la nuit, pour se rendre auprès des malades. Rarement rentraient-ils sans avoir essuyé quelques coups de feu, reçu quelques balles, ou couru quelque danger.
Les autres, protégés par la force dominante, n’avaient d’autre soin qu’à se bien cacher des insurgés. Ceux qu’on nommait partout les catholiques et les bons prêtres, étaient sans cesse recherchés et massacrés sans miséricorde par les Bleus, qui très souvent n’épargnaient pas les constitutionnels. Ceux-ci étaient recherchés par les Chouans, qui ne leur faisaient pas un meilleur parti partout où ils pouvaient les trouver (1).
(1) M. Duval, recteur de Laignelet, et M. Sorette, curé du Chatellier, deux excellents sujets, furent, presque dans leurs fonctions, massacrés par les Bleus. M. de Lesquin, recteur de la Bazonge, M. Porée, curé de Silly, M. Larcher, recteur constitutionnel de Mellé, le furent par les Chouans. Je ne cite que ces exemples de la fureur des deux partis, et je les cite parce qu’ils se sont passés aux environs de Fougères, et qu’ils ont plus de rapport avec les faits que je dois rapporter.
__________________________
(425-429)
Toute la différence, c’est que le bon peuple regrettait les premiers, bénissait leur mémoire, conservait précieusement leurs dépouilles. Personne ne pensait aux seconds (1).
(1) Le Ciel qui, pour des raisons que nous devons adorer, permettait de pareilles atrocités, paraissait aussi quelquefois s’en indigner. On ferait des volumes, si on voulait recueillir les traits frappants de cette indignation visible, je ne dis pas seulement à tout chrétien sensé et qui n’a pas perdu la foi, mais encore à quiconque n’a pas intérêt de s’aveugler. J’en citerai deux ou trois qui ont eu assez de notoriété pour ne pouvoir être révoqués en doute.
Le lendemain du jour où M. Duval, recteur de Laignelet, eut été assassiné au voisinage de Fougères, le feu du ciel tomba sur le clocher de St.-Léonard de la même ville, et cet événement fut accompagné de tonnerre, d’éclairs, de grêles, de glaces et de brouillards, enfin de circonstances si violentes et même si contradictoires, que les plus intrépides en étaient effrayés, et qu’on ne les attribuait qu’à une punition de Dieu. C’est un fait dont toute la ville rend témoignage.
Peu de temps après cet événement l’intrus de la même paroisse mourut en criant qu’il tombait dans l’abîme. Il est vrai que peu de temps avant de mourir, il témoigna encore qu’il mourrait dans les principes révolutionnaires; mais il est vrai aussi qu’il recommença, le moment d’après, à s’écrier : Retirez-moi de l’abîme! Préservez-moi de l’abîme! je tombe dans l’abîme! et qu’il continua ainsi, sans que les personnes qui l’assistaient pussent l’en dissuader.
Le clocher et l’église de St.-Aubin-Tergate, en Normandie, furent aussi consumés par le feu du ciel, pendant qu’ils étaient en la possession de l’intrus. Je ne parle point de toutes celles qui ont été brûlées par les Chouans, à la même occasion.
Dans une autre paroisse voisine de Fougères, le même tourbillon abattit les cheminées de deux maisons de révolutionnaires, et ne fit aucun mal à celle d’un chrétien royaliste qui se trouvait entre les deux.
Un impie du pays de Vitré graissa ses bottes avec les huiles consacrées : mais à peine il les eut prises, qu’il devint perclus des deux jambes. Le fait suivant n’a pas fait moins de bruit; je le tiens d’une famille respectable qui arrivait du lieu et m’en rapporta les circonstances principales. C’est à Brest que la chose a eu lieu:
À l’époque où l’on s’emparait des richesses des Églises, un malheureux qui avait été congréganiste chez les jésuites emportant sur ses épaules, avec beaucoup d’imprécations et de blasphèmes, cette même image d’argent de la mère de Dieu, qu’il avait autrefois portée sur des brancards avec beaucoup de respect et de vénération. Un de ses camarades qui l’entendait lui rappela ces premiers temps. Ce souvenir, qui aurait dû modérer, au moins ses emportements et ses impiétés, ne servit qu’à les redoubler. Il prononça des horreurs contre cette même Vierge dont ses premiers maîtres lui avaient appris à chanter les louanges. À l’instant, au grand étonnement des spectateurs, sa bouche se tourna de travers, sa figure devint horrible, il se fit peur à lui-même; et on m’a assuré que jusqu’ici il n’avait pu trouver d’autre remède à sa hideuse situation, que de se bannir de la société. Il s’est retiré à sa maison de campagne, à quelques lieues de Brest, où il ne voit de personnes que le moins qu’il lui est possible, mais toujours assez pour en fournir des témoins non suspects et en nombre compétent.
En voici un autre qui n’est pas moins certain, quoiqu’il ait eu peut-être un peu moins de publicité. À l’époque où l’on vendait publiquement les ornements des autels, où l’on employait les chapes, les chasubles, à faire des housses à chevaux, où l’on changeait en robes pour les courtisanes les plus belles aubes et les autres ornements des prêtres; enfin, où l’on faisait servir les choses les plus saintes aux usages les plus profanes, il y avait dans la ville de Fougères, à l’endroit de la Fourchette, ou des Quatre-Moulins , un enragé qui, par un raffinement d’impiété et de fureur, s’avisa d’habiller son gros chien en prêtre qui dit la messe. Il ne manquait rien à l’affreux accoutrement qu’il lui avait fait faire pour mieux tourner en dérision l’action la plus respectable de la religion.
Dans cet état, il le produisit devant sa porte, criant aux passants de venir à la messe de son calotin, à qui il faisait faire les mouvements auxquels il l’avait dressé. Malgré la fureur irréligieuse dont la plupart étaient alors transportés, ce spectacle parut blesser les yeux, et plusieurs en furent révoltés. Des jacobins l’avertirent de ramasser son animal, disant que cet amusement n’était pas trop à sa place, ni convenable. Il lui fallut donc s’y rendre; mais celui dont on ne se moque point impunément, avait une semonce plus sérieuse à lui donner.
Le jour même il tomba dans une frénésie terrible, qui se changea en une rage à laquelle on ne put apporter aucun remède. Il hurlait épouvantablement; sa figure même avait quelque chose du chien; enfin, au bout de vingt-quatre heures, le malheureux périt dans des convulsions et des douleurs d’entrailles qu’il est impossible de rendre. Je le tiens de personnes qui ont tout vu, et le témoignage que j’ai cherché sur le lieu même n’a contredit en rien ce que je viens de rapporter.
RÉFLEXION.
On demande tous les jours comment il se peut faire que Dieu ait souffert tant d’iniquités, tant de scandales, tant de sacrilèges, tant d’horreurs par lesquelles on l’a si ouvertement outragé, sans donner aucune preuve de cette puissance qu’on osait défier. On semble même se scandaliser de ce silence de la Divinité. Vous diriez que la foi de certaines âmes en devient plus faible, et que le démon de l’irréligion en prend lieu de triompher.
Il est facile cependant de détruire ce scandale en répondant trois choses que voici : 1° Dieu n’est pas obligé de faire des miracles chaque fois qu’un impie semble l’en défier. La souveraine sagesse ne dérange l’ordre établi que pour des raisons capables de l’y déterminer. L’Être nécessaire qui a pour lui l’Éternité, n’a pas de raison de répondre sur le champ à un petit être qui ose lui en donner le défi. Patiens est quia œternus.
2° Il n’est ni à propos, ni dans l’ordre, que Dieu fasse des miracles sitôt que les hommes les désirent. Une pareille conduite, outre qu’elle ôterait aux uns le mérite de la foi, nuirait à la liberté des méchants. Si tous les impies et les pécheurs étaient punis sitôt qu’ils le méritent, que deviendrait cette liberté de faire le bien ou le mal ? Il faut que tous aient le temps de se rendre dignes de récompenses ou de châtiments.
3° Il suffit à la bonté de Dieu que les âmes de bonne volonté reçoivent de fois à autres des preuves sensibles des vérités qu’elles croient, et de l’assistance du Dieu en qui elles espèrent, et qui les soutient. Or, il y en a tant de cette espèce, que personne n’a droit de se scandaliser de la conduite du Dieu patient, qui n’agit qu’avec poids et mesure, et dont la providence conduit tout à une fin digne de lui, par des voies qui nous sont cachées.
Genêt ,
desservant de Saint-Sauveur-des-Landes.
5 novembre 1803.
Pendant que d’aussi horribles scènes se passaient autour d’elle, la Sœur, retirée chez son frère à la petite ferme de Montigny, y menait une vie plus pénitente encore qu’à Fougères ou dans sa communauté : elle passait en prières les jours et une partie des nuits. Le prêtre, curé de la Chapelle-Janson, qui sortait une fois ou deux la semaine de son souterrain pour venir la communier (M. Jambin), m’a conduit dans la chambre qu’elle occupait, et, me montrant un petit endroit à côté de son lit : Voilà, me dit-il, le lieu où je la trouvais, à une heure ou deux du matin, se préparant, à genoux, à se confesser et à recevoir la sainte communion que je lui apportais. Après son action de grâce, elle se couchait pour reposer un peu…
__________________________
(430-434)
En entrant chez son frère, la Sœur reprit le costume religieux, autant qu’il lui fut possible. Elle se fit, autour de la maison, un petit enclos bien plus étroit que le jardin, pour prendre l’air pendant une heure. Elle ne sortait jamais que pour aller à la sainte messe le plus souvent qu’elle pouvait, malgré ses infirmités qui lui rendaient ce voyage de pied toujours fort pénible. Ses soirées et ses après-dîner étaient ordinairement employés à l’instruction des enfants du village, surtout de ses neveux et nièces, à qui elle faisait réciter leur catéchisme et leurs prières, qu’elle leur expliquait en y joignant l’évangile de chaque dimanche, et se mettant à leur portée dans tout ce qu’elle leur disait.
En entrant chez son frère, elle avait pris le parti de ne profiter de l’ascendant que lui assuraient l’amour et le respect de toute cette pauvre et honnête famille, que pour leur interdire toute espèce de dépense à son occasion. Le pain gros et noir de la campagne, la soupe telle que la mangent les ouvriers, la galette de blé noir faite à la manière des cultivateurs, des racines ou légumes, sans presque aucun assaisonnement, voilà sa nourriture de choix et de prédilection, qu’elle mangeait d’un fort bon appétit. Elle grondait son frère, quand il lui arrivait de lui avoir quelque chose d’un peu moins ordinaire, disant qu’elle était trop heureuse de vivre comme eux, et qu’il y en avait bien de meilleurs qu’elle qui n’en avaient pas tant; qu’il fallait penser à faire pénitence, et que les saints n’étaient pas si délicats de ce côté-là. Quand ils avaient du cidre, elle en buvait un peu à son repas. Par goût, elle le préférait à toute autre boisson, mais par religion elle donnait à l’eau la préférence sur toute autre liqueur. C’était toujours le même genre de vie, et sa pension n »était pas plus dispendieuse en maladie qu’en santé. On n’osait même lui faire aucune représentation.
Que diront ceux dont tout l’art des cuisiniers ne peut réussir à satisfaire la sensualité, en voyant une fille renchérir ainsi sur la mortification même de ceux dont les jours de joie et de bonne chère seraient pour eux une pénitence insoutenable? Qu’un tel parallèle doit leur paraître humiliant, s’ils sont encore chrétiens!…
Ce n’était pas seulement pour la soustraire aux troubles et aux dangers de la ville, que la Providence lui avait ménagé une retraite à la campagne. Les grands services qu’elle y rendit à sa famille font assez voir un autre dessein en celui qui sait tirer parti des moindres événements. Le frère de la Sœur de la Nativité se trouvait, malgré lui, agrégé au corps municipal de sa paroisse, poste dangereux en ce temps-là pour un homme dont la probité ne pouvait ni oublier ses premiers principes, ni se prêter à tout ce que les circonstances paraissaient exiger. Le Royer s’était par-là fait des ennemis dans les deux partis, qu’il eût voulu concilier, et des ennemis assez puissants ou assez scélérats, pour qu’il eût lieu de tout craindre de leur part, surtout dans un temps où l’on pouvait tout oser, et où la licence contre le parti réfractaire était sûre de l’impunité. Très probablement il eût été victime, comme tant d’autres, si Dieu ne lui eût ménagé, dans sa Sœur, une ressource dont personne ne pouvait se défier, une arme défensive contre laquelle vinrent se briser tous leurs efforts. Elle ne pouvait arriver plus à propos qu’au temps où elle vint prendre sa demeure chez ce bon fermier.
La maison de Le Royer était comme l’entrepôt des deux partis opposés, dont les compagnies rôdaient successivement dans tout le canton. Les Bleus le regardaient comme un aristocrate déguisé et un receleur de chouans; et ceux-ci le prenaient pour un jacobin mitigé, un traître à leur parti : ainsi les uns et les autres lui en voulurent presque également. La Sœur de la Nativité, qui en craignait les suites, lui défendit de se trouver avec eux, et se chargea de travailler par elle-même à leur faire entendre raison aux uns et aux autres, et à faire avec eux la paix de son frère sans le compromettre. Elle s’y employa en toutes rencontres et parvint enfin à les réconcilier.
Pour y réussir, elle s’exposa plus d’une fois elle-même; mais elle montra toujours autant d’indifférence pour sa propre vie, qu’elle fit paraître de zèle pour celle qu’elle avait entrepris de protéger. Le chef des Chouans était un jeune gentilhomme du pays (1); elle l’aborda au milieu de sa compagnie, et lui parla avec tant de zèle, d’intérêt et de bon sens, qu’il entra dans toutes ses
__________________________
(435-439)
raisons, et lui promit, foi d’honnête homme, que jamais son frère n’aurait rien à souffrir de la part d’aucun de ceux qu’il commandait; il lui tint parole.
Parmi les Bleus qui en voulaient à Le Royer, et que sa sœur fut obligée de prévenir et de gagner, il s’en trouvait un, entre autres, qui l’accusait d’avoir dénoncé un de ses amis qu’on venait d’exécuter pour ses hauts faits. L’accusation était fausse, mais Beux-neux (c’était son nom) n’en était pas moins furieux contre l’accusé. Il avait juré sa perte, et promis que jamais il ne mourrait que de ses mains. La promesse était d’autant plus à craindre, que son exécution n’eût pas été le coup d’essai de celui qui la faisait. Il était connu dans le pays, et on ne savait malheureusement que trop de quoi il était capable. Depuis ce temps il épiait l’occasion favorable à son dessein; mais la Sœur, par un sentiment bien contraire, ne le perdait pas plus de vue qu’il ne perdait lui-même celui qu’il regardait comme son ennemi.
Un jour Beux-neux entre chez Le Royer, demande s’il y est, ayant les armes à la main, la colère dans les yeux et les imprécations à la bouche. La Sœur, qui l’avait aperçu dans l’aire, l’avait prévenu en forçant son frère de monter dans sa cellule : elle se présente seule à l’assassin, lui représente avec hardiesse le tort qu’il se fait à lui-même en poursuivant un homme qui ne lui a jamais voulu ni fait aucun mal; que son frère est innocent de ce qu’il lui reproche…. Ensuite elle se jette à genoux devant lui, le conjurant, s’il veut passer outre, de la prendre elle-même pour victime, et quelle est très disposée à lui pardonner sa mort…. Le furieux veut la faire relever, disant que ce n’est point à elle qu’il en veut: la courageuse Sœur lui proteste qu’elle n’en fera rien, et qu’il faut sur le champ, ou qu’il lui ôte la vie, ou qu’il lui accorde celle de son frère…. Tout en lui parlant ainsi, elle le menace de la vengeance céleste d’une manière si ferme que les armes lui tombent des mains. Il se trouble, devient sensible et sent, comme malgré lui, renaître la crainte de Dieu dans un cœur qui avait peut-être éteint jusqu’à l’idée de son existence…. « Relevez-vous, bonne religieuse, lui dit-il, et restez tranquille ; vous pouvez assurer votre frère qu’il n’a rien à craindre de ma part. Je ne lui ferai jamais aucun mal. » Cela dit, il sort et n’a jamais reparu. C’était là un moment favorable pour sa conversion; heureux s’il en a profité, car on assure qu’il a payé par sa mort le sang qu’il avait répandu, et qu’il a été enfin frappé du fer dont il avait frappé tant d’autres. Il n’est pas le seul exemple qu’on pourrait citer: Qui percusserit gladio, gladio peribit.
Ce courage étonnant dans une fille, cette intrépidité dont bien des hommes, ne seraient pas capables, la Sœur de la Nativité en a donné des preuves les moins équivoques, en bien d’autres circonstances particulières, pendant son séjour à Montigny, qui comme je l’ai dit, était sans cesse rempli tantôt par des détachements de Bleus, tantôt par des compagnies de Chouans, qui se donnaient mutuellement la chasse. Un jour elle se jeta entre son frère et le fusil d’un Bleu qui le menaçait; elle se voyait journellement aux prises avec autant de bêtes féroces, qu’il eût fallu humaniser en les ménageant avant de penser à les convertir. Ils venaient exprès autour d’elle pour la voir et l’écouter. Ils lui faisaient des questions captieuses pour la sonder sur les affaires du temps ou sur la religion. La Sœur répondait à tout avec douceur et prudence, mais toujours avec tant de fermeté sur le point des anciens principes en fait de religion, qu’elle les y rappelait sans qu’ils s’en aperçussent : on assure même qu’elle en a converti quelques-uns. Ils lui faisaient des objections contre la foi, auxquelles elle répondait en leur faisant connaître à eux-mêmes les passages de l’Évangile qui les condamnaient. Souvent ils avouaient leur défaite.
Il s’élevait quelquefois des disputes entre eux à son occasion, les uns prenant pour, et les autres contre elle. « C’est un espion, disaient les uns, c’est une vieille aristocrate dont il faut se défaire; c’est une vieille folle, une radoteuse, qui ne sait ce qu’elle dit ; si on la laisse parler elle séduira les autres…. Taisez-vous, répliquaient les autres, vous seriez trop heureux de la valoir; elle vaut mieux que nous tant que nous sommes, nous ne sommes que des ignorants vis-à-vis d’elle… » Quidam enim dicebant : quia bonus est. Alii dicebant : non, sed seducit turbas. (Joan. 7,12).
« J’ai bien envie, disait l’un, de l’envoyer en l’autre monde faire la théologienne, et apprendre le catéchisme aux enfants. Si tu es assez hardi, reprenait un autre, de lui faire la moindre insulte, tu auras affaire à moi, je t’apprendrai à respecter les honnêtes gens…. Impertinent! tu ferais bien mieux de l’écouter et d’en profiter, car tu en as grand besoin, tu n’as jamais su un mot de ta religion !… »
La Sœur voyait et écoutait tout cela d’un air de paix et de tranquillité qui leur en imposait, quoi qu’ils en eussent, en leur montrant qu’elle n’était ni épouvantée par leurs menaces, ni flattée par leurs compliments, et qu’ils n’excitaient
__________________________
(440-444)
en elle que la compassion et la pitié pour l’état où elle les voyait.
Après les avoir modérés par la douceur de ses représentations, et le bon sens qu’elle mettait dans ses réprimandes, elle profitait adroitement du moment où la raison était chez eux plus tranquille, pour leur reprocher leurs blasphèmes et leurs mauvaises dispositions. Elle ne craignait point de les menacer de la colère divine, en leur disant que, s’ils ne se convertissaient, ils avaient tout à craindre de tomber en enfer; que les jugements de Dieu seraient terribles sur eux; qu’elle n’eût pas voulu être à leur place. Ils étaient quelquefois si frappés de ce qu’elle leur disait, que plusieurs d’eux cherchaient les moyens de l’apaiser en lui promettant qu’ils se convertiraient tôt ou tard et suivraient ses avis.
Un des plus mutins l’ajusta un jour avec son arme, disant qu’elle n’était qu’un chouan déguisé, un espion de leur parti, qu’il fallait tuer : on croit qu’il agissait très sérieusement; mais, n’eût-il fait que plaisanter, une arme à feu entre les mains d’un homme de ce caractère, qui se met dans la disposition de la décharger, a bien de quoi faire peur à celui vers qui on en dirige l’embouchure. La Sœur, cependant, toute malade et couchée qu’elle était alors, le regarda fixement, en lui disant qu’il pouvait tirer s’il voulait, et que sa vie était entre les mains de Dieu. On ignore par quel motif il se contenta de cette réponse, sans rien faire de plus que d’ajuster. La Sœur s’est trouvée plus d’une fois dans le cas de répéter la même chose, et on peut bien dire d’elle ce que saint Cyprien dit des confesseurs dont il fait de si beaux éloges, que ce n’est pas elle qui a manqué au martyre, mais que c’est le martyre qui lui a manqué….
Telle parut la Sœur de la Nativité tout le temps qu’elle resta chez son frère; elle y montra, comme partout ailleurs, une âme de héros dans un corps de fille. C’est trop peu dire; dans une santé qui existait à peine, elle déploya, suivant les circonstances, tout ce que la perfection de la charité, tout ce que l’héroïsme de la vertu peut inspirer de plus magnanime aux âmes véritablement chrétiennes. Ils n’en croiront rien, sans doute, ceux qui s’obstinent à ne voir dans les dévots que des cœurs bas et pusillanimes, et dont l’éternel refrain est de répéter que les religieuses surtout ne sont bonnes à rien. Je leur demanderai seulement comment ils auraient soutenu de pareilles épreuves; car, s’il est permis d’en juger par ceux de leurs pareils qui s’y sont trouvés, il y a beaucoup à croire que leur grand cœur se fût démenti. Les paroles ne sont rien; c’est la conduite qui prouve tout: la Sœur a prouvé de toutes les façons. La seule circonstance où la crainte lui ait fait éprouver une défaillance, fut quand elle se mit entre son frère et le fusil qui le menaçait ; on peut dire que ce n’était pas pour elle-même qu’elle craignait; ceux qui lui causaient cette frayeur furent les premiers à la soutenir.
Quand son frère lui-même me donna, devant toute sa famille, les détails dont je viens de faire le précis, il s’étendit beaucoup sur les vertus et les bonnes qualités qui avaient brillé en elle dès l’enfance, allant toujours croissant avec elle. Sa prudence dans les conseils, sa douceur dans la conduite, la rendaient comme l’oracle et le chef de la famille. Le père et la mère s’en rapportaient à elle sur tous les points, et tous les autres enfants, dont elle était l’aînée, lui obéissaient autant et souvent plus facilement qu’au père et à la mère, d’autant plus que son gouvernement était très doux, et qu’elle les portait beaucoup plus en agissant qu’en parlant, à, rendre à leurs parents l’obéissance et le respect qu’ils leur devaient. Jeannette, me dit-il, était toujours consultée; c’était elle qui décidait sur tous les points, et très souvent nos parents nous renvoyaient à elle : nous craignions autant et plus de lui déplaire qu’à eux-mêmes.
Tandis que cette sainte fille a été chez moi, poursuivit Le Royer, il semble qu’elle a attiré la bénédiction de Dieu sur ma famille, au point que tout, jusqu’aux événements les plus funestes, se tournait en ma faveur. Oui, ajouta-t-il, si les tristes circonstances par où j’ai passé ne m’ont pas ruiné de fond en comble, c’est à ses saintes prières que je dois; rien ne pourra m’en dissuader. Sur cela, il me cita différents traits, dont je prendrai un seul qu’il me rapporta à peu près en cette manière:
Les pertes que j’avais essuyées pendant les années malheureuses qui ont passé, m’avaient obligé à quitter la ferme de Montigny (en effet, il n’y était plus depuis longtemps quand je lui parlai; il demeurait alors dans un village plus proche du bourg de la Pellerine) et à vendre deux de mes bœufs pour m’acquitter, de sorte qu’il ne m’en restait plus qu’une paire, qui me reste encore aujourd’hui; eh bien, monsieur, voici ce qui arriva: un jour que je charroyais avec mes deux bœufs, j’arrivai à une descente si rapide que les bœufs ne purent retenir la charrette, qui passa sur celui des deux qui avait bronché en marchant : j’entendis, de mes deux oreilles, le fil de la roue faire le même bruit que si elle eût passé sur
__________________________
(445-449)
une claie dont elle eût brisé les barreaux. Ce craquement me fit croire que mon bœuf avait les côtes brisées et tout le corps moulu; et moi, de me lamenter : mon Dieu, m’écriai-je ! me voilà ruiné sans ressource : que deviendrai-je après ce triste accident?….
Quelle fut donc ma surprise, monsieur, quand, après mes lamentations, je retournai les yeux sur mon pauvre animal que je croyais en pièces, et que je le vis se relever de lui-même, sans qu’il y ait jamais rien paru ! Chose étonnante, et que je ne croirais jamais, si je n’en avais été témoin ! Il n’y avait rien de rompu, pas même la courroie qui liait le joug avec les cornes du bœuf: elle s’était déliée, je ne sais comment, au moment de la chute, pour dégager l’animal, qui se trouva posé entre les deux roues, sans que je puisse comprendre comment cela se fit, ni d’où venait le craquement que j’avais entendu….. On en pensera ce qu’on voudra, mais je gage que sur cent coups on n’en ferait pas un pareil. Je laisse à qui voudra de l’éprouver.
La Sœur essuya de grandes et de fréquentes infirmités chez son frère. Celle dont elle était habituellement affligée, lui causait de grandes coliques qui l’obligeaient souvent à garder le lit; une dysenterie qui survint, la jeta dans une maladie sérieuse, dont elle eut peine à se tirer. Cependant elle n’avait recours aux remèdes que par force; elle ne se plaignait point, et ne permettait point aux gens de la maison d’interrompre leurs travaux pour la secourir : il lui suffisait qu’avant de partir ils missent à côté d’elle ce dont elle pouvait avoir besoin. Une demoiselle charitable qui l’était venue voir de la part de M. le doyen de la Pellerine, la trouva un jour dans cet état; et comme elle la plaignait sur la peine et l’abandon où elle la voyait : Vous avez trop de charité, ma bonne demoiselle, lui répondit la Sœur; je ne suis point à plaindre; je ne manque de rien, j’ai tout ce qu’il me faut : cent personnes autour de moi ne m’empêcheraient pas d’avoir ma croix à porter, et vous voyez qu’on a pourvu à tout, en me donnant tout ce dont j’ai besoin. La demoiselle regarda à côté d’elle, et vit sur une chaise un morceau de gros pain sec avec un peu d’eau pure dans une écuelle de terre : c’était son régal ordinaire, et voilà ce qu’elle appelait ne manquer de rien. Trouverait-on dans les hôpitaux les plus pauvres beaucoup de malades aussi faciles à contenter?…
Enfin la nature prit encore le dessus, et celui qui voulait s’en servir encore pour sa gloire, la rendit à l’état dont elle avait besoin pour ses desseins. Depuis plusieurs mois les religieuses Urbanistes avaient été mises en liberté, et la Sœur de la Nativité aspirait, depuis plus longtemps encore, après le moment de leur être rendue, pour avoir la consolation de mourir entre leurs bras: elle en parlait à tout propos. Ce moment tant désiré arriva. Elle dit, en pleurant, adieu pour toujours à sa famille, tremblant la fièvre, ayant plus l’air d’un squelette que d’une personne vivante. Elle monta sur une charrette (1), qui la reconduisit chez M. de la Jannière, où elle prit son dernier logement, et où on fut au comble de la joie de la revoir après un an qui avait paru très long et très ennuyeux.
(1) Ce fut malgré les oppositions de son frère, que les Chouans lui procurèrent la charrette qui la rendit aux religieuses qui la redemandaient depuis longtemps.
QUATRIÈME ET DERNIERE EPOQUE.
Les derniers Travaux et la Mort de la Sœur.
Après avoir rempli de son mieux, et comme nous l’avons vu, la tâche que Dieu lui avait imposée, la Sœur n’avait plus pensé qu’à elle-même, et s’était réjouie de n’avoir plus en vue que la grande affaire de son salut, en se préparant à une mort qu’elle prévoyait depuis longtemps ne devoir pas être très éloignée.
En finissant de me rendre ses comptes, elle me déclarait, comme on le sait, qu’il ne lui restait plus qu’à se recommander à mes prières, comme à celles de tous les lecteurs de son recueil, renonçant d’ailleurs à toute prétention sur l’estime ou l’admiration du public, qu’elle ne méritait aucunement. « Il ne me reste plus, disait-elle, qu’à pleurer mes infidélités continuelles, mes péchés sans nombre, et à me jeter à corps perdu dans la miséricorde d’un Dieu trop bon pour vouloir la perte éternelle, ni même permettre l’erreur involontaire d’une pauvre créature qui, après tout, n’a jamais cherché qu’à connaître sa volonté sainte et à s’y conformer. »
Telles étaient, en effet, ses dispositions; mais Dieu, qui se plaît à voir, dans les âmes privilégiées les sentiments de crainte et d’amour qu’il y fait naître, n’est pas obligé, pour cela, de se conformer en tout aux règles que leur humilité, toujours timide semble vouloir lui prescrire à lui-même. Indépendamment de tout cela, il faut que sa volonté l’emporte sur la nôtre, et que l’instrument dont il veut se servir obéisse à la main qu’il emploie. Moïse et Jérémie ont beau s’excuser sur leur incapacité, Jonas a beau fuir;
__________________________
(450-454)
les plus saints personnages de l’Église ont eu beau éviter les dignités, les charges et les honneurs qui les attendaient, il a fallu céder à l’ordre qui les appelait; rien ne pouvait les y soustraire : il faut, bon gré mal gré, que Moïse délivre son peuple; que Jérémie le rappelle, en pleurant sur ses maux, et que Jonas annonce à Ninive ses crimes, pour lui en faire éviter le châtiment. D’après cette règle, c’est en vain que la Sœur de la Nativité cherche à s’ensevelir toute vivante au fond de son néant, il faut absolument que l’écho résonne, tandis que la voix se fera entendre, et qu’il répète ce qu’elle aura prononcé : Deus, docuisti me à juventute meâ, et usque nunc pronuntiabo mirabilia tua. (Ps. 70, 17.) C’est sa destination.
Dès son enfance, elle avait, comme Isaïe, entendu cet ordre du ciel : « Prophète, ne cesse de crier; que ta voix s’élève continuellement comme celle d’une trompette, pour reprocher à mon peuple ses iniquités, et ses crimes à la maison de Jacob. Clama, ne cesses; quasi tuba exalta vocem tuam, et annuntia populo meo scelera eorum, et domui Jacob peccata eorum. (Isaïe,58,1.) Voilà pourquoi, toujours fidèle à sa mission, elle témoigna tant de zèle contre les désordres qui offensaient son Dieu et causaient la perte de sa patrie. » Elle n’a point tenu la vérité captive; si elle n’écrivit pas toujours, elle ne cessa d’invectiver contre le vice; elle le fit de parole et d’exemple jusqu’au dernier soupir, et on peut dire d’elle comme de celui dont saint Paul fait un si bel éloge : Non-seulement elle a parlé jusqu’à sa mort; mais, toute morte qu’elle est, elle parle encore, et parlera tandis que ses ouvrages immortels subsisteront : et defunctus adhuc loquitur. (Heb., 11,4.)
À peine rendue à ses Sœurs, elle se sentit fortement portée à demander permission de passer en Angleterre pour y trouver le directeur, à qui elle déclara à différentes reprises, qu’il lui restait à dire bien des choses qu’elle ne pouvait déclarer à personne qu’à lui. Son grand âge, et plus encore ses infirmités lui firent refuser constamment la grâce qu’elle demandait avec beaucoup d’instance; voyant qu’elle ne pouvait réussir dans ce projet, elle obtint facilement d’y suppléer de son mieux en faisant encore écrire un supplément pour m’être remis, répétant qu’elle craignait bien qu’on ne se fût opposé à la volonté de Dieu; ce qu’elle a fait mettre dans son supplément, et ce que m’ont assuré, en particulier, des personnes qui en avaient été chargées de sa part.
La Sœur de la Nativité reprit donc encore une fois la plume avant de mourir, je veux dire qu’elle profita du peu qui lui restait à vivre, pour dicter aux deux religieuses qui étaient toujours dans son secret, le dernier ouvrage qui nous reste à rédiger. C’est une espèce de deutéronome, en deux cahiers, où elle repasse beaucoup de choses qu’elle avait déjà dites, et que par conséquent je serai obligé d’abréger beaucoup, en conservant toutefois les idées neuves avec les développements qui m’ont paru les plus dignes d’être conservés. Ces deux cahiers devaient m’être remis après sa mort, car j’ai lieu de croire que depuis longtemps elle ne s’attendait plus à me revoir. Sa conduite ne permet guère d’en douter.
Les soins que lui occasionna cette nouvelle entreprise, loin de ralentir sa ferveur, ne firent, au contraire, que l’augmenter de jour en jour; ses exercices de piété n’en devinrent que plus fréquents et plus longs, son zèle plus ardent, sa dévotion plus tendre. Loin de rien rabattre de ses pénitences, elle ne fit qu’y ajouter, malgré des infirmités que le poids de l’âge et des chagrins faisait toujours aller en augmentant. Enfin, à l’exemple de tous les saints que Dieu a favorisés d’une manière toute particulière, elle montra qu’elle n’avait mis tant d’intérêt à ce qu’elle poursuivait encore avec tant de constance, que par l’appréhension où elle était du compte qu’elle en devait à Dieu.
Il y avait quelques mois qu’elle avait fini ses dernières dictées, lorsqu’elle eut cette dernière vision dont je vais maintenant rendre le compte que j’ai promis, parce qu’il vient ici naturellement, et qu’il y trouve sa place, en suivant l’ordre des temps. Elle fit écrire cette vision nocturne, comme pour mettre la dernière main à tout ce qu’elle avait dit, en fournissant une preuve de nature à fermer la bouche à tous ses contradicteurs. La lettre authentique qu’elle en envoya à M. le doyen de la paroisse de la Pellerine, et qu’il m’a remise (on sait qu’il fut quelque temps son directeur), cette lettre dont je conserve l’original certifie par ledit doyen; cette même lettre, dis-je, la Providence a permis qu’elle fût commencée par madame la Supérieure, et finie par madame la Dépositaire, sous la dictée de la Sœur, comme pour réunir dans le même acte les deux témoins et les deux mains qui avaient tout vu et tout écrit. Voici le contenu de cette lettre; je n’y changerai rien d’essentiel, mais j’ajouterai quelques petits commentaires au texte, en lettres différentes:
__________________________
(455-459)
Fougères, le 16 octobre 1797.
Mon Père,
Je vais vous faire part d’un songe significatif que Dieu a permis à l’égard de mes écrits. Je pense que le démon m’a apparu sous la forme d’une religieuse défunte que j’avais connue, et qui me dit qu’elle était en purgatoire où elle souffrait des peines extrêmes; ce qui m’excita à une grande pitié et compassion. Sur sa demande, je lui promis de prier Dieu de la délivrer, et lui demandai que, quand elle serait en paradis, si elle connaissait qu’il y eût en moi quelque chose qui fût contraire à mon salut, elle priât Dieu qu’il voulût bien me le faire connaître, afin que je m’en corrigeasse avant que de paraître à son jugement. Elle me répondit que, dès le présent, elle voyait un grand obstacle à mon salut, que c’était pour ce sujet qu’elle m’apparaissait. (Ce n’était donc plus pour chercher des prières.) Elle ajouta que quoiqu’elle m’apparût en rêve, je ne devais pas prendre ce qu’elle me dirait pour une rêverie, et que l’affaire était de conséquence. Eh! quoi donc? lui demandai-je.
C’est, me répondit elle, à l’égard des écrits que vous avez fait faire, et qu’il s’agit de faire supprimer et annuler. La chose prend une très mauvaise tournure. (C’était le moment où les évêques me donnaient leur approbation… ) Il faut au plus tôt envoyer un exprès à M. de Fajole, avec votre rétractation, afin que tout ce que vous avez dit (1) soit regardé comme nul et tout à fait anéanti. Je lui fis observai que je n’avais fait en tout cela que ce que Dieu m’avait ordonné. Non, Dieu ne demandait point cela de vous, me répliqua-t-elle d’un air très courroucé contre moi. (Les âmes du purgatoire ne se fâchent point.) Elle me dit que j’étais trompée pour avoir obéi à mes confesseurs…. Cette âme du purgatoire ne faisait ici que répéter ce que le démon avait dit à la Sœur pour l’empêcher de faire écrire; voilà déjà bien des traits de ressemblance avec l’esprit qui, pour mieux faire illusion, se transfigure en ange de lumière (2); mais poursuivons.)
(1) Pourquoi à M. de Fajole? Quel droit a d’annuler, celui qui n’a pas droit de connaître?
(2) Heureusement, la Sœur n’était pas novice dans, l’art de le combattre et de la deviner.
À ces mots je reconnus que c’était le démon qui employait cette ruse pour troubler mon esprit et inquiéter ma conscience; et dans le moment j’élevai mon cœur à Dieu, en le priant qu’il eût pitié de moi; et animée du Saint-Esprit, je répondis au spectre que j’étais toute de feu et de flamme sitôt qu’il s’agissait d’obéir à Dieu en procurant sa gloire. Mon entente était que quand j’avais obéi à ceux qui me tiennent la place de Dieu, je croyais avoir obéi a Dieu même. En même temps, je fis le signe de la croix sur moi. À ce signe qui lui déplut, la prétendue religieuse prit la fuite; mais l’esprit de Dieu me fît courir après elle, je la poursuivis, l’arrêtai, et la prenant par son voile : Si tu viens de la part de Dieu, lui dis-je, si c’est lui qui te fait parler, fais donc avec moi le signe de la croix, et rends cet hommage à celui qui t’envoie; rends gloire à l’adorable Trinité… J’eus beau l’y exhorter et lui en donner l’exemple; pendant que je répétais mon signe de croix le fantôme disparut et s’évanouit entre mes mains, comme une vapeur noire et infecte, sans que je puisse dire s’il rentra dans la terre ou ce qu’il devint.
Sur cela, mon Père, je vous ferai quelques remarques. Quand cette prétendue religieuse commença à me parler de mon écrit, sans que j’eusse encore eu le temps de soupçonner son intention, je lui demandai si l’écrit dont elle me parlait réussirait. Elle me répondit que oui avec dépit, et ce fut là qu’elle ajouta, d’un air fâché, qu’il prenait une mauvaise tournure; mais ceci ne m’inquiéta plus, sitôt que j’eus reconnus le stratagème du démon. Ce qui me surprit le plus, ce fut de l’entendre me dire qu’il fallait m’en rapporter à M. de Fajole, et m’adresser à lui pour faire anéantir l’ouvrage : car je puis vous assurer que je n’ai jamais connu ni le nom ni la personne de ce M. de Fajole, et ne savais pas s’il était prêtre ou séculier. Aussi je ne me mis point en peine de m’en informer, bien résolue de ne faire aucun cas du conseil qu’on me donnait.
Je vous dirai encore, mon Père, que quand je courus après le fantôme, et que je l’arrêtai, l’Esprit du Seigneur me fit connaître plus clairement que c’était le démon, et qu’il fallait renoncer à tout ce que m’avait dit ce père du mensonge, et n’en tenir aucun compte en mon esprit. La Sœur continua en changeant de sujet.
Mon Père, je suis inquiète si vous avez reçu la lettre où notre révérende Mère vous faisait savoir de ma part, il y a comme un mois, qu’il fallait faire passer, le plus tôt possible, à M. Genêt, tous les écrits que vous savez. Vous m’obligerez infiniment de me dire s’ils sont passés, ou si vous prévoyez trouver des voies sûres pour les lui faire tenir à sa résidence….
__________________________
(460-464)
(Ces écrits dont parle la Sœur ne m’ont point été envoyés en Angleterre; mais on me les a remis ici quatre ans après sa mort.)
Je vous dirai aussi, mon Père, que le bon Dieu me fait la grâce de ne me laisser point sans croix; le malheur est que je ne la porte pas bien. La nature et le démon, qui la prennent toujours par un bout ou par l’autre, tâchent sans cesse de me l’arracher en la faisant tomber par terre, et bien souvent me font la porter tout de travers. Vous m’entendez sans doute, mon Père; je veux par-là vous faire comprendre que le démon et la nature corrompue me font continuellement la guerre, tantôt d’une façon, tantôt d’une autre, et particulièrement dans le temps de la maladie. Je suis encore actuellement réduite sur le lit avec une fièvre continue; mais les souffrances du corps ne me sont rien, pourvu que le bon Dieu ait pitié de ma pauvre âme, et qu’il la délivre des griffes du dragon infernal. C’est pour ce sujet, mon Père, que je vous supplie très humblement de vous souvenir de moi devant le Seigneur; je le prie aussi pour votre conservation; mais j’ai bien plus besoin de vos prières, que vous n’en avez des miennes.
Ne vous étonnez pas, mon Père, si vous voyez deux mains d’écriture dans cette lettre; c’est que notre Mère, qui l’avait commencée, n’a pu la finir à cause de ses affaires; la sœur des Séraphins y a suppléé. Elles vous assurent toutes les deux de leur profond respect, ainsi que Sainte-Elisabeth. Pour moi, mon Père, je suis, avec un profond respect et une parfaite soumission, votre très humble et obéissante servante.
Sœur de La Nativité.
L’original de cette pièce extraordinaire, que je garde, porte ces mots écrits de la main du premier dépositaire: « J’ai reçu telle qu’elle est, et à l’époque de sa date, la présente lettre de la part de la Sœur de la Nativité, religieuse Urbaniste de Fougères, et je l’ai remise, en 1802, au directeur » de cette communauté. »
Signé Leroy, desservant de la Pellerine
Ce fut le 6 juillet 18o3, que M. Leroy me donna cette attestation chez lui; et le 27 du même mois et de la même année, les deux religieuses qui l’avaient écrite m’ont signé l’attestation suivante, touchant la copie qu’on vient de voir:
Nous, soussignées, certifions à qui il appartiendra, que M. Genet a fidèlement copié la lettre que nous avions écrite, en 1797, à M. le doyen de la Pellerine, de la part de notre chère et respectable défunte Sœur de la Nativité. Tout le changement que nous avons aperçu, en comparant l’un à l’autre, consiste à rendre françaises certaines phrases qui ne l’étaient pas. Le sens est le même partout, ainsi que l’ordre des choses.
Marie L. Le Breton Sœur Sainte-Magdeleine, Sup., Michelle Pél. Binel des Séraphins, déposit., Blanche Binel de Sainte-Elisabeth.
Qu’on me permette maintenant quelques réflexions sur ce dernier écrit de la Sœur, qu’on vient de voir. Je ne répéterai point ici ce que j’ai dit ailleurs sur les songes mystérieux et significatifs dont les saintes Écritures nous fournissent tant et de si frappants exemples. Je me contenterai de dire qu’il me paraît impossible de révoquer sérieusement en doute la réalité de l’apparition dans le songe qu’on vient de rapporter. Car enfin, outre qu’un fantôme purement imaginaire n’eût pu lui indiquer un nom et une personne dont elle n’avait aucune connaissance, comment un songe en l’air, et qui ne pouvait alors avoir aucune espèce d’application, se trouve-t-il aujourd’hui cadrer si parfaitement avec le nom, l’opinion et les paroles de la personne indiquée, et cela de manière qu’en rapprochant les époques et les dates, il est impossible de supposer aucune espèce de collusion entre la Sœur et moi, ni même aucune défiance ou soupçon de la Sœur, par rapport à un homme dont elle n’avait pas la moindre idée? Le pur hasard, ou la bizarrerie d’un songe ordinaire, ont-ils jamais produit de pareils effets? Voilà ce qu’il faudrait prouver, si on veut dire quelque chose qui vaille; car on n’avancera jamais rien par des mots insignifiants.
En second lieu, je serais très curieux de savoir comment et par quel moyen M. l’abbé de Fajole avait reçu les renseignement secrets et les connaissances particulières sur lesquels il m’ordonnait, à Londres, en 1800, de brûler des cahiers qu’il avait admirés dans l’île de Jersey en 1792. Soit que les soupçons qu’on lui avait inspirés depuis eussent tombé sur l’ouvrage, sur la Sœur, ou sur moi, je les crois également faux; mais par où lui sont-ils venus ? Voilà le problème que je ne puis résoudre. La religieuse prétendue qui, tout en courroux, ordonnait à la Sœur, comme de la part de Dieu, de lui dépêcher un exprès pour qu’il eût anéanti l’ouvrage, ne se serait-elle point, au refus de la Sœur, chargée elle-même de la commission ? Ce serait à M. l’abbé à nous en instruire; ce qu’il y a de sûr, c’est qu’il me parla presque dans les mêmes termes que la religieuse prétendue l’avait fait à la Sœur. En cette supposition, M. l’abbé aurait peut-être dû l’éprouver comme elle, par la volonté de Dieu, la décision des supérieurs dans l’Église et le signe de la croix: alors on
__________________________
(465-469)
peut croire qu’il l’eût vue aussi s’évanouir en fumée noire, et avec elle tous ses soupçons auraient disparu.
Ce qu’il y a de bien certain, c’est que le père du mensonge opère de bien des manières dans le monde : il a bien des agents toujours prêts à favoriser ses illusions et ses pièges. M. l’abbé de Fajole, que je respecte, n’a jamais eu en cela que de bonnes vues, j’en suis très persuadé; mais il ne serait pas le premier homme de bien en place qui eût été dupé sur bien des points par les manœuvres de celui qui ici s’habillait en religieuse pour mieux surprendre la piété d’une sainte, contre laquelle il avait échoué tant de fois. M. l’abbé, qui ne cherche que le vrai, ne peut en aucune sorte trouver mauvais qu’un homme, chargé de la cause d’une fille que tout canonise, se serve maintenant d’une pièce authentique qu’elle lui met entre les mains pour détruire l’effet désavantageux qu’aurait pu produire contre elle l’autorité de son opinion. Il a cru, sans doute, faire son devoir; en cela je ne puis le désapprouver; mais aussi j’ai cru encore faire le mien, et j’attends de lui la même justice. Revenons à la Sœur de la Nativité.
Après ce dernier écrit, qui n’est pas le moins intéressant, la Sœur se crut enfin déchargée de ce que Dieu demandait d’elle. Elle ne pensa plus qu’à lui en demander la réussite, en se préparant plus que jamais à une mort qu’elle regardait comme très prochaine, et au compte qu’elle devait rendre de sa vie et de tous ses écrits. Déchargée de sa tâche, elle ne s’appliqua plus qu’à mettre en règle sa conscience et son âme, par un redoublement de prières, de pénitence et de ferveur. Ses infirmités redoublaient aussi de jour en jour, de sorte qu’elle ne pouvait plus marcher que courbée, à cause des douleurs qu’elle en ressentait. Elle ne sortait que pour l’office public des jours de dimanches sitôt qu’on commença à le célébrer pour les catholiques; mais elle ne perdait aucune occasion de recevoir les sacrements, et d’entendre la messe toutes les fois que quelque prêtre caché pouvait lui procurer ce bonheur dans la maison qu’elle habitait.
Elle avait des conversations assez fréquentes et quelquefois très longues avec des religieuses et des personnes du monde, qui venaient la consulter sur différentes difficultés que les circonstances faisaient naître à chaque instant. Elle était terrible et inexorable pour les unes et pour les autres sur tout ce qui concernait la foi et les mœurs. Elle interdisait sans miséricorde et sans distinction toute communication spirituelle avec les schismatiques, les jureurs et les intrus, jusqu’à ce que l’Église en eût prononcé; car personne ne fut plus soumis à tout ce que l’Église avait décidé. C’est, disait-elle, la boussole du vrai chrétien, c’est la règle infaillible que Dieu lui donne, il ne peut s’égarer en la suivant. Celui qui la suit ne répond de rien; celui qui s’en écarte se rend comptable de tout. Eh! quel compte, quel aveuglement que de se croire plus sage que les guides que J.-C. nous donne, et de préférer son jugement particulier à celui des juges qui doivent nous conduire !…..
Quant à la morale, elle prétendait qu’une religieuse, hors de son cloître, doit paraître ce qu’elle est aux yeux du monde, par sa bonne conduite, sa modeste retenue, et même par la forme de ses vêtements, qu’elle leur prescrivait avec beaucoup de soin et d’exactitude, invectivant quelquefois contre celles qui y marquaient de l’éloignement, les menaçant de la colère de J.-C., etc., etc.
Sa morale n’était pas moins sévère, par rapport aux gens du monde, sur tout ce qui concerne leurs engagements. S’ils ne sont pas tenus aux vœux des religieux, disait-elle, ils n’en sont pas moins obligés à ceux de leur baptême, sous peine de damnation. Tout ce qui les en écarte tant soit peu doit leur paraître suspect et dangereux. Sur cela, elle condamnait, comme l’œuvre du démon non-seulement le bal, la danse, le jeu, la comédie, les spectacles, la lecture des romans, les mouches, le fard, et tout l’attirail de la coquetterie, mais encore tout ce qui, dans les modes reçues, avait l’air d’en approcher. Elles ne permettent point aux dames ni aux demoiselles de porter de faux cheveux, disant que, bien différentes des hommes obligés d’être souvent découverts, leurs coiffures pouvaient toujours suppléer au défaut de cheveux naturels, et que, par rapport à elles, l’art ne pouvait servir qu’à satisfaire l’envie de plaire aux hommes, et non à Dieu, en relevant une beauté déjà trop séduisante. C’était, suivant elle, une infidélité aux vœux du baptême, une espèce d’apostasie qui doit beaucoup déplaire à Dieu. Elle voulait qu’on plaçât l’épingle du mouchoir de manière à éviter ces négligences prévues et réfléchies, aussi communes quelles sont contraires à la vraie modestie. Je ne sais comment certaines gens prendront sa morale, qui n’est que celle des Pères de l’Église; mais je sais qu’elle en a fait trembler surtout cela, jusqu’à les y faire renoncer pour toujours.
Quand les Saints entrent en discours sur les grands objets de la Foi, on
__________________________
(470-474)
reconnaît à leur langage qu’ils en sentent toute l’importance et la vérité. Ils ont, d’ordinaire, pour en parler, non-seulement des expressions et des tournures qui leur sont propres, mais encore un ton qui n’est pas commun, une énergie de sentiment qui en dit beaucoup plus que les paroles. Voilà d’où vient qu’elles exagèrent tant leurs moindres fautes. Telle, surtout vers la fin de sa vie, parut toujours la Sœur de la Nativité. Quand elle parlait de Dieu, du salut, du vice, ou de la vertu, elle le faisait avec une force et une dignité convenable à ces grands sujets; et malgré la simplicité de ses expressions, qui souvent eussent paru risibles dans toute autre bouche que la sienne, elle savait mettre le plus grand intérêt dans tout ce qu’elle disait, au point que les personnes les plus instruites venaient la consulter et l’écoutaient avec une grande attention. Personne n’était plus propre qu’elle à donner de l’importance aux grandes vérités de la religion. C’est que ces vérités, qu’elle sentait parfaitement, sont grandes par elles-mêmes, et que l’Esprit-Saint qui la faisait parler est indépendant de tous les ornements du discours.
Enfin la Sœur de la Nativité approchait de l’heureux terme de sa carrière. Affaiblie par l’âge, épuisée par les maladies, les chagrins de toute espèce, les austérités et les souffrances dont sa pauvre vie avait été traversée, elle ne se soutenait plus que par miracle; ce n’était plus qu’un squelette animé. Dégoûtée d’un monde où elle n’avait jamais vu que des sujets d’affliction et de larmes, et où elle en voyait plus que jamais encore, son âme depuis longtemps paraissait flotter entre l’amour qui veut quitter la vie pour se réunir à son Dieu, et la soumission qui veut souffrir encore pour mériter d’autant plus ce bonheur. Non mori sed pati.
Il n’y avait que très peu de temps qu’elle venait d’essuyer, après bien d’autres, une maladie sérieuse dont on jugea qu’elle ne devait pas réchapper. C’était une espèce d’hydropisie de poitrine, dont on la tira enfin par l’usage du vin stislitique (x) très amer et très détestable au goût. Sa convalescence ne fut pas de longue durée, et la Sœur s’y attendait bien. L’hydropisie vraie ou fausse dont ou croyait l’avoir guérie, dégénéra bientôt en un ulcère au foie, qui l’emporta après six ou sept semaines de médicaments, qui ne servirent au plus qu’à prolonger un peu ses souffrances, et peut-être à les rendre beaucoup plus vives et plus méritoires.
(x) silicique (?)
Pendant ce temps elle reçut plusieurs fois la sainte communion avec une foi et une dévotion qu’on attendait d’elle. Malgré la violence de ses douleurs, elle ne resta couchée que le moins qu’elle put, et encore ne voulut-elle être veillée que les deux ou trois dernières nuits, conservant son esprit sain et entier jusqu’au dernier moment, et conservant souvent avec beaucoup de jugement et de présence d’esprit avec les personnes qui l’assistaient. On venait la visiter (1); ses conversations roulaient d’ordinaire sur des sujets de piété. Elle y mettait toujours une âme qui en donnait aux autres, et fût allée bien souvent jusqu’à l’affaiblir elle-même, sans qu’elle s’en fût aperçue, tant elle y était habituée. Elle parla même avec beaucoup de feu, dans une circonstance, à une personne qu’elle voulait rappeler à son devoir. Voyant que cette personne opiniâtre voulait encore revenir à la charge, elle lui fit dire par sa gardienne qu’elle lui avait tout dit : J’ai, dit-elle, enfoncé l’épingle jusqu’à la tête. Si elle n’a rien senti, elle ne le ferait pas davantage quand je lui parlerais encore.
(1) Une dame de la ville vint un jour lui demander ses prières et sa bénédiction pour elle et pour son petit enfant, qu’elle lui présenta : « Ah! ma bonne dame, dit la Sœur, que peuvent mes pauvres prières ? C’est à la sainte Église de bénir vos enfants. » Cependant elle les bénit en leur souhaitant la bénédiction du ciel.
Quoiqu’elle n’ait jamais positivement déclaré qu’elle eût eu révélation de l’heure et du moment de sa mort, on a de bonnes raisons de penser qu’elle en avait un très fort pressentiment, pour ne rien dire de plus. Elle avait souvent demandé à Dieu de mourir le jour et l’heure où elle avait fait son premier vœu de continence, en se consacrant à la Sainte Vierge devant l’image de Notre-Dame des Marais. (C’était vers le midi du jour de l’Assomption.) Dès le commencement de sa dernière maladie elle fit couper très ras ses cheveux et même ses ongles, et voilà d’où vient que ceux qu’on a d’elle sont très courts : depuis le premier du mois d’août, elle demanda à plusieurs reprises le quantième de ce mois; quand une fois on lui eut répondu qu’on était au onze du mois, elle répondit : Encore que le onze! Que cela est long! Quand on lui répondit qu’il était huit heures, le jour de l’Assomption, elle répondit de manière à faire entendre qu’elle eût désiré qu’il eût été tard. Et le quinze, qui fut le jour de sa mort, elle s’informa souvent de l’heure, témoignant désirer la moitié du jour, sans en dire davantage. Il lui tardait d’y arriver, vous eussiez dit qu’elle accusait le soleil de prolonger par sa lenteur un jour qu’elle ne devait pas finir, ou plutôt qui devait être pour elle l’aurore d’un jour sans fin, en lui
__________________________
(475-479)
ouvrant la porte de la grande et bienheureuse éternité.
Depuis, surtout, que sa poitrine se fut chargée de ces humeurs ulcéreuses qui la suffoquaient, elle en rendait fréquemment dont l’odeur seule était insupportable à tous les assistants; Ces humeurs, qui annonçaient la dissolution de son corps, l’accablaient, autant par leur acre fétidité que par les efforts qu’il lui fallait faire pour les expectorer; elle ne pouvait quelquefois s’empêcher d’en désirer la fin, quoiqu’elle ne s’en plaignît pas. Ma Sœur, lui dit un jour la religieuse qui l’assistait, c’est maintenant que le divin maître vous fait boire à sa coupe d’amertume.. Ah! ma mère, reprit la Sœur, je pense que le fiel et le vinaigre seraient moins mauvais;… mais il le faut et j’en bénis Dieu…
Dans les intervalles de sa maladie, elle avait donné à différentes personnes du monde et du cloître des avertissements salutaires et dont plusieurs ont profité. Ces avertissements roulaient sur l’état de leur conscience et l’ordre qu’elles devaient y mettre pour remédier à ce que Dieu leur reprochait; elle dit à une religieuse qu’elle avait besoin d’une revue de conscience, lui expliqua pourquoi et depuis quand; lui indiqua le directeur à qui elle s’adresserait, et jusqu’à la pénitence qu’elle en recevrait; ce qui s’est trouvé vrai dans tous les points. Elle dit à deux autres qu’elles devaient beaucoup craindre et s’appliquer à rectifier leur vocation. Elle avertit madame la Supérieure qu’elle aurait beaucoup à souffrir; que Dieu lui réservait des croix de fer, mais que la fin des troubles lui donnerait beaucoup de consolations.
Voyant que sa fin approchait, elle se prépara de son mieux à recevoir les derniers sacrements de l’Église, et pour mieux s’y disposer elle pria qu’on ne laissât plus entrer dans sa chambre que les prêtres, les religieuses et les personnes de la maison, dont elle pouvait avoir besoin. Elle reçut, avec un redoublement de ferveur le saint viatique, l’extrême onction, et l’indulgence de la bonne mort accordée à l’ordre des religieux franciscains. Elle s’exhortait elle-même, et prononça dans cette circonstance, entre autres, un acte de contrition dont tous les assistants furent touchés jusqu’aux larmes. Le prêtre qui l’administrait s’en alla plus convaincu que jamais de ce qu’il avait déjà dit en parlant d’elle: c’est une sainte. Il l’avait dit tout bas à des personnes qui n’avaient pas moins de raisons que lui d’en être persuadées.
Après cet acte de religion, elle remercia tout le monde, et pria qu’on la laissât seule avec son Dieu, qu’elle venait de recevoir pour la dernière fois. Son action de grâce finie, elle dit que dorénavant on pourrait laisser entrer tous ceux qui voudraient, vu que la vue d’une mourante pouvait avoir de bons effets: « Le spectacle de la mort et de nos fins dernières, disait-elle, est toujours salutaire aux vivants. » Il ne paraît pas que le démon l’ait inquiétée à l’approche de sa fin: c’est l’espérance que je lui avais fait concevoir, en la rassurant contre les menaces qu’il lui en faisait autrefois pour l’empêcher de me faire écrire ce que Dieu lui avait communiqué (1). On ne la veilla que trois nuits pour tout, et encore le souffrait-elle avec peine. Elle aimait qu’on lui parlât de Dieu, qu’on lui récitât souvent les actes des vertus théologales, ou quelques endroits de la recommandation de l’âme, qu’elle répétait de son mieux.
(1) On peut croire que Dieu lui a accordé ce qu’elle lui avait demandé tant de fois par ces paroles : Plût au ciel que la fin de ma vie soit aussi tranquille que le commencement et la suite l’ont été peu !
Enfin, le quinzième d’août 1798, jour de l’Assomption de sa grande protectrice, arrive. C’est le jour où elle s’attend de partager le triomphe de celle par qui elle a déjà tant de fois triomphé de ses ennemis. La sœur de la Nativité s’en réjouit; mais elle n’en fait presque rien connaître, tant elle est maîtresse d’elle-même, et tant elle craint de laisser aucune idée qui lui fût avantageuse. Elle demande l’heure qu’il est dès le matin, parle ensuite de Dieu à différentes personnes, et leur en parle avec un visage et un ton qui annonçaient le contentement. On fit ensuite entrer sa belle-sœur, qui l’était venue voir : elle eut avec elle une conversation particulière et qui dura assez longtemps. Sur la permission qu’elle en avait obtenue, elle disposa en sa faveur de son rouet et de quelques autres petits effets, et cette bonne fermière la quitta les larmes aux yeux.
La Sœur de la Nativité parlait alors avec plus de difficulté que jamais, et on avait toutes les peines à l’entendre, tant sa poitrine était oppressée. Il était vers dix ou onze heures, et tout annonçait en elle l’effet, ordinaire de la fluxion, une extinction totale : on s’attendait bien que sa position ne pouvait durer longtemps, et elle s’y attendait plus que personne. Couchée sur son lit de douleur, ayant devant elle l’image de son Dieu mourant, sur elle la formule de ses vœux, et à côté de l’eau bénite dont elle voulait souvent être aspergée; conservant tout son esprit et toute la sérénité de son âme, elle fixait la mort d’un œil assuré, elle la contemplait d’un air tranquille,
__________________________
(480-484)
et la voyait venir sans la moindre frayeur. Oui, sûre de sa récompense, elle voyait avec joie s’approcher l’heureux terme de ses travaux, et semblait défier, par sa ferme confiance, tout ce que l’idée de l’éternité peut offrir de plus effrayant au reste des mortels.
À onze heures et demie, elle n’avait plus qu’un souffle, qu’il était impossible d’entendre; mais le mouvement de ses lèvres, l’air de son visage et les signes qu’elle faisait encore, disaient, tout en mourant, qu’elle avait tout son esprit présent. Ses yeux, tantôt élevés vers le ciel, et tantôt fixés sur son crucifix, désignaient tout à la fois et le but où elle tendait, et l’objet de son amour, et le motif de son espérance. À sa demande, on lui prenait souvent la main pour lui aider à faire le signe de la croix sûr elle-même, ou lui faire baiser les pieds de son crucifix. Elle tâchait encore de répéter les saints noms de Jésus et de Marie, ou quelques actes de foi, d’espérance ou d’amour, qu’on lui prononçait, et qu’elle aimait tant à entendre. La dernière fois qu’elle demanda le signe de la croix à la religieuse qui lui rendait le plus souvent ces services de piété, celle-ci, au lieu de lui prendre la main, lui fît elle-même sur la figure le signe sacré avec de l’eau bénite, et la sœur de la Nativité lui témoigna sa reconnaissance par un souris très gracieux deux fois répété avec beaucoup d’intelligence. Midi frappait alors à l’horloge de la ville. Quelques minutes après, celles qui étaient restées autour d’elle s’aperçurent qu’elle ne leur donnait plus aucune marque de connaissance, et que son visage éprouvait quelque altération. Elles se mirent à genoux, et ce fut pendant qu’elles priaient pour elle, que cette sainte fille rendit paisiblement l’âme à son Dieu. Sic moritur justus. Le quart après midi frappa cinq ou six minutes après sa mort.
Ainsi mourut, sur sa soixante-huitième année, cette fille extraordinaire, qu’on peut, avec raison, regarder comme le prodige de son siècle, digne à tous égards d’être comparée à tout ce que l’Église honore de plus grand et de plus extraordinaire parmi les personnes de son sexe, à qui elle ne cède en rien du côté des vertus, ni de l’austérité des mœurs; d’autant plus étonnante, que, sans lettres, sans éducation, sans presque pouvoir s’exprimer, obligée d’employer une main étrangère, elle a égalé, peut-être même surpassé dans ses écrits, tout ce que les autres avaient fait de plus admirable en genre d’inspiration ou de spiritualité. Si son ouvrage, tel qu’il est, a paru à plusieurs savants devoir l’emporter sur tout ce que sainte Thérèse a écrit de plus frappant, que serait-ce donc si, avec l’esprit et la culture de celle-ci, elle eût pu, par elle-même, développer et présenter ses grandes idées, que son rédacteur n’aura fait qu’affaiblir considérablement ? Disons-le donc sans crainte, la sœur de la Nativité était suscitée de nos jours pour montrer, en sa personne, que le bras de Dieu n’est point raccourci, et qu’il peut, vers la fin des siècles, susciter dans son Église des merveilles dignes de celles qui en ont signalé les commencements, et que les sectes ne pourront jamais citer en leur faveur.
À peine eut-elle expiré, que la voix publique la canonisa par des qualifications qui n’appartiennent strictement qu’à ceux dont l’Église a reconnu et déclaré la sainteté. La sainte religieuse vient de mourir, disait-on. On accourut en foule, demandant à voir le corps de la sainte. Elle fut longtemps exposée, revêtue de son habit de religion, ayant la figure, les mains et les pieds découverts, pour satisfaire l’empressement de ceux qui avaient la dévotion de lui rendre l’hommage dû à la vertu des grands serviteurs de Dieu. Son lit fut bientôt couvert de livres, de chapelets, de reliques et autres instruments de piété qu’on voulait y faire toucher. On demandait avec instance, on partageait avec empressement les moindres choses qui avaient pu lui appartenir. On voulait avoir de ses cheveux, de son voile, de son cordon, des grains de son chapelet; jusqu’à ses pauvres haillons furent divisés. On se recommandait hautement à ses prières, et aujourd’hui même, rien de plus commun dans les villes et les campagnes voisines, que de prier et faire des vœux en l’honneur de sainte Nativité.
Elle avait demandé à M. Duval, recteur de Laignelet, d’être inhumée dans le cimetière de la paroisse. Loin de s’y opposer, M. Duval l’avait remerciée de la préférence qu’elle lui accordait, ajoutant que ses reliques attireraient la bénédiction de Dieu sur lui et ses paroissiens. La Sœur avait pris cette addition comme une plaisanterie de sa part, à laquelle elle n’avait voulu rien répliquer, par respect pour le bon prêtre; mais après qu’il fut sorti, elle avait dit aux religieuses que M. le recteur avait voulu se moquer d’elle. Il avait pourtant parlé très sérieusement, et ne s’attendait pas, en lui parlant ainsi, qu’il devait être sitôt inhumé lui-même à son côté, après avoir été inhumainement massacré presque dans ses fonctions par les ennemis de l’ordre et de la religion.
__________________________
(485-489)
La Sœur de la Nativité fut donc enterrée dans son cimetière, devant la grande porte de l’église, et, à ce qu’on croit, du côté du midi; madame Sainte-Reine, aussi religieuse urbaniste, tient le côté opposé de la même porte, et M. Duval se trouve entre les deux. Quelque vénération qu’on ait pour sa mémoire, ainsi que pour celle de madame Sainte-Reine, on a pourtant toujours distingué celle de la Sœur de la Nativité. Son tombeau seul est devenu célèbre. On y va fréquemment pour se recommander à ses prières. On raconte même à cette occasion des faits extraordinaires dont il ne m’appartient pas de juger. Qu’on pense ce qu’on voudra; pour moi, je n’ai pas besoin que Dieu fasse des miracles nouveaux pour croire, au moins provisoirement, au bonheur d’une âme dont les vertus, les écrits, la vie et la mort me paraissent une suite de faits miraculeux qui, la tirant de l’ordre commun, ne me permettent pas de douter un seul instant de sa sainteté.
Ainsi, toujours admirable dans ses saints, Dieu permet qu’on les éprouve; il les éprouve lui-même pendant leur vie, et les glorifie doublement après leur mort. Non content de leur donner au ciel la récompense promise à leur fidélité, il les dédommage encore sur la terre en les faisant vivre éternellement dans la mémoire des hommes, sans qu’ils puissent avoir désormais rien à craindre de la calomnie des méchants : In memoria œterna erit justus, ab auditione mala non timebit. (Ps. 111, 8,7.) Pendant leur vie, le monde les méprise et les persécute, parce qu’il ne peut souffrir la censure secrète qu’ils font de sa conduite; mais ils n’ont pas plutôt disparu à ses yeux, que, par un hommage involontaire, il rend, malgré lui, justice à la vertu qu’il avait d’abord méprisée, et qu’il admire pourtant en secret. Il ne parle plus qu’avec éloge de ces personnes extraordinaires dont il n’a pas le courage de suivre les exemples ni d’imiter les vertus.
Ainsi, tandis que la réputation des prétendus sages du siècle, tandis que celle des rois et des conquérants disparaît comme la poussière que le vent dissipe; tandis que leur nom tombe avec fracas dans l’oubli, et s’ensevelit avec eux dans le même tombeau, le juste, vainqueur de l’envie et du temps, n’a plus rien à craindre de la persécution. Il est loué de ses ennemis eux-mêmes, et vit éternellement dans la mémoire des hommes : In memoria œterna erit justus. Son nom se fortifie par les siècles, et sa gloire commence d’ordinaire où celle de ses ennemis a coutume de finir.
Après avoir lu la relation des huit dernières années de feu Sœur de la Nativité, écrite par M. Genet, nous n’y avons rien vu qui ne nous ait paru très conforme à tout ce que nous en connaissons pour en avoir été les témoins à Fougères. Le 27 juillet 1803. Marie Louise Le Breton, Sœur Sainte-Madeleine, supér.; Michelle Pel. Binel des Séraphins, déposit.; Blanche Binel de Sainte Élisabeth; L. Binel, maire; Catherine Prime Binel; Louise Binel; Anne Binel; Blanche Binel Poinçon.
____________________________
LETTRES
ET EXTRAITS DE LETTRES
Adressées à l’Éditeur au moment de la première édition de cet ouvrage, et depuis.
À M. Beaucé, Libraire.
Monsieur,
Lorsque j’écrivis à M. l’abbé Genet pour lui témoigner toute la satisfaction que m’avait procurée la lecture de son ouvrage sur la Sœur de la Nativité, je ne m’attendais pas qu’il pût attacher à ce suffrage un assez grand prix pour le rendre public, avec toutes les approbations qu’il a reçues de divers évêques et de plusieurs ecclésiastiques ou docteurs d’un mérite très distingué. Je suis loin cependant de rien rétracter de tout ce que je lui disais sur cette production, qui pourrait, il est vrai, éprouver bien des contradictions, mais qui ne s’accorde pas moins bien avec mes propres sentiments sur la grande cause de tous les désastres de notre révolution, c’est-à-dire, sur toute l’impiété d’un siècle déchaîné, en quelque sorte, contre la religion de Jésus-Christ; de ce Dieu dont elle nous donne de si grandes, de si nobles, de si justes idées.
__________________________
(490-494)
Je vous prie seulement d’ajouter à ce que M. l’abbé Genet a voulu transcrire de ma lettre que je lui avais fait quelques observations sur certaines choses, qu’il me promit d’ôter ou de changer; ce qu’il aura sans doute fait dans l’exemplaire que vous avez. Sachant d’ailleurs très bien qu’il ne m’appartient pas de m’ériger en juge des révélations et prédictions contenues dans cet ouvrage, je profitai de l’arrivée de Pie VII à Paris, pour remettre à Sa Sainteté l’exemplaire que j’avais reçu en dépôt de M. Genet même. J’espérais alors que cet ouvrage ne serait imprimé qu’après avoir été examiné par le plus compétent de tous les juges. Je sais que c’était là le vœu de la Sœur de la Nativité, dont la plus grande crainte était de s’éloigner le moins du monde de la foi de l’Église. Les circonstances ayant changé, je ne blâmerai pas ceux qui ont cru pouvoir devancer cet examen en vous livrant le manuscrit sur lequel votre édition sera faite : j’attends au contraire avec impatience la fin de cette édition, pour orner ma bibliothèque d’un ouvrage dont j’estime et respecte infiniment l’auteur et le rédacteur.
J’ai l’honneur d’être,
Votre serviteur,
L’Abbé Barruel.
Ce 10 février 1818.
___________________
Extraits de lettres de madame Le Breton, dite de Sainte-Madeleine, supérieure de la Sœur de la Nativité.
Monsieur,
Ayant appris que vous ne pouviez trouver le supplément (1), j’ai pris le parti de le faire copier pour vous l’envoyer. La tâche était forte et pénible; car je crois qu’il contiendra un volume entier…; mais, Monsieur, avant de l’imprimer, il est de toute nécessité qu’il soit rédigé par un ecclésiastique très instruit; car maintenant il me semble que toutes ces belles choses sont comme des diamants enchâssés dans du plomb. Il y a une multitude de répétitions… Je puis vous certifier qu’on n’y a rien changé ni ajouté. Il est tel que nous l’avons trouvé, ne nous proposant que la gloire de Dieu et le salut des âmes…
(1) Le supplément dont parle ici madame la Supérieure, et que je lui avais demandé, renferme tout ce que la Sœur de la Nativité avait dicté peu de temps avant sa mort; ces cahiers font la matière du quatrième volume. Ils m’ont été remis par l’héritier de M. Genet.
Le Breton, dite Sainte-Magdeleine.
Saint-James, 13 mai 1818.
Nota. Les religieuses urbanistes qui sont restées de la communauté de Fougères, se sont retirées à Saint-James, avec leur supérieure.
Monsieur,
Recevez mes remerciements des trois exemplaires que vous avez eu la bonté de m’envoyer par mes nièces. Dès que je les ai eus, j’en ai pris lecture, pour vous faire part de ce que je crois n’être pas tout à fait juste; mais il faut avouer que c’est fort peu de chose. Je vais vous en faire une note, et vous donner les noms propres qui ne sont pas bien écrits : Hélas! qu’il s’en faut encore que tout ce qu’elle m’a dit soit écrit !… Toutefois, il y a bien de quoi profiter pour tous les états. Je vois avec plaisir que des personnes qui m’avaient marqué de l’opposition pour cet ouvrage, en désirent maintenant la lecture. Le prenant sans préjugés, je ne doute pas qu’il ne soit très goûté, et c’est tout ce que je désire pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, et pour votre avantage…. Vous avez dû recevoir le supplément que vous me demandiez….. il est aussi intéressant que tout l’ouvrage, que je ne me lasse point de lire, et qu’on me demande tant à emprunter, que j’ai peine à satisfaire tout le monde. Cela, j’espère, en procurera un plus grand débit, surtout de la seconde édition qui sera plus correcte, et qui aura le portrait de cette sainte Fille. Recevez de nouveau, l’assurance de ma gratitude et du respect avec lequel j’ai l’honneur d’être, dans les sacrés Cœurs de Jésus et de Marie,
Monsieur,
Votre très humble servante, Le Breton, dite Sainte-Magdeleine.
Saint-James, 20 juin 1818.
Monsieur,
Vous avez maintenant tout ce que la Sœur de la Nativité a dicté. Elle a toujours tenu secret tout ce qui était extraordinaire, de sorte que le plus grand nombre des religieuses qui vivaient avec elle n’en avaient aucune connaissance. D’autres le soupçonnaient seulement; mais elle m’a dit bien des fois qu’elle aurait préféré déclarer tous ses péchés plutôt que d’en avouer la moindre chose. Elle m’a souvent priée de la déprécier dans l’esprit des personnes qui paraîtraient l’estimer; elle a même laissé croire qu’elle était tombée en enfance après une grande maladie, pour détruire l’opinion favorable qu’on lui témoignait. Si elle m’a donné une entière confiance, ce n’a été qu’en l’absence de M. Genet. Étant alors Supérieure, elle me disait ce que notre Seigneur lui faisait connaître, avant de le faire écrire, pour savoir si je le trouverais à propos, et je l’ai toujours approuvé, ne pouvant écrire moi-même, dans la crainte d’être aperçue. Madame Michelle Pélagie Binel, dite des Séraphins, seule dans le secret avec moi, et morte en 1817, fut chargée d’écrire. Toutes autres religieuses ne pourraient avoir que des fragments de ce que vous avez, mais, tontes vous diraient qu’elles ont été édifiées de sa conduite sous tous les rapports, ainsi que les personnes du monde avec qui elle a vécu les dernières années de sa vie. La religieuse qui l’avait écoutée au confessionnal, et qui lui semblait opposée, m’a dit ne lui avoir jamais vu faire une faute vénielle volontaire. Elle se décélait (x) seulement en parlant de l’amour divin. Sa figure s’animait, et la parole de Dieu, énoncée par elle, pénétrait jusqu’au fond de l’âme : jamais personne ne m’a fait autant d’impression; d’autres l’ont éprouvé comme moi. Quelques bons que soient ses écrits, ils ont beaucoup moins de force que de sa bouche.
(x) décélait (???)
Il a été perdu sur mer un envoi très intéressant, dont nous n’avions gardé aucun fragment. Elle nous a toujours dit que Dieu le défendait. D’après cela nous n’en avons point conservé. Le supplément que je vous ai envoyé était, à sa mort, entre les mains de M. le Saunier, ancien curé de Parcé, son confesseur alors l’ayant fait examiner par M. Vafral, prêtre et grand vicaire, demeurant à Saint-James, distingué par sa science et sa vertu. Ce dernier le confia à mademoiselle Beaumond, marchande dans le même endroit, qui en a tiré cette copie non rédigée, sur laquelle je l’ai transcrit, cette demoiselle ne voulant pas s’en dessaisir. Ces deux messieurs sont morts il y a plusieurs années; et la Sœur de la Nativité est morte quatre ans avant la rentrée de M. Genet en France. Depuis longtemps je demeurais éloignée de lui. J’ignore comment il s’est fait qu’après avoir travaillé ces derniers papiers, il les ait perdus; j’ai seulement ouï dire qu’il les avait prêtés pour copier, et qu’ils ont été brouillés, je ne sais où. Ceux-là seuls avaient été rédigés en France : tout ce que vous avez imprimé l’avait été en Angleterre. Quelques désirs qu’eût M. Genet de faire imprimer cet ouvrage, il s’est toujours présenté des obstacles.
Voilà, monsieur, tous les renseignements que je puis vous donner, puissent-ils être suflisants
__________________________
(495-499)
pour perfectionner l’ouvrage et vous prouver ma bonne volonté.
Recevez l’assurance du respect avec lequel j’ai l’honneur d’être dans les sacrés Cœurs de Jésus et de Marie.
Monsieur, Votre très humble servante,
De Sainte Magdelaine.
Saint-James, 28 juin 1818.
P. S. Elle ne faisait écrire à personne qu’à M. le doyen de la Pellerine et à M. Genet. Vous avez ses lettres.
Extraits de lettres de mademoiselle Louise Binel.
(Mademoiselle Louise Binel, fille de M. Binel, maire de Fougères, et nièce des deux religieuses Urbanistes confidentes de la Sœur de la Nativité; savoir : madame des Séraphins (Michelle-Pélagie Binel), et madame de Sainte-Elisabeth (Blanche Binel), a eu des relations particulières et très intimes avec la Sœur de la Nativité. Ses deux tantes, forcées de rentrer dans leur famille en sortant de leur communauté, avaient recueilli auprès d’elles cette sainte Converse, et c’est au sein de cette respectable famille qu’elle est morte.)
Fougères, 12 juin 1818.
Monsieur,
… Je vous remercie bien de ce que vous m’apprenez qu’il y aura une seconde édition; car j’ai beau parcourir la première, je n’y ai pas trouvé le supplément que M. Genet seul possédait. Il contenait deux cents pages, et était tout entier de l’écriture de ma tante des Séraphins. M. Genet l’avait rédigé peu de temps avant sa mort. J’avais le projet de lui envoyer une petite note d’un article, qui n’est pas conforme à l’événement. J’appris dans le temps que nous venions de le perdre.
Je vous l’adresse donc, Monsieur….
Louise Binel.
Fougères, 5 juillet 1818.
Monsieur,
…. Pour vous mettre à lieu de vous assurer si vous avez les notes véritables, écrites sous la dictée de la Sœur de la Nativité par madame des Séraphins, qui est ma propre tante, j’ai pensé, monsieur, que je ne pouvais mieux faire que de vous faire passer de son écriture. Vous trouverez donc ci-joint une lettre qu’elle m’écrivait l’année avant sa mort; car j’ai eu la douleur de la perdre il y a un an, à Pâques. Je puis vous dire aussi que c’était une sainte, ainsi que sa sœur madame de Sainte-Élisabeth. La Sœur de la Nativité en faisait un grand cas. C’eût été une grande consolation pour mes tantes de voir ses ouvrages imprimés. Nous avions le bonheur de les posséder toutes les trois depuis la sortie de leur communauté. Elles ne nous ont quittées que plusieurs années après la mort de la Sœur, pour entrer dans une communauté nouvelle, établie à Saint-James, où existe encore madame de Sainte-Magdeleine, qui était leur abbesse, et cela pour sortir du monde et mourir dans un cloître. Pardon, monsieur, je me suis un peu écarté de mon sujet. J’ai choisi cette lettre de ma tante, parce qu’elle m’y parle de notre chère Sœur, et qu’elle m’annonce que M. l’abbé Barruel a fait passer une copie de ses écrits à notre saint père le Pape. Comme ma tante était déjà malade lorsqu’elle me l’a écrite, son écriture est un peu altérée. Cependant je crois que vous verrez bien si les cahiers que vous avez sont d’elle; et s’ils en sont, vous pourrez être sûr qu’ils ne sont point rédigés par M. Genet, qui, étant mort subitement, n’aura, pu y travailler; car s’il les avait rédigés, il n’aurait pas conservé les notes de ma tante, qui ne devaient pas paraître telles qu’elles sont, mais rédigées et travaillées par M. Genet, ou, s’il ne vivait plus, par des ecclésiastiques remplis du même esprit, ainsi que vous le verrez par les dernières volontés de la Sœur, que j’ai eu le bonheur de me procurer, et que vous trouverez ci-jointes (1).
(1) On les trouvera au commencement du quatrième volume, dans l’avertissement.
Ma tante des Séraphins était la dépositaire de ces cahiers, ainsi qu’une de mes amies qui avait la confiance de notre chère Sœur, à Cause de sa vertu, de sa discrétion et des services importants qu’elle lui avait rendus. Cette bonne demoiselle s’était même exposée pour conserver ces cahiers dans le temps le plus horrible de la révolution, le gouvernement en faisait même la recherche à cause d’une malle qui venait d’Angleterre, appartenant à des ecclésiastiques qui repassaient secrètement : elle fut saisie, on y trouva quelques cahiers copiés sur ceux de M. Genet, alors à Londres. Comme il y était question de la révolution, on fit des recherches pour tâcher d’en découvrir la suite. Quand M. Genet fut revenu, mon amie et ma tante lui rendirent les cahiers, en lui faisant part des dernières volontés de la Sœur. Je ne conçois pas, d’après cela, comment M. Genet a négligé cette rédaction; car ces cahiers ne doivent pas du tout paraître tels qu’ils sont. Les deux religieuses confidentes ne s’en inquiétaient point, le tout étant entre les mains du rédacteur, bien persuadées que tout était rédigé, et, en cas de mort, donné à quelqu’un de confiance. Enfin, Monsieur, tout ce que je puis bien vous assurer, c’est que M. Genet possédait seul l’ouvrage complet. Il existe bien des copies, mais aucune ne renferme les cahiers de l’écriture de ma tante; ni elle, ni les autres religieuses n’ont conservé aucune copie des envois qui ont été faits….
Voilà, Monsieur, tous les renseignements que je puis vous donner; heureuse si je puis contribuer en quelque chose au bien que doit produire cet ouvrage précieux, plus heureuse encore si j’en profite moi-même, ainsi que des avis charitables que cette sainte fille m’a donnés elle-même de la part de Dieu; car lui seul avait pu lui donner connaissance de ce qui se passait en moi, comme elle me le dit, et cela peu avant sa mort, ainsi qu’à mon papa, maman et ma jeune sœur. Cette pauvre Sœur m’aimait bien tendrement, je lui rendais bien la pareille….
Pardon, monsieur, de la longueur de cette lettre; si je me suis parfois écartée de mon sujet, vous ne le devez attribuer qu’à mon grand attendrissement pour notre sainte fille, qui sait que je m’oublie quand je parle d’elle.
J’ai l’honneur d’être avec respect,
Monsieur,
Votre très humble servante,
Louise Binel.
Nous joindrons ici une lettre de M. Le Roy, doyen de la Pellerine, confesseur de la Sœur de la Nativité pendant l’absence de M. Genet.
Voici ce qu’il écrivait à un de ses confrères en 1799; cette lettre renferme une pratique de dévotion très efficace pour le soulagement des âmes du Purgatoire.
Monsieur,
Il y a des choses admirables à dire de la Sœur de la Nativité, qui ne permettent pas de douter de son bonheur, et annoncent qu’elle est bien grande devant Dieu. Depuis l’âge de deux ans et demi jusqu’à celui où vous savez qu’elle est morte, Dieu, de temps en temps, lui a parlé, surtout depuis le commencement de la révolution; il lui a révélé beaucoup de choses qui sont déjà arrivées, spécialement la mort de Louis XVI, son couronnement dans le Ciel, la destruction des communautés, la nouvelle persécution que nous éprouvons, etc.; pour l’avenir, la fin des malheur de la France, le triomphe de l’Église, le rétablissement de la religion, la création de nouvelles communautés, une partie des persécutions que l’Église doit souffrir jusqu’à la fin des siècles. Dieu lui a aussi révélé le moment précis de la
__________________________
(500-503)
résurrection de J.-C., les esprits célestes qui en furent les témoins.
Il lui a fait connaître qu’une manière de soulager les âmes du Purgatoire, bien efficace, et à lui bien agréable, c’est de lui offrir à cette intention, séparément, les différents tourments que J.-C. a soufferts pendant le cours de sa douloureuse passion.
Bénissons mille fois, Monsieur, et remercions, sans cesse l’auteur de tout bien des grâces extraordinaires qu’il a accordées à cette âme simple, et considérons avec étonnement comme il se plaît à faire servir les plus faibles instruments pour les plus grandes choses, et les merveilles de sa grâce et de sa miséricorde infinie pour les hommes; car ce n’est pas pour elle, mais pour nous qu’il lui a donné tant de lumières. Tâchons donc d’en profiler, et surtout de mériter d’être réunis un jour à cette sainte Fille dans l’éternité.
J’ai l’honneur d’être,
Monsieur, votre très humble serviteur,
Le Roy, doyen de la Pellerine.
On voit par cette lettre que M. Le Roy, comme confesseur de la Sœur de la Nativité, avait eu connaissance de ses derniers écrits, qui feront la matière du volume suivant.
Fin du troisième volume.
TABLE DES MATIÈRES
contenues dans le troisième volume.
__________
Introduction …………………………………………………………………. Pag. 1
Vie intérieure de la Sœur de la Nativité ………………………………….. 6
Réflexions ……………………………………………………………………….. 228
Songes mystérieux et prophétiques de la Sœur de la Nativité … 231
Songes effrayant ………………………………………………………………. 236
Songes gracieux ……………………………………………………………….. 257
Réflexions de l’auteur ………………………………………………………. 297
Déclaration et certificat des deux Supérieures de la Sœur de la Nativité …………………………………………………………………………… 300
Recueil d’autorités vivantes, et de pièces justificatives, concernant la vie et les révélations de la Sœur de la Nativité, religieuse au couvent des Urbanistes de la ville de Fougères, évêché de Rennes, en Bretagne …………………………………………………………………….. 303
Aux lecteurs …………………………………………………………………… ibid.
Extraits de différentes lettres et déclarations verbales adressées au rédacteur …………………………………………………………………….. 307
Lettre d’un prêtre français, réfugié à Paderborn, en Westphalie, adressée au rédacteur ………………………………………………………. 312
Lettre de M. l’abbé de Cugnac, vicaire général du diocèse d’Aire, adressée, de la part de son évêque, au rédacteur du recueil …… 316
Lettre de M. Martin, vicaire-général de Lisieux, à M. l’abbé Guillot, qui lui avait fait passer les dix-huit cahiers contenant la première rédaction de l’ouvrage, en le priant de lui en dire son sentiment. M. Martin était alors à la tête des prêtres français qu’on avait transférés à la maison commune de Reading, et qu’il avait d’abord été chargé de présider au château de Winchester ……….……… 320
Avis de l’éditeur ……………………………………………………………… 322
Observations sur la vie et les révélations de la Sœur de la Nativité, religieuse converse au couvent des Urbanistes de Fougères suivies de sa vie intérieur, écrite d’après elle-même par le dépositaire de ses révélations, et rédigées à Londres et dans les différents lieux de son exil. (1800) …………………………………………………………. 323
Les huit dernières années de la Sœur de la Nativité, religieuse urbaniste de Fougères, pour servir de supplément à ses vie et révélations. Par le même rédacteur. ( 1803) ………………………. 376
Introduction ……………………………………………………………….. ibid.
Plan ………………………………………………………………………………… 391
Première époque. La Sœur encore dans la
communauté ……………………………………………………………………. 392
Seconde époque. La Sœur hors de la communauté …………….. 402
Troisième époque. La Sœur chez son frère ……………………….. 420
Réflexion ………………………………………………………………………. 429
Quatrième et dernière époque. Les derniers travaux et la mort de la Sœur ………………………………………………………………………….. 448
Lettres et extraits de lettres adressées à l’éditeur au moment de la première édition de cet ouvrage, et depuis ………………………… 489
À M. Beaucé, libraire …………………………………………………….. ibid.
Extraits de lettres de madame Le Breton,
dite de Sainte-Madeleine, supérieure
de la Sœur de la Nativité …………………………………………………… 491
Extraits de lettres de mademoiselle Louise
Binel ………………………………………………………………………………. 495
Lettre de M. Le Roy, doyen de la Pellerine,
à un de ses confrères ……………………………………………………….. 499
Fin de la Table du troisième Volume.
__________________________